« Son rire ne va cesser d’inciser deux défauts, la chimère et la marotte »
Temps de lecture : 9 minutes
Comment Molière est-il devenu Molière ?
Tout est parti d’un échec, ça marche toujours comme ça. Il était le fils d’un tapissier du roi, il a créé un théâtre qui, bien sûr, n’a pas marché. Après avoir fait de la prison pour dettes, il est parti en province et c’est là qu’il a commencé à tout apprendre, notamment le jeu d’improvisation. Il a découvert qu’il possédait un talent comique irrésistible. Molière était un petit nerveux capable de déformations du visage désopilantes – on pourrait le rapprocher de Chaplin ou de De Funès. Il a suivi sur le tas une formation longue, peut-être pas si difficile que ce que montre le film d’Ariane Mnouchkine, mais il y a quelque chose de cet ordre. Ajoutons qu’il avait une vraie culture littéraire, un goût de la lecture, une langue parlée et écrite dans un français en cours de formation.
Dans quelles conditions revient-il à Paris ?
Il bénéficie d’un alignement des planètes : une cour qui attend certes de la culture, de la conversation, de l’élégance mais qui a aussi envie de rire. Nous sortons de la guerre, avec un jeune roi qui semble alors n’avoir aucun goût pour la politique, qui court les filles et aime les ballets. Quand Molière est reçu à la cour, il joue Dom Garcie de Navarre ou le Prince jaloux, une pièce élégante dans l’esprit de la comédie à l’espagnole. Il comprend aussitôt que cela ne fonctionne pas. Alors il donne des farces à l’italienne qui déclenchent l’enthousiasme. En créant la troupe de Monsieur, le frère unique de Louis XIV, il fait exploser le monopole royal du théâtre.
Comment impose-t-il sa marque ?
Avec Les Précieuses ridicules, il esquisse le portrait de ses contemporains à travers une pièce d’actualité où se retrouvent déjà tous les éléments de son théâtre : le souvenir de la farce, le rire immédiat, des valets déguisés, des grossièretés, mais en même temps une moquerie à l’égard de la préciosité, de la mode littéraire. Et puis, l’analyse morale des mœurs, de la vie intérieure avec des jeunes femmes qui prennent leurs rêves pour des réalités.
« Il aimait les femmes pour la liberté qu’elles prenaient sous sa plume »
Ce faisant, Molière passe du vertical à l’horizontal, du théâtre du monde, où Dieu est en haut, au spectacle du monde, où l’on se promène avec une lanterne le long des rues pour mieux regarder ses contemporains.
Quand produit-il ses grandes pièces ?
Après une période d’incubation entre 1659 et 1662, la cristallisation s’opère avec son chef-d’œuvre, L’École des femmes, cinq actes en vers. Cette pièce inouïe réunit toutes les formes du comique : partant de la farce, elle va jusqu’à déployer une interrogation incroyable sur la naissance à l’amour d’une jeune fille, Agnès, qu’on a rendue idiote et qui réussit à opérer une mutation extraordinaire par la seule force de son intériorité. Avec, en face d’elle, Arnolphe joué par Molière, qui est le premier de ses personnages de vrais fous qui cristallisent en eux les deux défauts que son rire ne va cesser d’inciser : la chimère et la marotte.
C’est-à-dire ?
La chimère, c’est voir le monde tel qu’il n’est pas avec une sorte d’illusion. C’est Arnolphe qui croit que tous les hommes sont trompés ou, dans Le Bourgeois gentilhomme, Monsieur Jourdain qui se prend pour un mamamouchi. La marotte, c’est réduire le monde à un seul élément. Ce sont des traits infiniment contemporains. Pendant une campagne présidentielle, la moitié des candidats sont dans la chimère – ils vous promettent ce qui n’est pas possible – et l’autre moitié sont dans la marotte, poursuivant une idée fixe censée tout résoudre. Molière connecte ces deux traits sous l’effet d’un rire qui sous-tend une vision du monde.
Pourquoi rire est-il si important pour lui ?
Parce que le ridicule lui permet de débusquer les erreurs du monde et d’en dégonfler les illusions. Il réalise ainsi la synthèse tant attendue entre les deux grands maîtres du théâtre latin, Plaute et Térence : le grossissement, qui caricature mais n’est pas vraisemblable, et la comédie souriante façon Corneille ou Marivaux, vraisemblable mais qui ne vous prend pas aux entrailles. Sa révolution copernicienne consiste à nous faire comprendre que lorsque nous rions de ce qui est protubérant sur scène, c’est en fait de nous que nous rions. Il déplace la difformité de la scène à la salle. Molière est l’homme du rire.
Quel genre de rire ?
Pas le rire cosmique de Rabelais, pas le rire corrosif de Céline. Un rire généreux et chaleureux, un rire qui pense. Face aux personnages négatifs, il compose des personnages qui donnent espoir en l’homme, comme Agnès, dont la transfiguration est une élévation vers le ciel de la culture, de la raison et de la délicatesse. Les êtres excessifs sont encadrés par ceux qui raisonnent et veulent prendre le temps de réfléchir. Par exemple, dans L’École des femmes, Chrysalde dit à Arnolphe : « Si n’être point cocu vous semble un si grand bien, / Ne vous point marier en est le vrai moyen » Ou dans Le Malade imaginaire, Béralde dit à son frère Argan : « Presque tous les hommes meurent de leurs remèdes, et non pas de leurs maladies. » Et puis il y a les servantes impertinentes et fortes en gueule et les valets qui amènent une chaleur d’indignation face à ceux qui déraillent.
Molière réalise la synthèse tant attendue entre les deux grands maîtres du théâtre latin, Plaute et Térence
Comment s’opposent ces caractères contradictoires ?
Molière opère un échantillonnage des différents types de folie en montrant les valeurs déformées par la manière dont ses personnages s’en emparent. Par exemple l’argent : cela peut être bien, mais quand vous êtes Harpagon, cela devient une valeur négative. La vertu peut être bonne mais, avec Alceste, elle devient excessive. La clé de cette anthropologie se trouve dans Le Misanthrope. Souvent, on pense que la pièce est binaire, Alceste contre Philinte, un type excessif mais vertueux et un autre qui s’accommode trop. En fait, non ! Cette pièce applique la théorie ternaire de L’Éthique à Nicomaque d’Aristote : une vertu, c’est le contraire de deux défauts extrêmes. Le courage, ce n’est pas le contraire de la pusillanimité, c’est le contraire de la pusillanimité et de la témérité. La leçon est donnée par Philinte : les valeurs ne sont rien en soi, elles n’existent pas en dehors de leur usage. Vous pouvez toujours clamer : « Démocratie ! République ! Laïcité ! », c’est l’application qui fait tout. Pour La Fontaine, c’est la même chose. Ses fables sont l’adaptation des valeurs universelles aux situations particulières. J’ajoute qu’il ne faut pas oublier la part personnelle que Molière met dans les indignations d’Alceste. Il devait être, pour une part, Alceste, tout en aspirant à devenir Philinte.
Pourquoi certaines pièces comme Tartuffe ont-elles traversé les siècles ?
Le personnage de Tartuffe n’est qu’un artifice qui permet de révéler la nature profonde d’Orgon, le premier personnage de fanatique tel qu’analysé à l’époque en Angleterre par John Locke. Le faux dévot monte Orgon comme une mécanique pour mieux le détruire de l’intérieur. La grande question posée par la pièce, c’est comment peut-on casser la mécanique du fanatisme ? Comment faire surgir l’évidence, le vieux concept cartésien d’evidencia, la chose qui, en un éclair, dissipe l’illusion. Quand Orgon est sous la table et qu’il voit Tartuffe corrompre sa femme, ça ne lui suffit pas. Il lui faut entendre Tartuffe dire de lui : « C’est un homme à mener par le nez. » Il réalise enfin qu’on se paie sa tête.
Et L’Avare ?
Harpagon est intéressant dans la mesure où il est un personnage hérité d’une Antiquité qui thésaurise mais il est en même temps un capitaliste, un usurier qui prête sur gage. Sa cassette est une incarnation symbolique de l’aliénation que constitue l’appétit d’argent. Se croyant libre, Harpagon est aliéné. Sa cassette, c’est la boîte noire de sa folie. Il y a dans les personnages de Molière cette obsession de la perte, du vide, du vieillissement : Argan et la peur de mourir, Arnolphe voulant épouser une femme beaucoup plus jeune que lui. Dans ce monde qui était encore très catholique, le paradis ne suffisait cependant plus à supporter l’idée que tout va finir. Ce désir d’arrêter le flux du monde parle à notre époque.
Comment voir Dom Juan aujourd’hui ?
C’est une pièce très évocatrice pour quelqu’un qui a vécu les années 1970 et qui voit le retour du puritanisme. Il y a l’ambivalence de ce personnage très sexué qui est en même temps un monstre et un bon « dégourdisseur » de sottises. Il y a aussi quelque chose de stupéfiant dans la pièce, entre la beauté du personnage d’Elvire, très « #MeToo », et la séduction qui émane du personnage de Dom Juan. Molière aborde la question du désir et de son illusion, de la satisfaction impossible du fait que la vie nous mène, au grand galop, vers la mort.
Quelle idée se fait-il des femmes ?
Il met en avant la beauté de leur caractère, leur rationalité et leur finesse, leur capacité de l’emporter sur ces imbéciles de bonshommes qui sont toujours dans l’excès. Molière aimait les femmes pour la liberté qu’elles prenaient sous sa plume. Il y a une part autobiographique : il avait épousé une femme beaucoup plus jeune que lui, Armande Béjard, et qui, visiblement, l’éblouissait. Il n’y a rien de plus bête que cet antiféminisme qu’on lui prête.
Comment jugez-vous sa langue ?
Elle est venue jusqu’à nous parce qu’elle a été écrite par un comédien qui était en même temps un poète. C’est une langue qui porte en elle une musique plus forte que sa syntaxe. En dehors de certains tunnels de rationalité que, moi, j’adore mais que le public peut trouver longuets, vous écoutez à peine ce que les gens ont à dire et vous suivez parfaitement. À sa mort, sa veuve avait fait versifier Dom Juan par Thomas Corneille. La pièce a été jouée avec ces vers de mirliton jusqu’en 1830, c’était totalement soporifique. La force de Dom Juan tient aussi à son langage vif, effervescent, déjà brechtien.
Parle-t-il uniquement aux Français ?
Non, il a une aura comparable à Shakespeare. D’abord il est très traduisible parce qu’il a écrit souvent en prose et que ses vers sont facilement transposables. Et le rire est sans doute plus universel que les pleurs et le tragique. Malgré la langue du XVIIe siècle, Molière peut tenir alors que Racine et Corneille, c’est plus difficile. Il a l’avantage d’être en même temps classique et comique. C’est un peu comme les fables de La Fontaine ou les contes de Perrault. Même quand on ne comprend pas totalement le texte, on sait de quoi ça parle.
Propos recueillis par ÉRIC FOTTORINO & PATRICE TRAPIER
dessin ERNEST PIGNON-ERNEST
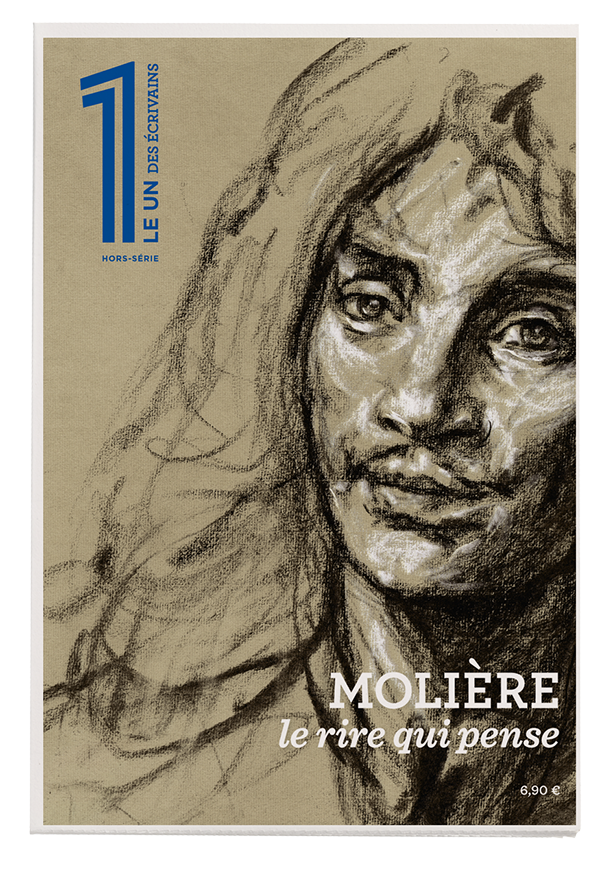
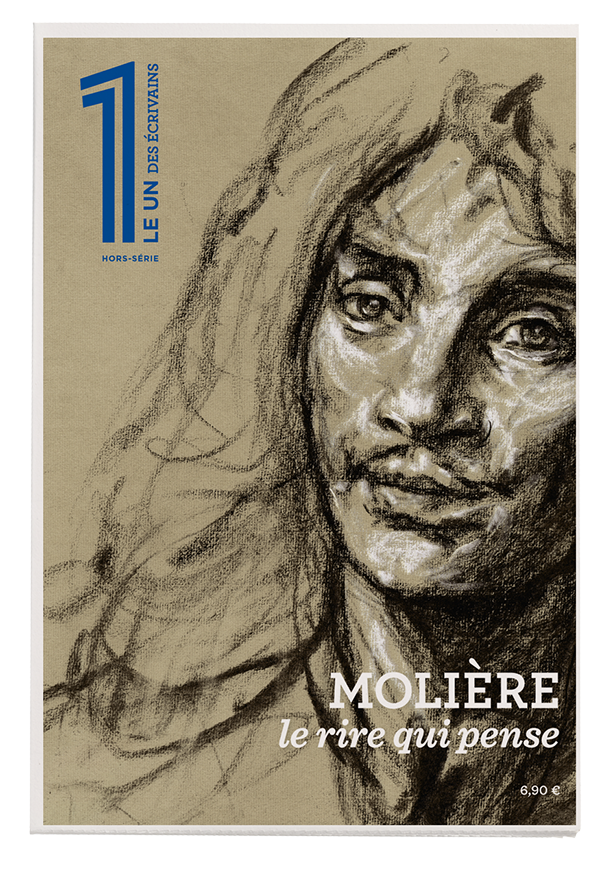
« Son rire ne va cesser d’inciser deux défauts, la chimère et la marotte »
Patrick Dandrey
Patrick Dandrey, spécialiste de la littérature du XVIIe siècle, analyse le talent comique du comédien et dramaturge, entre Chaplin et de Funès, ainsi que la profondeur de son inspiration. Molière se servait du rire pour « débusquer les erreurs et les illusions du monde ».
Derrière la légende
Georges Forestier
La figure de Molière fait partie intégrante de notre patrimoine et pourtant on ne sait presque rien de lui. Faute d’archives, nous explique son biographe Georges Forestier, une fiction s’est construite à partir des personnages que l’artiste a imaginés et incarnés : jaloux, hypocondriaque, atrabil…
Derrière la légende
Georges Forestier
La figure de Molière fait partie intégrante de notre patrimoine et pourtant on ne sait presque rien de lui. Faute d’archives, nous explique son biographe Georges Forestier, une fiction s’est construite à partir des personnages que l’artiste a imaginés et incarnés : jaloux, hypocondriaque, atrabil…







