« Un sens du rythme qui lui est propre »
Temps de lecture : 5 minutes
En classe de quatrième, j’ai joué la première scène des Fourberies de Scapin, je m’en souviens encore. Ce fut un coup de bol parce qu’au milieu de cette année, je suis parti en Angleterre, et alors là, terminé Molière ! À l’époque, je ne pensais pas du tout être acteur, j’en étais à des années-lumière, mais ce texte m’avait plu spontanément.
Je l’ai retrouvé bien plus tard au cours Florent, avec la grande scène entre Tartuffe et Elmire : « Ah ! pour être dévot, je n’en suis pas moins homme. » J’avais un professeur qui n’était peut-être pas un grand maître, mais un très bon accoucheur. C’est la première fois que j’ai pleuré en scène, j’ai vraiment fondu en larmes.
J’ai ensuite retrouvé Tartuffe avec le rôle d’Orgon, que j’ai présenté plusieurs fois en concours. En deuxième année, je me suis vautré Rue Blanche [l’École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre], je faisais un Orgon surexcité, soi-disant amoureux de Tartuffe, un contresens absurde ! Et puis, à un moment, mon professeur, Raymond Acquaviva, m’a dit : « Toi, tu es Orgon, tu vas rentrer au conservatoire avec ce rôle. » Je lui ai répondu que je m’étais déjà planté, il n’en a pas démordu. Nous avons travaillé pendant un cours, la classe pleurait de rire, c’était devenu une évidence. Plus tard, un professeur du conservatoire, Stuart Seide, m’a expliqué que mon Orgon n’était pas assez sincère avec Célimène, que je jouais le pouvoir et la mondanité, mais que les vrais enjeux de la scène étaient ailleurs. Et c’était soudain plus intéressant. Tout cela pour dire à quel point Molière se travaille lentement, dans la profondeur.
Molière, en répétition, qu’est-ce que c’est ardu ! J’ai un mal fou à apprendre sa prose parce que je n’ai pas fait de latin, je n’ai pas le réflexe des déclinaisons, cette gymnastique inhérente à sa langue. Autant Tchekhov et Feydeau, je les lis deux fois et je les connais. Autant Molière, je mets beaucoup de temps à le digérer, mais une fois que je l’ai, c’est pour longtemps. Sa langue est difficile à intégrer, mais pas du tout à donner. C’est évident, il n’est pas que cérébral. Il faut le jouer, bouger pour que ça rentre dans le corps. C’est vraiment une langue pour le théâtre.
Molière a un sens du rythme qui lui est propre. Quelqu’un me répétait un jour cette sottise selon laquelle Corneille aurait écrit la moitié de ses pièces. « Alors là, cher monsieur, je m’inscris en faux, lui ai-je répondu. Pour avoir joué les deux, je sais qu’avec leurs textes, on ne respire pas de la même manière. Pratiquement tout Corneille, vous respirez sur un rythme similaire : 3-3-3-3. Avec Molière, vous respirez d’une autre façon, bien plus diversifiée. Cela change tout. »
J’ai toujours été très ému par le rôle d’Agnès dans L’École des Femmes, elle me bouleverse. Que ce soit Isabelle Carré dans la mise en scène de Jean-Luc Boutté – avec cette idée magnifique : quand Agnès et Horace se rencontrent, ils ont d’abord un fou rire, ils rougissent – ou Adeline d’Hermy, dont la palette de jeu est exceptionnelle, dans la mise en scène de Jacques Lassalle… Et puis Isabelle Adjani, évidemment, à travers les captations. Elle avait 17 ans, elle passait son bac et révisait entre deux scènes. Denise Gence l’appelait : « Isabelle, c’est bientôt à toi », elle lâchait ses cahiers et se retrouvait sur le plateau, bouleversante. Elle avait la musique du texte en elle. Cette candeur pour parler de l’adolescence, l’éveil des sens et puis « le petit chat est mort » ! Eh bien, oui, quoi qu’on en dise, c’est une vraie nouvelle. Et le retournement à la fin, quand elle dit : « Croit-on que […] je ne juge pas bien que je suis une bête ? » Vous m’avez enfermée dans l’ignorance et vous pensez que je ne le sais pas ? Allons, qu’on arrête d’expliquer que Molière était misogyne !
En homme, il y a Argan dans Le Malade imaginaire, que je joue et qui me bouleverse. Il se trouve que j’avais un frère hypocondriaque, qui était sous camisole chimique depuis trente ans et qui est décédé en 2020 la veille de la captation de la pièce. En répétant, je me disais, c’est fou, je joue mon frère. J’étais interloqué par l’étendue des connaissances de Molière sur les pathologies. Il a tout compris des hypocondriaques, de leur nécessité de vider l’espace autour d’eux, d’être au centre de tout. Quand on pense à la fameuse scène entre Béralde et Argan, que Molière jouait, c’est confondant. À un moment, Argan s’attaque à Molière qui calomnie les médecins : « Et je lui dirais : “Crève, crève ; cela t’apprendra une autre fois à te jouer de la Faculté.” » À chaque fois que je prononce ces mots, je pense que Molière est mort après quatre représentations, quatre fois où il s’est souhaité la mort à lui-même. C’est une incroyable mise en abyme.
Molière est notre contemporain parce qu’il parle des passions humaines qui ne changent pas, des monstres qui s’attachent à nous. Ce ne sont pas des monstres philosophiques comme Shakespeare, c’est très concret : j’ai mal, j’ai peur de vieillir ; mon pognon, ils vont tous me le piquer… De ce point de vue, il est génial, il a une connaissance absolument intemporelle de nos passions minables ou magnifiques. Si vous saviez le nombre de gamins qui, après Les Fourberies de Scapin, sont persuadés que le texte a été changé. Or, pas un mot !
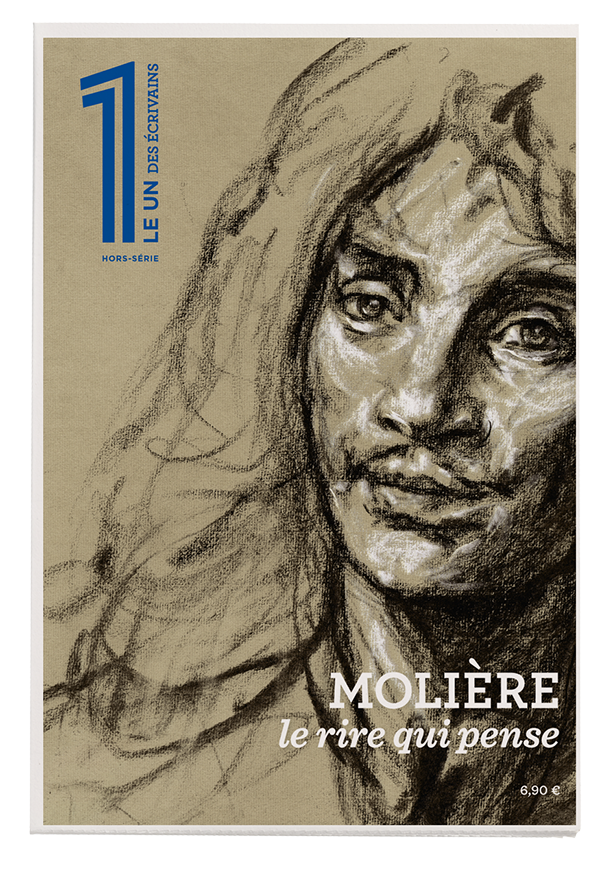
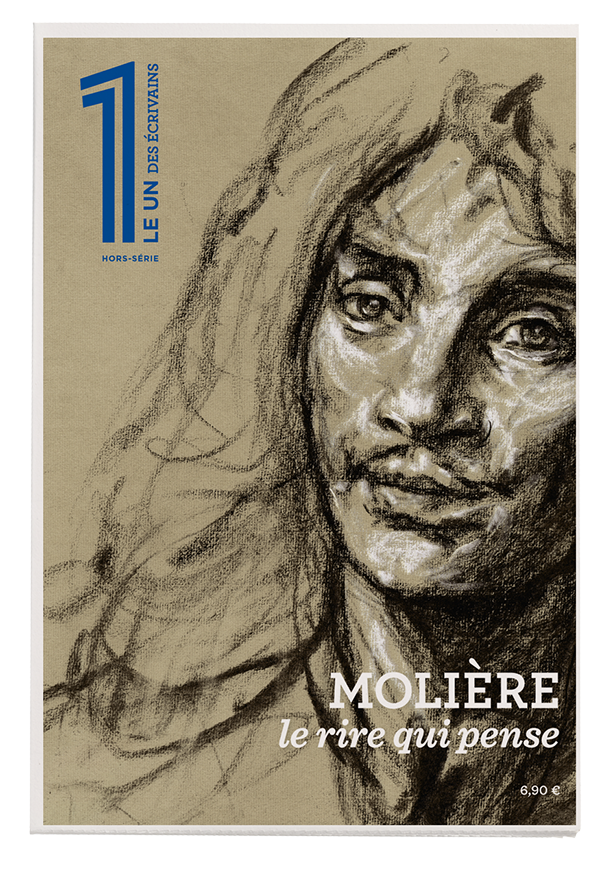

« Son rire ne va cesser d’inciser deux défauts, la chimère et la marotte »
Patrick Dandrey
Patrick Dandrey, spécialiste de la littérature du XVIIe siècle, analyse le talent comique du comédien et dramaturge, entre Chaplin et de Funès, ainsi que la profondeur de son inspiration. Molière se servait du rire pour « débusquer les erreurs et les illusions du monde ».
Derrière la légende
Georges Forestier
La figure de Molière fait partie intégrante de notre patrimoine et pourtant on ne sait presque rien de lui. Faute d’archives, nous explique son biographe Georges Forestier, une fiction s’est construite à partir des personnages que l’artiste a imaginés et incarnés : jaloux, hypocondriaque, atrabil…
Derrière la légende
Georges Forestier
La figure de Molière fait partie intégrante de notre patrimoine et pourtant on ne sait presque rien de lui. Faute d’archives, nous explique son biographe Georges Forestier, une fiction s’est construite à partir des personnages que l’artiste a imaginés et incarnés : jaloux, hypocondriaque, atrabil…







