« Scapin, une farce et une pièce crépusculaire »
Temps de lecture : 5 minutes
J’étais enfant, mon frère Bruno était membre du club théâtre du lycée Hoche, à Versailles, il m’a demandé de jouer le petit Carle, le valet du valet dans Les Fourberies de Scapin. C’est ainsi que j’ai découvert ce qu’était une pièce de théâtre. Je me souviens de mon étonnement devant les noms des personnages et, sous ces noms, les mots qu’ils avaient à prononcer. Ces mots, je les voyais comme des parts de gâteau. Scapin en avait une grosse part, et j’avais dû chercher longtemps la toute petite part de Carle. Molière est pour moi indétachable de cette expérience primitive. Même si je sais sa part sombre et tragique, je l’associe spontanément à la naissance idéalisée du théâtre, avec les tréteaux de foire et les tournées en province. Molière est une clé de ma vocation.
Ma deuxième pièce au Français, c’était encore Scapin, dans la mise en scène de Jean-Louis Benoît. Je jouais le rôle d’Octave, le jeune homme qui ouvre la pièce ; la première scène est très difficile, les répliques sont de quasi-alexandrins qui d’abord sonnent abstraits : « Ah ! fâcheuses nouvelles pour un cœur amoureux ! » Plus tard, quand j’ai mis en scène la pièce, nous avons repris cent fois cette scène, qui est à la fois tragique et comique. Des jeunes gens tourmentés sont pris au piège de mariages que veulent leur imposer leurs pères. Autant comme acteur que comme metteur en scène, j’étais ému par la détresse d’Octave. On commet souvent l’erreur d’être si fort attiré par la puissance comique de Molière qu’on en néglige la force dramatique qui se dégage de ces jeunes gens, amoureux éperdus qui ne demandent qu’à épouser qui ils aiment.
Ce rire mêlé de tragique, c’est une thèse qui a été développée, notamment, par le poète et critique Michael Edwards qui, dans Le Rire de Molière, rapprochait en 2012 celui-ci du rire de Shakespeare. Ce rire n’est pas sarcastique, c’est un rire de gaieté mû par le désir de voir la vie autrement qu’elle n’est, alors qu’au début des pièces, la réalité est noire, horrible. C’est un rire qui réclame la conscience du tragique pour mieux l’éclater. Michael Edwards met l’accent sur le personnage de Zerbinette dans Scapin. Cette Égyptienne a été enlevée, sans doute torturée et violée mais, finalement, gagne sa liberté, sa puissance, en révélant son génie de conteuse, sa capacité à s’emparer de la vie malgré tout.
Molière possédait une grande énergie, ce qui n’empêche ni la mélancolie ni le caractère soucieux d’un directeur de théâtre, qui plus est auteur et directeur d’une compagnie, essayant de satisfaire les uns et les autres, inféodé à la cour, devant sans cesse aller au-devant des désirs du roi et ne travaillant pas toujours dans des conditions aisées, jamais libre en fait. Il compensait ces difficultés par l’énergie qu’il mettait dans ses pièces, les saillies, les répliques, les dialogues pleins de verve. Molière réclame une virtuosité musicale. Ces vifs échanges, il faut les exécuter avec un maximum de maîtrise et d’abandon, dans une inconscience des effets. Que le langage puisse atteindre à une telle folie est vertigineux !
Scapin, c’est une farce et une pièce crépusculaire. La mort y est présente à chaque scène. À la fin, Carle entre en scène pour dire : notre pauvre Scapin s’est fracassé la tête (situation que Rostand a reprise dans Cyrano). On sait que Scapin fut pour Molière un échec, il ne l’a joué que dix-huit fois. Je prends pour hypothèse qu’il n’avait plus l’énergie nécessaire. Il a présumé de sa force dans un rôle qui en demande beaucoup. Quand j’ai monté Scapin, j’ai vu certains soirs Benjamin Lavernhe, qui interprète son rôle, commencer la pièce fatigué et ne pas savoir comment il allait la terminer.
Avec Les Fourberies de Scapin, Molière a repris la farce, une forme qu’il avait abandonnée au profit des grandes comédies de mœurs comme Le Misanthrope. Cela a suscité une incompréhension. Nicolas Boileau, par exemple, s’en est trouvé consterné, ne comprenant pas la profondeur de la pièce. Molière y a pourtant mis tout son art d’acteur pour mieux interroger le théâtre et son pouvoir. C’est un autoportrait en acte, un peu suicidaire, mais dans lequel il se livre à la postérité.
Harpagon est le rôle qui m’a donné le plus de jouissance en scène, c’était une ivresse. J’ai eu des soirs de liesse, les scènes se succédaient, je sentais que la salle m’accompagnait totalement, j’avais le sentiment d’accomplir pleinement ma vocation, de faire ce que j’avais rêvé de faire et de le faire encore mieux que dans mes plus beaux rêves.
J’ai connu cela et j’ai connu aussi des moments de cauchemar en jouant Alceste. J’avais le sentiment d’être en deçà du rôle et de la pièce. Jean-Pierre Miquel, le metteur en scène, m’avait fait pleinement confiance, il m’avait laissé libre, avec un seul impératif : il ne fallait pas que je crie, que je m’énerve. Jean-Pierre rapprochait Alceste de quelqu’un comme Roland Barthes, un intellectuel qui s’écarte du monde sans furie. C’était très intéressant en soi. Mais moi, je n’avais pas cette confiance.
Chaque fois, j’avais l’impression d’être absorbé par la dépression du personnage. La dimension comique, la folie théâtrale m’échappaient. Il aura fallu l’œil des caméras, à l’occasion d’une captation, pour que je commence à retrouver la joie de jouer cette pièce que j’adore. J’ai compris plus tard qu’une chose m’obsédait : je m’étais persuadé qu’il fallait être une force de la nature pour jouer Alceste, ce qui correspond à la tradition théâtrale, une voix, du feu, beaucoup d’humeur… Il est arrivé à mes professeurs de me contester cette densité, j’étais cantonné dans les rôles de raisonneurs ou les jeunes premiers un peu lunaires. C’est en dialoguant avec Jacques Weber – qui, pour le coup, ne manque pas de puissance –, en jouant à s’échanger les rôles d’Alceste et de Philinte, que j’ai liquidé les questions qui me torturaient vingt ans auparavant. Au fond, Alceste et Philinte ne font qu’un, nous avons chacun en nous une part de l’un et de l’autre.
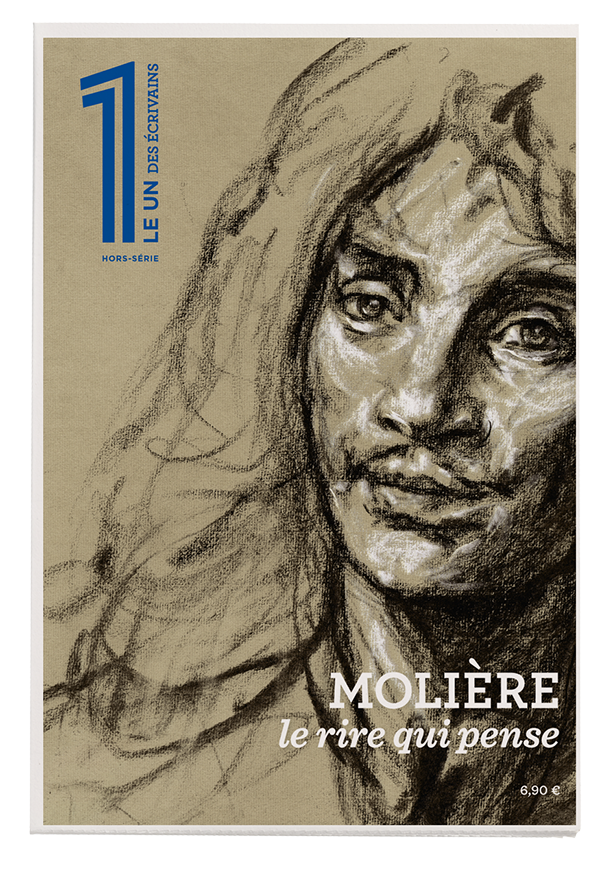
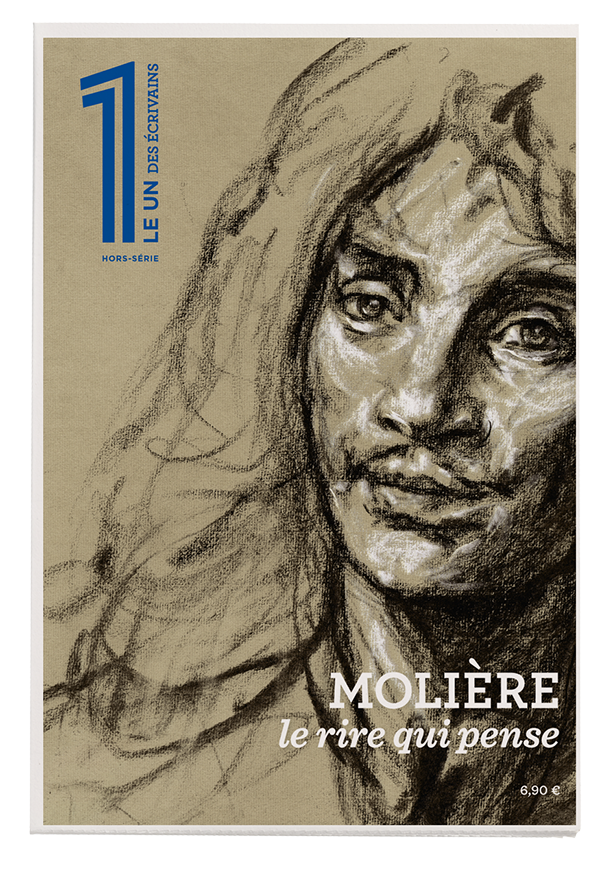

« Son rire ne va cesser d’inciser deux défauts, la chimère et la marotte »
Patrick Dandrey
Patrick Dandrey, spécialiste de la littérature du XVIIe siècle, analyse le talent comique du comédien et dramaturge, entre Chaplin et de Funès, ainsi que la profondeur de son inspiration. Molière se servait du rire pour « débusquer les erreurs et les illusions du monde ».
Derrière la légende
Georges Forestier
La figure de Molière fait partie intégrante de notre patrimoine et pourtant on ne sait presque rien de lui. Faute d’archives, nous explique son biographe Georges Forestier, une fiction s’est construite à partir des personnages que l’artiste a imaginés et incarnés : jaloux, hypocondriaque, atrabil…
Derrière la légende
Georges Forestier
La figure de Molière fait partie intégrante de notre patrimoine et pourtant on ne sait presque rien de lui. Faute d’archives, nous explique son biographe Georges Forestier, une fiction s’est construite à partir des personnages que l’artiste a imaginés et incarnés : jaloux, hypocondriaque, atrabil…







