Une irréductible diversité
Temps de lecture : 6 minutes
Tout est chamboulé. L’observateur qui se hasarderait, au lugubre mois de juillet 1940, à pronostiquer qui va rejoindre la Résistance et qui la Collaboration vichyste ou parisienne, s’exposerait, un ou dix ans plus tard, à brûler ses notes, le rouge au front, pour effacer toute trace de ses divagations. Longtemps, il y aura plus d’anciens dirigeants socialistes à Vichy, autour de Pétain, qu’à Londres, avec de Gaulle. Le Komintern stalinien ayant défini la guerre comme impérialiste et se méfiant du général français réfugié à Londres et vendu à la City, les communistes français sont à la traîne. Cet été 1940, le mauvais Duclos est Jacques, numéro 2 du PCF, qui, sur ordre de Moscou, va ouvrir des négociations avec l’occupant pour obtenir la reparution de L’Humanité, et le bon Duclos est Maurice, son contraire en tout point, même physiquement (il mesure près de deux mètres) qui se présente devant de Gaulle le 1er juillet 1940, ancien de la Cagoule, la très antipathique organisation secrète d’extrême droite, responsable d’attentats et d’assassinats, et qui sera un résistant magnifique – tout comme Jacques, d’ailleurs, mais celui-ci avec un petit temps de retard.
Cette irréductible diversité, c’est le charme de la Résistance. Elle exaspère maints historiens qui n’aiment rien tant qu’étiqueter et catégoriser. Résistant, le général Cochet, grand admirateur du franquisme, « merveilleuse synthèse de haute politique et de pensée chrétienne », on voit le genre, et résistant itou l’ancien mutin de la mer Noire Charles Tillon, communiste farouche, qui appellent l’un et l’autre dès le 17 juin à continuer la lutte. A-t-on jamais vu dans notre histoire une aventure collective présentant pareille disparate humaine ? Le lieu symbolique de ces rencontres peu prévisibles pourrait être la clairière du Mont-Valérien. Tillon et Cochet sortiront de la guerre aussi inconciliables qu’ils y sont entrés, mais, le temps de la lutte, ils acceptent d’être fusillés côte à côte. Ce n’est pas rien.
Il y a le roman national, dont la Résistance constitue à coup sûr le chapitre le plus singulier, et il y a les résistants, dont chacun est un roman.
Même difficulté pour classer les mouvements. On dira que Combat, créé par Henri Frenay, se situait plus à droite que le Libération de d’Astier de la Vigerie ou le Franc-Tireur de Jean-Pierre Lévy. C’est vrai au niveau des directions. À la base, le hasard des rencontres préside au recrutement. L’Organisation civile et militaire (OCM), puissant mouvement de zone nord, est dirigée par des grands bourgeois du XVIe arrondissement de Paris. Dans le Nord et le Pas-de-Calais, elle est largement populaire : ouvriers, cheminots, enseignants. Cette hétérogénéité sociale n’accordera à l’OCM qu’une brève espérance de vie après la Libération.
Une Résistance masculine ? Les hommes voudraient bien et s’efforcent de confiner les femmes dans des tâches subalternes. Elles se révèlent indispensables. À la fin de l’Occupation, on ne pourra plus leur refuser le droit de vote.
Le bonheur de résister, trop souvent méconnu. Exclus de la guerre par l’armistice de Pétain, les Français étaient devenus des objets de l’Histoire. L’entrée en résistance leur restitue la dignité de sujets. Il suffit de remettre sa vie en jeu et surtout de prendre le risque de parler sous la torture, perspective tenue par beaucoup pour pire que la mort.
Les jeunes historiens s’emploient à évaluer sans lunettes roses le poids militaire de la Résistance. Ils ont raison. C’est important. Mais non essentiel. La Résistance étant une question d’honneur, son intérêt ne se mesure pas au nombre de sous-préfectures libérées par les maquis. Cela dit, relisons Eisenhower : l’excellence des renseignements fournis aux Alliés avant le Débarquement, opération stratégique la plus périlleuse de la guerre, justifierait à elle seule l’existence de la Résistance.
La victoire en 1945, et puis un entracte de neuf ans et la représentation reprend, mais le théâtre est différent et les acteurs ont changé de rôles. « L’heure du crime, écrit Cioran, ne sonne pas en même temps pour tous les peuples. Ainsi s’explique la permanence de l’histoire. » L’heure sonne pour la France et le crime va durer huit ans. Une flopée de compagnons de la Libération s’illustre en Algérie par la répression implacable d’un peuple qui souhaite accéder à l’indépendance. Nos héros ont endossé la tenue des bourreaux. Pour parachever la sinistre farce, l’OAS se proclame Résistance ; son chef politique, Georges Bidault, qui succéda naguère à Jean Moulin à la tête du Conseil national de la Résistance, crée un CNR fantoche et le colonel Bastien-Thiry, maladroit organisateur de l’attentat du Petit-Clamart qui devait tuer de Gaulle, se compare à son procès au colonel Stauffenberg, maladroit organisateur de l’attentat qui aurait dû tuer Hitler le 20 juillet 1944, ce qui tend, non sans audace, à suggérer que les deux cibles présentaient une nocivité comparable.
De 1954 à 1962, ceux qui sont restés fidèles à l’esprit de la Résistance ne sont-ils pas les militants français qu’on appelait les « porteurs de valises », engagés aux côtés des Algériens ?
« Résister est un verbe qui se conjugue au présent », répétait sans se lasser la grande Lucie Aubrac aux collégiens et lycéens qu’elle rencontra par milliers. Ils en restaient interloqués. Ils s’attendaient à écouter une dame sortie d’une image d’Épinal pour leur raconter des vieilles histoires, et ils se voyaient bombardés de questions dérangeantes. Le temps passant, il devient de plus en plus évident qu’il fallait résister jadis et naguère. Au présent, c’est plus difficile. Mais refuser de choisir n’est-il pas toujours un mauvais choix ?


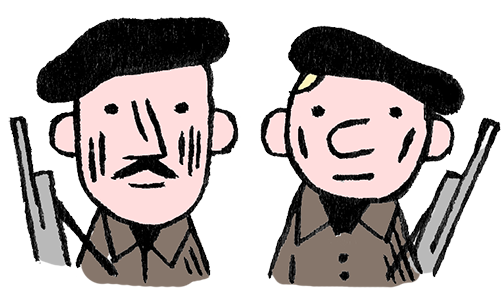
« Nous sommes passés de la sacralisation au désenchantement »
Pierre Nora
Le président de la République a décidé d’honorer la mémoire de quatre figures de la Résistance. Il aurait pu retenir Olympe de Gouges, George Sand ou encore Michelet comme vous l’aviez proposé. Qu’est-ce que ce choix nous …
Obéissance
Robert Solé
Je résiste, tu résistes, il résiste… On peut résister à la chaleur, à la faim ou à la douleur. Résister à l’envie de fumer ou de flanquer une gifle à un malotru. Résister au changement ou à l’ai…
Oui au Non
Michel Onfray
Résister, c’est dire non dans un monde où tout nous invite à dire oui.
Résistant, le philosophe Diogène de Sinope qui, rencontrant Alexandre le Grand dans sa superbe, dit au maître de l’empire qui lui demandait n’importe que…







