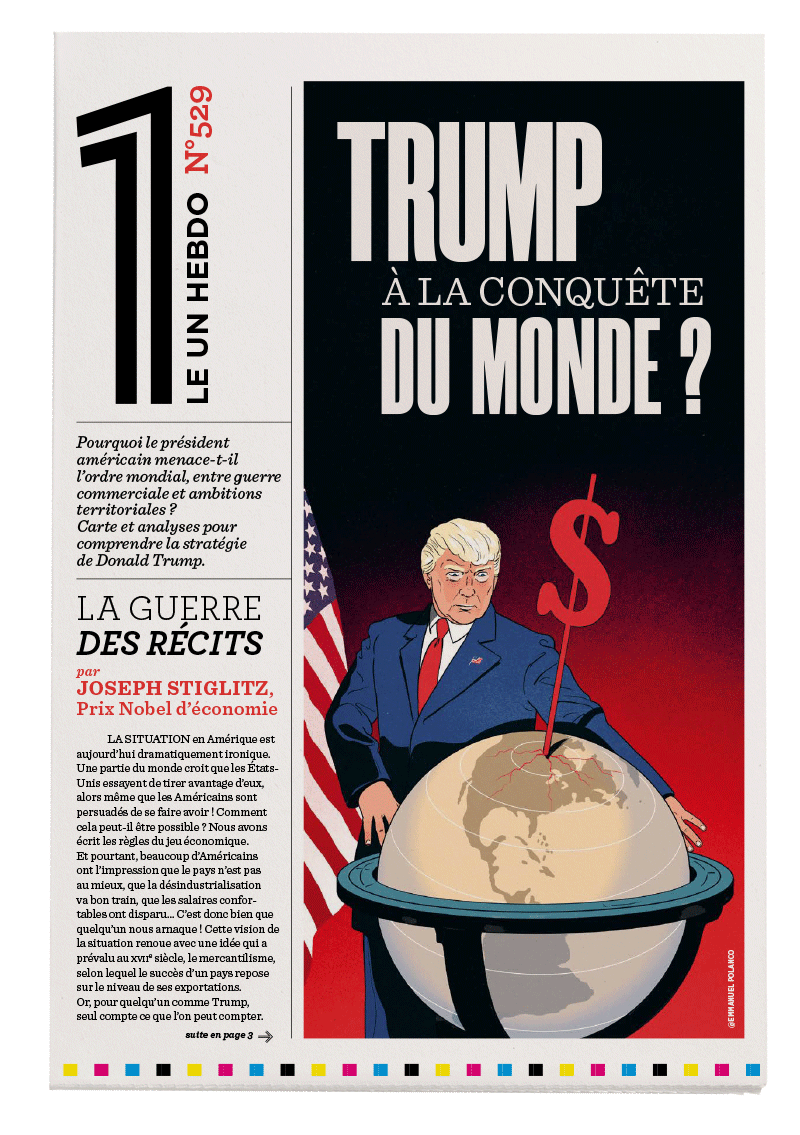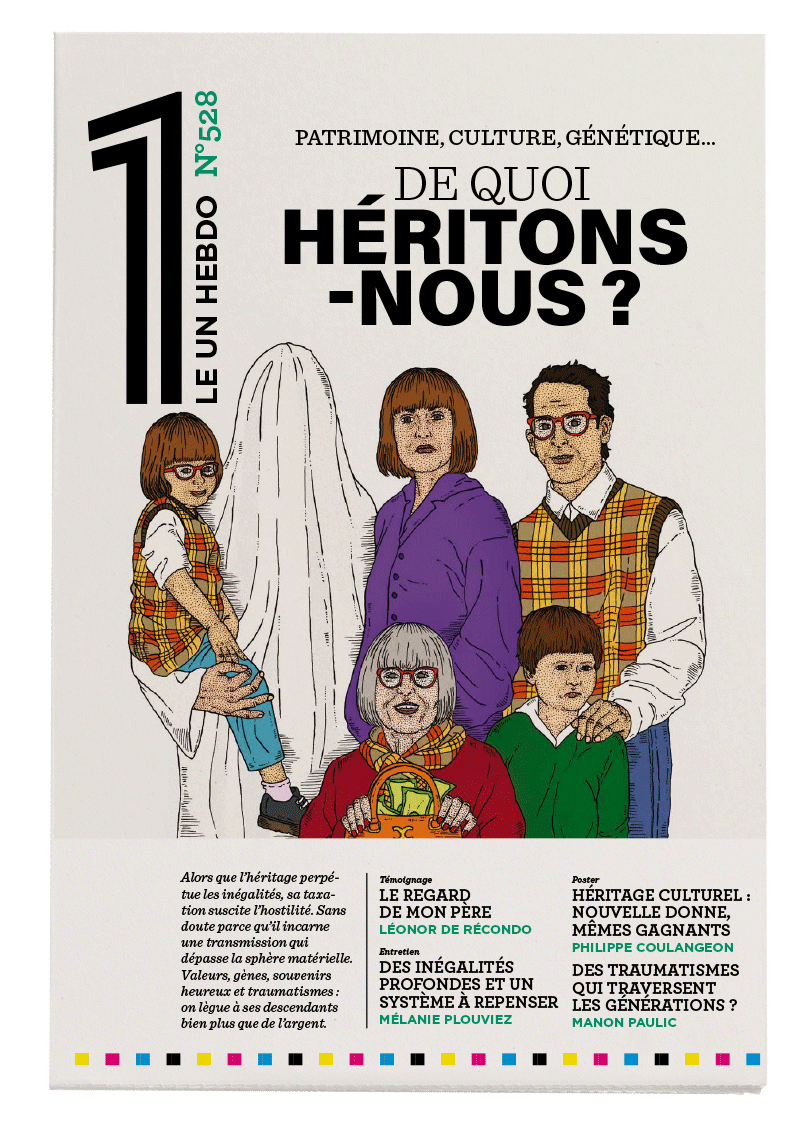« Relisez Noces de Camus ! »
Temps de lecture : 12 minutes
Comment définir la culture ?
Pour moi, l’important, c’est qu’elle soit mobile. Qu’elle soit le contraire d’un trésor fixé, figé, enfermé dans un coffre. Sa valeur ne tient pas du tout à sa brillance ni à sa rareté. Au contraire. J’aimerais insister sur le fait que la culture est mouvement.
C’est ce qu’on voit actuellement en Europe : l’ancienne culture européenne fondée sur les Lumières, la philosophie, les musées, est troublée par un nouvel ordre qu’on pourrait facilement assimiler à la barbarie si on se laissait aller, comme ces partis politiques qui misent sur les différences ethniques et sont très enclins à dénoncer la menace des barbares à nos portes. Je vois même des magazines qui annoncent la chute de l’Occident, comme si nous étions entourés de barbares qui ne demandent qu’une chose : entrer dans la ville pour piller, se faire payer en or et en chair. C’est une vision aberrante.
Avez-vous toujours pensé la culture comme mobile, en mouvement ?
Oui. Je suis moi-même issu d’une culture très mélangée puisque mon père était britannique et que nous étions originaires de l’île Maurice.
Nous avions donc sans arrêt des informations qui nous arrivaient d’un autre point du monde. Mes lectures, ce n’était pas Le Monde, ce n’était pas Le Figaro, c’était Le Mauricien. Et avoir la vision de ce journal quand on vivait à Nice, c’était assez particulier ! Ce décalage a favorisé chez moi l’idée que la culture n’est pas unique, mais plurielle. Selon le point de vue où vous vous placez, elle n’a pas la même signification.
Je me souviens qu’après la cérémonie du prix Nobel, nous avons tous été réunis pour discuter de la crise économique. Il y avait des économistes, des chimistes, des biologistes. Après les avoir écoutés, j’ai dit : « Vous savez, la crise économique que vous dénoncez en ce moment, nous la vivons depuis longtemps à l’île Maurice. Et en Afrique, on la vit quasiment depuis toujours. On y vit toujours dans l’à-peu-près, sans être sûr de pouvoir survivre le lendemain. » Cela ne les a pas intéressés du tout ! J’ai dû passer pour un radical tiers-mondiste.
Certains veulent justement faire croire qu’il y a des cultures supérieures à d’autres. Que leur répondez-vous ?
Je suis absolument hostile à toute hiérarchisation des cultures. Je suis convaincu qu’une grande partie des problèmes relationnels de l’Europe avec le reste du monde vient de là. Nous tendons à imposer des modes de vie et des modes d’analyse qui ne sont pas nécessairement ceux des autres.
Ce qu’on appelle une culture, c’est une perfection en fin de compte. Et cette inclination à la perfection est multiforme, elle existe dans toutes sortes de sociétés. Votre idée de la culture et de la beauté n’est peut-être pas la mienne, mais ce n’est pas pour cela qu’elle n’est pas la bonne.
Qu’est-ce qui vous a d’abord touché dans la culture ?
La beauté… L’art des Amérindiens me touche énormément. J’aurais du mal à expliquer pourquoi. J’ai découvert cet art quand j’avais une dizaine d’années. Mon frère et moi avons reçu en cadeau lui un livre sur la culture égyptienne, moi sur la culture maya. J’ai reçu un très grand choc en découvrant les images des temples et la description des cérémonies, l’évocation de la puissance culturelle du peuple maya. Mon frère a eu le même choc avec la culture égyptienne. Du reste, il a vécu en Égypte et au Soudan. Et je me suis retrouvé plus tard au Mexique !
Je crois que ces chocs comptent beaucoup étant enfant… et ce sont des chocs esthétiques avant tout. L’architecture, la construction des monuments consacrés à l’astronomie, les masques... Enfant, j’aimais beaucoup l’astronomie. Découvrir qu’un peuple s’est consacré à l’étude du ciel, à la pronostication des éclipses et des mouvements des astres, cela me parlait vraiment.
Avez-vous aussi été marqué très jeune par des romans, des auteurs ?
J’ai beaucoup aimé lire Don Quichotte. C’était mon livre quotidien quand j’étais enfant, sans me douter que c’était un classique. Je l’ai lu dans une belle édition avec les illustrations de Gustave Doré. Pour moi, ce n’était pas un roman espagnol. Et je me souviens m’être promené dans la vieille ville de Nice après avoir lu certains passages. À l’époque, la communauté gitane habitait sur une esplanade, dans des caravanes. Ils cuisinaient dehors et je me disais : c’est cela que décrit Cervantès, ce monde assez pittoresque et coloré, avec de la musique, de jolies femmes, des matrones, des hommes tatoués avec des anneaux dans les oreilles.
La nature a-t-elle représenté un autre choc, notamment durant les deux ans que vous avez passés en Afrique pendant votre enfance ?
Cela me paraissait naturel. Ce qui ne me semblait pas naturel, c’était de revenir ensuite en France, dans un milieu sec où les arbres ne sont pas omniprésents, où les éléments ne sont pas très présents, où on ne sent pas beaucoup le soleil. En France, les pluies sont de gentilles petites pluies, ce ne sont pas des déluges qui forment des rivières en quelques instants… Je crois que les enfants s’adaptent plus facilement à l’excès qu’à l’ordinaire.
J’ai gardé un souvenir assez émerveillé des orages africains, comme s’ils étaient des œuvres d’art que donnait la nature.
Il vous arrive d’évoquer un modèle créole de la culture. De quoi s’agit-il ?
C’est une référence à l’écrivain Édouard Glissant pour qui les sociétés insulaires, en particulier les Antilles, ont cent ans d’avance sur les métropoles, car leurs populations savent depuis plus longtemps que nous comment on vit ensemble. Ils se supportent, pratiquent les mariages intercommunautaires, s’acceptent. C’est ainsi qu’ils sont en avance par l’expérience.
En France, on est en retard. La présence de l’immigration visible est assez récente. Dans mon enfance à Nice, les Nord-Africains étaient déjà nombreux, mais on les voyait moins. Ils étaient relégués dans des quartiers isolés. Ils ne parlaient pas, on ne les entendait pas. Ils ne réclamaient rien. Leurs enfants, eux, n’ont pas accepté de courber la tête. Et ce ne sont plus des immigrés. Juridiquement, ce sont des Français à part entière. Ils refusent la discrimination et l’hostilité qu’on leur témoigne. Ce sont des questions matérielles qui sont en jeu, pas des questions de culture. Je ne crois pas que les religions chrétienne et musulmane s’opposent sur tant de points. L’antagonisme est plutôt sur le thème : on est mal reçu, on nous parle mal, la police nous rudoie.
Comment la culture peut-elle nous permettre de nous protéger, de nous défendre et de reprendre le dessus dans ces temps marqués par le terrorisme, le racisme, la bêtise ?
C’est son rôle de nous animer pour que nous soyons humains. Car ce dont nous souffrons dans ce monde contemporain, comme c’était le cas durant les guerres de religion ou à l’époque coloniale, c’est de l’inhumanité, c’est d’être confrontés à une violence et à une brutalité qui ne sont pas dans la nature humaine. Je ne sais pas si je suis kantien, mais j’aurais tendance à croire que la logique, l’équilibre et la bienséance sont les fondements mêmes des relations entre humains. C’est à cela que sert la culture. C’est pourquoi elle est si importante.
Ceux qui attaquent ce monde, aussi bien chez les extrémistes musulmans que chez les extrémistes fascistes, ce sont les gens qui considèrent que l’être humain est une denrée négligeable qu’on peut éliminer pour parvenir à ses fins. La culture, c’est la capacité que nous avons d’échanger.
Il est rare d’entendre un romancier se référer à Kant.
J’admire Kant parce que c’est quelqu’un qui invente un langage. Pour le lire, il faut faire un effort, avoir un dictionnaire pour comprendre ce qu’il veut dire. Mais il a ensuite la générosité de nous faire partager son système.
Est-ce pour vous une source ?
Oui, grâce à l’une de mes filles. Elle m’a fait lire Darwin, Kant, Sartre… tous les grands textes dont tout le monde parle sans les avoir lus.
La culture peut-elle être brandie comme une arme, aujourd’hui encore ?
Oui. Elle porte même davantage une capacité d’engagement car la situation s’est durcie. Dans ma vie, il y aura eu deux moments difficiles que je vois par le prisme de mes années niçoises. D’abord la guerre d’Algérie, avec l’exacerbation des mauvais instincts humains, puis, maintenant, la montée de l’extrême droite avec la même exacerbation, même si elle n’a pas les mêmes causes. Au temps de l’Algérie, les tensions venaient du fait qu’on avait perdu la guerre. Les pieds-noirs ne furent pas bien accueillis à Nice. Leur mode de vie ne cadrait pas avec celui des Niçois. On a connu des ratonnades sévères à l’encontre des Arabo-musulmans. Je me souviens d’un Marocain, ouvrier sur un chantier, tué par des voyous sur le port du Paillon. Il passait par là. Ils se sont payé l’arabe. C’était un moment extrême.
J’étais étudiant et très impliqué dans la vie de la cité. J’étais même assez communisant. Les jeunes de ma génération vivaient sous la menace d’être incorporés en Algérie. Un de mes amis, peintre de talent, fut tué au bout d’une semaine. On sentait la gravité des choses.
Pierre Guyotat n’exagère pas dans son livre Tombeau pour 500 000 soldats. C’était vrai. Nous étions jeunes et avions pourtant l’impression d’être au bord du tombeau. Physiquement, mais aussi du tombeau de nos idées, de notre appétit d’humanisme. C’était un moment sérieux de notre vie. Puis s’est ouverte cette grande plage des Trente Glorieuses, qui ne furent pas glorieuses pour tout le monde. Ce fut un temps de relatif silence. Les tiraillements semblaient apaisés. Les pieds-noirs réinstallés cultivaient leur nostalgie, écrivaient de très beaux livres ou apportaient leur contribution à une bonne entente entre colonisés et colonisateurs, à l’image de Benjamin Stora. Aujourd’hui, les tensions reviennent.
À quels remèdes culturels pensez-vous ?
Relisez Noces de Camus, c’est merveilleux. Il faut utiliser ce qu’il y a de plus étonnant dans la culture pour améliorer le paysage politique. Camus, avec son esprit qui voisine la sainteté, est profondément un chrétien, comme en témoigne sa thèse sur Plotin. Oscar Wilde, lui, est le contraire de Camus. Il a l’air de ne croire en rien, de tout tourner en dérision, mais c’est un esprit caustique dont nous avons besoin. Il met du piment. Tout n’est pas suave et délicieux dans la culture. Pierre Guyotat n’est pas suave. La plume dans la plaie, c’est nécessaire aussi, cela fait partie du rôle de la littérature.
Quel conseil de lecture donneriez-vous à un jeune qui ne lit pas ?
Je fais partie d’une fondation à l’île Maurice, à destination des écoliers des classes populaires pour qui un livre reste inaccessible. J’apporte régulièrement Le Prophète de Khalil Gibran, un livre parfait pour former la jeunesse. Je dis aux enfants : lisez, vous allez croire en l’être humain, en la beauté, en ce que vous voudrez. Ce livre va vous donner du bonheur. C’est un texte ouvert qui donne confiance en la vie, qui croit en la valeur de la vie.
Je parle aussi d’un autre texte, dont j’aimerais qu’il soit réédité et remis à tous les lycéens : la déclaration du chef indien Seattle au président des États-Unis, en 1854, quand on le mettait en demeure de donner les terres de son peuple après avoir perdu son combat. Il dicte à un secrétaire dans la langue des Lummi, sa tribu, une lettre qui sera traduite en anglais, connue sous le titre Peut-être sommes nous frères.
Seattle dit en substance : nous ne pouvons plus rester sur cette terre car nous sommes en infériorité. Nous vous la donnons, mais prenez en soin. Nous l’aimons comme un bébé aime le battement du cœur de sa mère. En faisant lire ce texte dans les lycées, je veux montrer que la culture amérindienne est importante, et que la culture n’a rien à voir avec une éducation académique. Cet homme n’a pas de culture livresque. Il ne sait pas écrire, mais ce qu’il dit est magnifique. Dans les lycées, je lis un extrait de cette lettre en recommandant de bien écouter ce que dit cet homme.
Propos recueillis par ÉRIC FOTTORINO et LAURENT GREILSAMER
« Relisez Noces de Camus ! »
J.M.G. Le Clézio
Comment définir la culture ?
Pour moi, l’important, c’est qu’elle soit mobile. Qu’elle soit le contraire d’un trésor fixé, figé, enfermé dans un coffre. Sa valeur ne tient pas du tout à sa …
[Confiture]
Robert Solé
Au baccalauréat, des jeunes de 18 ans doivent philosopher sur des sujets aussi complexes que « La culture est-elle nécessairement libératrice ? » ou « L’art nous éloigne-t-il de la réalité ? &raqu…
« Ici, un fainéant »
Raphaël Imbert
« Ici, avant un fainéant, aujourd’hui un travailleur ! » C’est ce que l’on pouvait lire il y a peu sur les devantures des ateliers d’artistes de la ville de Fréjus. Ce sont des militants FN qui ont posé ces affichettes. La no…