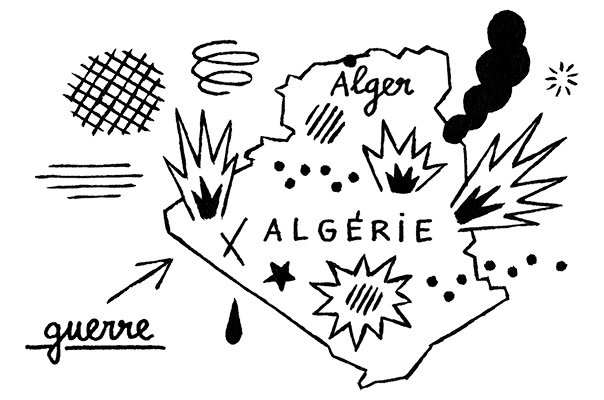« L’important c’est de respecter l’autre et son histoire »
Temps de lecture : 9 minutes
Pourquoi un jeune chercheur comme vous s’est-il penché sur ces mémoires de la guerre d’Algérie ?
Les premiers questionnements trouvent leur origine dans les attentats de 2015. À l’époque, j’étais directeur du Mouvement antiraciste européen. Pour les militants antiracistes, les attentats furent un tremblement de terre intime, une sorte d’échec. Toutes ces interventions scolaires, toutes ces mobilisations pour en arriver là ? Nous sentions l’espace démocratique se rétrécir. La prise en étau entre le terrorisme islamiste et la montée du discours sécuritaire et identitaire provoquait un sentiment d’étouffement.
Pourquoi avions-nous échoué ? Les questions qui m’habitaient tournaient autour de la relation de la France avec ses Arabes et ses musulmans. D’où venait cette soi-disant difficulté à vivre ensemble ? Ces représentations de l’autre ? Pourquoi ces peurs se trouvaient-elles réactivées après les attentats ? J’ai voulu savoir si ces tensions identitaires avaient un lien avec cette histoire.
D’autres se sont-ils aussi interrogés ?
Oui. Benjamin Stora publie alors Les Mémoires dangereuses avec Alexis Jenni ; Nicolas Lebourg et Jérôme Fourquet, La nouvelle guerre d’Algérie n’aura pas lieu ; Éric Zemmour a écrit des articles sur le retour de la guerre d’Algérie. Beaucoup de démarches artistiques qui aboutiront à des œuvres sur la guerre d’Algérie débutent après les attentats. Comme s’ils avaient réveillé quelque chose. Il y avait des évidences.
Par exemple ?
Mohammed Merah a commis son deuxième attentat le 19 mars 2012, le jour des cinquante ans de la fin de la guerre d’Algérie. Beaucoup de terroristes étaient d’origine algérienne. En 2017, un groupe d’extrême droite qui a repris le nom d’OAS planifie des attentats contre des personnalités. Je voulais savoir si, dans les mémoires familiales ou dans la mémoire collective, on pouvait identifier des éléments expliquant la radicalisation ; si, dans la société française, existaient des cadres organisationnels qui instrumentalisaient les mémoires. J’ai donc commencé une thèse en science politique sur la mémoire de la guerre d’Algérie chez les jeunes de la troisième génération, qui ont entre 16 et 30 ans. Je voulais savoir de façon scientifique où en était la société française.
« Cette guerre atteint aujourd’hui le moment où l’on passe des mémoires à l’histoire »
Qu’avez-vous trouvé ?
La première chose, c’est que le sujet concerne beaucoup de gens. 39 % des jeunes Français ont un membre de leur famille ayant un lien avec l’Algérie. Pour eux, c’est une histoire intime, familiale, comme tant d’autres. Elle fait l’objet de questionnements mais rarement d’animosité.
Cette guerre atteint aujourd’hui le moment où l’on passe des mémoires à l’histoire. Cela veut dire que l’on quitte progressivement le monde des mémoires manipulées et stéréotypées pour un rapport plus distant à l’événement, une simple connaissance et compréhension des faits.
Mais ce rapport plus distant permet aussi à ceux qui sont concernés et intéressés d’interroger les mémoires intimes. Les barrières qu’étaient les mémoires à vif, les problèmes familiaux tombent. La société française offre davantage d’outils pour accéder aux connaissances. Le ressentiment, je l’ai par contre retrouvé à l’extrême droite, chez certains descendants de membre de l’OAS. Les filiations sont plus organisées dans les familles idéologiques très structurées. Ils croient au choc des civilisations. Algérie, guerre au Mali : même combat.
Les jeunes d’origine maghrébine n’ont pas de ressentiment, eux ?
Les descendants d’Algériens peuvent avoir une fierté des DZ [DZ pour Djezahir, l’Algérie en arabe], autour du drapeau, de l’équipe de foot algérienne, une fierté aussi du combat pour l’indépendance, mais cela est totalement compatible avec leur identité française.
Le ressentiment peut naître de l’expérience qu’ils font dans leur vie quotidienne du racisme ou de la discrimination, ou du regard méprisant que les autres portent sur eux et qui les renvoie à ce passé. Ils se posent alors des questions : pourquoi ces regards ? quelle est l’histoire de mes parents et de mes grands-parents ? Ils cherchent à comprendre leur présence au monde et ce qu’est la France aujourd’hui.
Pourquoi cette histoire s’est-elle construite sur le registre de la mémoire blessée ?
Pendant longtemps, les historiens et les historiennes ont manqué de sources pour écrire cette histoire. Les archives étaient inaccessibles. Ils se sont reposés sur des sources orales. Cela a permis d’ouvrir un vaste champ de recherche, mais cela a aussi conduit à faire une analogie entre mémoires individuelles et mémoire collective. Les termes psychologiques pour décrire les « traumas collectifs », les « amnésies » et les « retours du refoulé » masquent les dynamiques sociales et politiques à l’œuvre dans la construction des mémoires.
« À partir des années 2000, ce sont les acteurs politiques qui ont investi le sujet pour en faire une source de clivage et parler d’identité »
Toutes les mémoires n’ont-elles pas été souffrantes ?
Les gens ont souffert. Mais tout le monde n’en a pas fait un objet de revendication. La plupart des gens ont vécu cela intimement ; ils ont reconstruit leur vie, et leurs enfants et petits-enfants vivent la leur. Par contre, des acteurs sociaux et politiques ont fait des mémoires de la guerre d’Algérie un champ de bataille, mettant en avant ces blessures. Ils en ont fait une rente mémorielle. Je pense à certaines associations de pieds-noirs, de harkis ou d’anciens combattants. Elles essayaient d’obtenir d’un État silencieux des gestes mémoriels. Dans ce rapport avec les pouvoirs publics, présenter les mémoires comme souffrantes permet d’obtenir une réaction. Longtemps, l’État est resté dans une relation clientéliste avec ces associations et n’a pas joué son rôle d’ensemblier. Le récit national est ainsi devenu un enjeu de compétition. L’État donnait aux harkis, aux pieds-noirs, aux anciens combattants, il reconnaissait telle date… Les autres acteurs devaient obtenir la même chose. Puis, à partir des années 2000, ce sont les acteurs politiques qui ont investi le sujet pour en faire une source de clivage et parler d’identité. Pourtant, les mémoires de la guerre d’Algérie ne sont pas antagonistes mais complémentaires. Le vécu de chacun compte. On n’est pas obligé d’être d’accord sur tout. L’important, c’est de respecter l’autre et son histoire.
Quel est l’enjeu principal de cette question algérienne ?
Le président Emmanuel Macron a la volonté de laisser une trace mémorielle équivalente au discours du Vél’d’Hiv de Jacques Chirac*. Il veut réconcilier, rassembler la France autour de ce travail de mémoire. Cela révèle des présupposés. D’abord, il s’agirait d’une histoire qui divise encore et empêcherait les Français de vivre ensemble. Une analyse à prendre avec prudence car les contemporains n’ont pas à se réconcilier, ils ne se sont jamais battus. On identifie donc deux niveaux de discours. Un premier qui concerne vraiment la guerre d’Algérie et le travail historique et mémoriel à mener ou à accompagner. Puis un second qui tend à charger l’Algérie d’autres enjeux. On a tendance à lui imputer beaucoup de choses, comme si elle était la source de nombreux problèmes politiques et sociaux. Ce n’est pas un hasard si Emmanuel Macron a demandé un rapport à Benjamin Stora juste après les mobilisations contre le racisme dans la police du printemps dernier. Sa réponse n’est pas de mener une réforme de la police, mais de proposer un travail sur la guerre d’Algérie… Si l’objectif affiché est la cohésion sociale, alors la mémoire ne fera pas tout. Elle ne saurait remplacer un travail de transformation du réel.
Comment analysez-vous le rapport remis par Benjamin Stora au président en janvier ?
Ce rapport contient trois blocs de recommandations. Un premier sur les symboles, une boîte à outils dans laquelle le politique peut piocher : travailler sur la figure de l’émir Abdel Kader, panthéoniser Gisèle Halimi, etc. Un deuxième bloc concerne le règlement de dossiers qui traînent depuis longtemps et pèsent sur la relation franco-algérienne (cimetières, essais nucléaires…), la question des archives qui est toujours un problème – pour regarder l’histoire en face, il faut commencer par ouvrir toutes les archives – et aussi la question des disparus. Le troisième bloc est davantage tourné vers l’avenir. Il vise à fournir des outils à la société française pour qu’elle puisse travailler – longtemps, on l’en a empêchée, notamment les forces conservatrices mobilisant le discours sur la repentance qui n’a qu’un objectif : entraver tout travail critique. Pendant longtemps, quiconque voulait se pencher sur ce sujet ne trouvait pas de cadre pour le faire de façon apaisée. Il n’y a pas de musée, pas de fondation, pas de chaire universitaire dédiés à cette guerre ou à la colonisation ; les études postcoloniales sont méprisées, les échanges et la circulation avec l’Algérie sont compliqués, et il est difficile d’apprendre l’arabe en France. Il s’agit maintenant de donner des outils, de financer des projets, des structures, pour laisser la société travailler. La création d’un office franco-algérien pour la jeunesse est aussi intéressante.
« Ce qui se joue aujourd’hui, c’est la longue sortie du postcolonial »
Dans quel registre placez-vous la reconnaissance par la France de sa responsabilité dans l’assassinat en 1957 d’Ali Boumendjel et de Maurice Audin ?
C’est à la fois un symbole – car des Boumendjel et des Audin, il y en a des milliers – et un geste actant la reconnaissance de faits et de responsabilités – une route sur laquelle le politique peut s’engager. Beaucoup a été dit sur la guerre d’Algérie. Entre les gestes mémoriels de Lionel Jospin sur la torture, en 1999, et ceux d’Emmanuel Macron aujourd’hui, les présidents se sont exprimés sur les harkis, les appelés, les pieds-noirs, le 17 octobre 1961, etc. Si la reconnaissance des faits existe, celle des responsabilités et éventuellement des réparations est encore à explorer pour qu’on puisse dire clairement ce qui a rendu possible la guerre d’Algérie, mais aussi la colonisation, qui est absente des débats. Or on ne peut comprendre cette guerre si on ne comprend pas le système qui l’a produite.
Qu’est-ce qui bloque ?
C’est cette incapacité de la France à faire face à son passé colonial, à le comprendre et à reconnaître que la République, celle qui plaçait l’égalité et l’émancipation au cœur de son projet, produisait en même temps le système colonial et le régime discriminatoire de l’indigénat. Ce n’est pas faire acte de repentance, mais c’est se donner la possibilité, en tant que société, de comprendre ce qui a rendu ce passé possible ; de mieux se comprendre soi-même, car la République – ses institutions, son capitalisme – s’est construite dans cette expérience coloniale. Par ailleurs, ce passé ne s’est pas évaporé en 1962. Il a laissé des traces – notamment à travers la représentation de l’autre – avec lesquelles nous vivons encore. Pour mieux s’attaquer au cœur du problème, il faut faire ce travail. Le racisme et l’antisémitisme sont en partie des héritages coloniaux. Les Européens n’étaient pas racistes par nature. C’est la colonisation et l’esclavage qui ont produit le racisme, pas l’inverse. Ce qui se joue aujourd’hui, c’est la longue sortie du postcolonial.
Propos recueillis par ÉRIC FOTTORINO
* « Je suis très lucide sur les défis que j’ai devant moi d’un point de vue mémoriel, et qui sont politiques, dit aujourd’hui M. Macron. La guerre d’Algérie est sans doute le plus dramatique. Je le sais depuis ma campagne. Il est là, et je pense qu’il a à peu près le même statut que la Shoah pour Chirac en 1995. » (Le Monde, 25 janvier 2020.)
« L’important c’est de respecter l’autre et son histoire »
Paul Morin
« Les gens ont souffert. Mais tout le monde n’en a pas fait un objet de revendication. La plupart des gens ont vécu cela intimement ; ils ont reconstruit leur vie, et leurs enfants et petits-enfants vivent la leur. Par contre, des acteurs sociaux et politiques ont fait des mémoires de la guerre d…
[Pieds-noirs]
Robert Solé
RAPATRIÉS ? Le mot désigne des personnes qu’on ramène dans leur pays ; or la plupart des Français d’Algérie n’avaient jamais foulé le sol de l’Hexagone. Pieds-noirs ? Ce terme est d’une origine pour le moins douteuse. Six ou sept filiations d…
Le canon de Baba Merzoug
Lazhari Labter
J’ai lu avec beaucoup d’intérêt le rapport de Benjamin Stora, tout comme nombre de commentaires qui ont suivi d’un côté comme de l’autre…