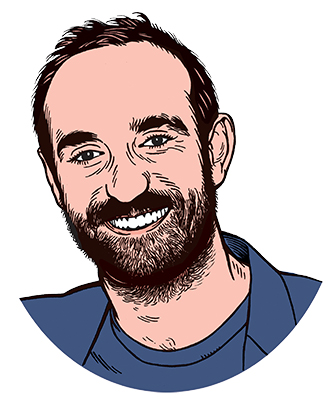Arrêtons l’agribashing
Temps de lecture : 6 minutes
J’ai grandi dans une ferme. Je suis fils, petit-fils de paysans. Aujourd’hui, je suis un citadin mais je n’oublie pas que je suis un fils de la terre. Cette terre amoureuse qui colle pour toujours à mes baskets de Parisien. Cette terre, je me battrai toujours pour la faire vivre, pour défendre les hommes qui la font vivre et pour leur rendre les honneurs qui leur sont dus. Parce que sans eux, sans nos nourrisseurs, nous n’existerions pas.
En réalisant mon premier long métrage pour le cinéma, Au nom de la terre, directement inspiré par l’histoire de ma famille, j’ai voulu montrer à tous la vie oubliée de nos paysans. Recoudre le lien avec les terroirs et retisser le lien avec les hommes. Les réactions que je reçois chaque jour de la part d’agriculteurs et de leurs familles sont déchirantes. « Beaucoup de spectateurs sont des paysans retraités qui vont très rarement dans les salles obscures, a déclaré Mathias Bonneau, du cinéma de Gençay dans la Vienne sur France Bleu Poitou. La preuve : certains nous demandent si les places sont numérotées. » Un retraité lui a avoué qu’il était venu pour se voir au cinéma, voir ce qu’il avait vécu, sauf que lui ne s’est pas suicidé.
« On ne fournit pas les mouchoirs mais beaucoup de spectateurs sortent émus aux larmes », ajoute le programmateur du Fauteuil rouge de Bressuire (Deux-Sèvres).
Je n’ai pas écrit ce film pour faire pleurer. Plutôt pour alerter, faire comprendre et partager le destin de paysans broyés par un système qu’ils n’ont pas voulu. Une femme dont le père éleveur s’est tiré une balle dans la tête quand elle avait trois ans m’a écrit ces mots : « C’est magnifique l’idée qu’à travers ce film vous puissiez peut-être aider d’autres agriculteurs à ne pas commettre l’irréparable, tout du moins inciter les Français à consommer différemment, et enfin, qui sait, inciter l’État à annuler complètement la dette et les crédits des agriculteurs en difficulté. On peut rêver, mais !... »
La réalité est autre. Dans le pays du bien manger, les agriculteurs se meurent et la restauration rapide croît ; les exploitations agricoles familiales disparaissent alors que chacun recherche du bio ; les salaires des paysans baissent alors que les prix dans la grande distribution au mieux stagnent, au pire augmentent inexorablement.
La Terre a un nom, celui de nos enfants, de nos parents, de nos jeunes, de nos anciens, de toute confession, de toute origine. La Terre grandit avec nous. Nous la forgeons, la modelons. Nous lui donnons nos formes, nous l’élevons. Nos agriculteurs sont un bien précieux dans le cycle de la vie. Ils en sont les joailliers. Nous leur devons soutien et reconnaissance. Ils nous nourrissent et entretiennent notre Terre. Il nous appartient de les respecter. Le futur des agriculteurs et le nôtre se rejoignent par l’éducation, par des jardins dans les écoles, par les mains des enfants dans la terre. Le temps de l’action est venu : réapprendre des leçons de choses, sanctuariser le temps de cantine scolaire, faire en sorte que celle-ci soit respectueuse de nos enfants, de nous-mêmes.
Parmi nos combats, nous avons la responsabilité collective de nous opposer à l’appropriation du vivant par les géants de l’agrochimie. Tout ce qui faisait la vie et sa saveur est en passe d’être contrôlé par quelques-uns, ou éradiqués purement et simplement : 75 % des semences dans le monde ont été détruites depuis 1970. Si nous laissons la logique financière prendre le pas sur notre bon sens, au lieu d’adopter de vrais principes humanistes, nous courons à la catastrophe. La question n’est pas quand, puisque nous en sommes à la veille, mais quelle sera son ampleur. Nous sommes fortement attachés à défendre une alimentation saine, une biodiversité animale et végétale issue d’une agriculture durable pour les producteurs comme pour les consommateurs, pour les femmes et les hommes comme pour la terre. Il y va de notre sauvegarde comme de celle de notre territoire, peinture vivante que les paysans dessinent chaque jour.
Arrêtons l’agribashing, que nos paysans n’ont pas mérité. Ce que l’État leur a demandé dans les années 1950, c’est de produire, en agrandissant leurs élevages, en mécanisant, avec l’aide de la chimie. Aujourd’hui, ils sont les pestiférés d’un système qu’ils n’ont fait qu’appliquer. D’accord, arrêtons demain le glyphosate et tous les autres pesticides. Mais dans ce cas, n’importons plus aucun produit européen qui ne réponde pas aux mêmes normes sanitaires que les nôtres. N’importons plus d’Amérique du Sud du soja transgénique mûri au glyphosate, du bœuf piqué aux hormones, du poulet industriel trempé dans l’eau de javel… Au lieu de condamner nos paysans, aidons-les. Ces hommes et ces femmes ne sont pas des statistiques. Et trop de drames les frappent. Trop de familles dévastées après qu’un des leurs a préféré le ciel à cette terre. Chaque jour, un paysan se suicide. Voilà le résultat morbide de ce que nous produisons.
Mais peut-on accepter que notre alimentation et ses modes de production soient sources de maladies quand ils devraient apporter santé et bien-être ? La nourriture est notre première médecine préventive, notre héritage et notre culture. Elle est le socle d’une communauté, une histoire, un présent, et surtout un futur, elle participe au patrimoine génétique de chacun d’entre nous. Elle est directement liée à l’agriculture, à la pêche et à la nature. Nous devons agir au quotidien pour reprendre notre destin en main. Nous devons agir pour soutenir une cuisine de santé.
Comment avons-nous pu utiliser le progrès pour le faire rimer avec régression ? Nous avions tout pour faire cohabiter économie et écologie. Le poison est dans la dose… Aujourd’hui nous nous conduisons comme des drogués qui en veulent toujours plus. On a trop laissé s’effacer les mots « saveur », « goût », « plaisir » de notre vocabulaire. On les a remplacés par fast-foods, plats préparés, pêche électrique… Or, chacun à notre échelle, nous pouvons transformer le système : en achetant autrement, en circuit court dans une Amap par exemple, en cultivant un jardin partagé, ou déjà en sélectionnant autant que possible des produits locaux en grande surface. De nombreux fermiers y vendent leurs produits. Moi, j’ai choisi de monter des restaurants à Paris pour valoriser le travail de mes anciens camarades de terre… Le restaurateur que je suis devenu espère que dans le plus grand nombre de cuisines françaises, nous retrouverons le chemin des bons produits, cultivés avec amour et passion. Et ainsi, nous aurons rétabli le cercle vertueux, sain et évident de la fourche à la fourchette. Avec mon associé, nous nous fournissons en circuit court pour faire vivre les maraîchers et les éleveurs que nous connaissons. Cette aventure, c’est le trait d’union entre la ville et les champs. Avec la terre de mon père et de ma mère, que je vais continuer à cultiver. L’an dernier j’ai obtenu mon brevet de responsable d’exploitation agricole, mon diplôme de paysan en somme.
« L’agriculture est l’avenir de l’humanité »
Jean Viard
C’est un film très vrai. Il fait le récit du drame de l’agriculture industrielle. Son véritable sujet, ce sont les techniciens agricoles qui conseillent des modèles de développement à des agriculteurs qui peinent d&…
[Respect]
Robert Solé
Le dernier slogan des paysans en colère – « Macron, réponds-nous ! » – a été jugé irrespectueux par le ministre de l’Agriculture. « On ne s’adresse pas ainsi au pr&eac…
Ces paysans qui cherchent d’autres solutions
Manon Paulic
Ils doivent produire une alimentation saine, sans pesticide, respectueuse de l’environnement et de la santé des consommateurs. Produire suffisamment pour nourrir une population croissante, qui ne cesse de s’urbaniser. Suffisamment pour pouvoir s’octroyer un revenu décent et…