Les inégalités, un choix politique ?
Temps de lecture : 29 minutes
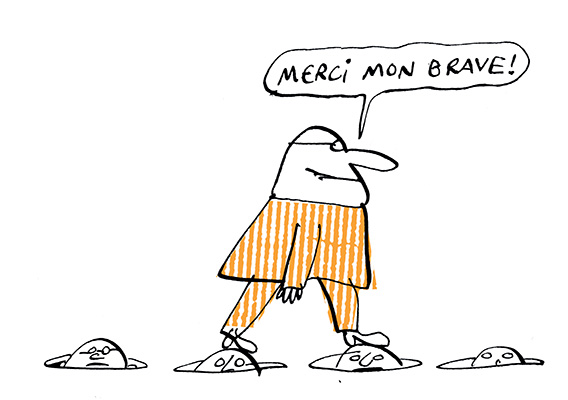
De quoi parle-t-on quand on parle d’inégalités ?
Camille Landais : La notion d’inégalité recouvre beaucoup de choses. Lorsque l’on s’intéresse à la distribution des ressources entre les individus ou les groupes sociaux au sein de nos sociétés, il est tout aussi important de se préoccuper de ce qui se passe tout en haut, parmi les ménages les plus riches, que de ce qui arrive dans le reste de la population – les classes moyennes, les pauvres, etc. Nous avons appris énormément de choses sur l’évolution de la distribution des richesses au cours des vingt dernières années : on appréhende mieux à présent la dynamique des inégalités de revenus et de patrimoine, la façon dont la pauvreté a changé de visage, la persistance des inégalités entre générations, etc. Ce sont des faits sociaux qu’on a envie de prendre à bras-le-corps et auxquels on voudrait donner des réponses politiques.
Gabriel Zucman : Une des dimensions frappantes des inégalités, en France comme dans nombre de pays, c’est leur persistance, très forte, au niveau du patrimoine, avec d’un côté les 50 % les plus pauvres, qui n’en possèdent quasiment pas – à peu près 5 % du total, en France –, et de l’autre les 1 % les plus riches – un groupe cinquante fois plus petit –, qui en possèdent à peu près 25 % du total – donc cinq fois plus. Bien que les inégalités aient beaucoup évolué au cours des décennies – il y a eu pendant le XXe siècle un processus de baisse des inégalités de patrimoine –, cette réalité n’a pas changé : la moitié de la population ne possède toujours presque rien ou très peu. Avec des implications majeures pour la vie professionnelle, pour l’insécurité du quotidien.
Vos travaux montrent que cette notion d’inégalité s’étend bien au-delà des revenus et des patrimoines et soulignent le poids des inégalités de genre.
Gabriel Zucman : On observe en effet une persistance très forte des inégalités entre hommes et femmes. Dans le Rapport sur les inégalités mondiales paru en décembre 2021, on a calculé pour chaque pays la fraction de la masse salariale totale que touchent les hommes et celle que touchent les femmes. S’il y avait une égalité parfaite, ce serait 50-50. En réalité, on voit que dans toutes les régions du monde, on est plutôt aux alentours de 30-40 % pour la part des femmes, et de 60-70 % pour celle des hommes. Il y a dans la plupart des régions du monde une évolution vers plus d’égalité, mais elle est extrêmement lente. Au rythme actuel, une parité parfaite entre hommes et femmes ne pourra être atteinte avant le XXIIe siècle ! Et la France n’y échappe pas.
Voyez-vous d’autres lignes de fracture importantes ?
Camille Landais : La première des inégalités, qu’il ne faut pas oublier et qui a toujours fasciné les économistes, c’est l’inégalité entre les nations. Une grande partie des inégalités entre individus dans le monde continuent d’être déterminées par des niveaux de développement très inégaux entre les pays. Cette inégalité-là nous engage, nous, en tant que nation plus développée. La pandémie de Covid et la crise climatique nous renvoient d’ailleurs à cette responsabilité.
Quid des fractures géographiques au sein même des pays, des inégalités entre les territoires, dont on a beaucoup parlé avec les Gilets jaunes ?
Gabriel Zucman : On voit que l’activité économique a tendance à se concentrer dans les grandes métropoles qui bénéficient à plein de la mondialisation et, dans notre cas, de l’intégration économique européenne, alors que les territoires périurbains et les campagnes en profitent bien moins ou en pâtissent. On le constate en Europe comme aux États-Unis : une prospérité et une concentration croissantes de l’activité dans les grandes villes côtières, tandis que l’intérieur du pays est laissé à l’écart de la croissance économique. Ce phénomène est très important pour comprendre un certain nombre d’évolutions politiques, comme les Gilets jaunes en France ou, aux États-Unis, le déplacement d’une partie des classes populaires et des classes moyennes vers le Parti républicain ou vers l’abstention.
Y a-t-il alors un mouvement général vers plus d’inégalités ?
Gabriel Zucman : Je dirai trois choses. La première, c’est que les inégalités ont augmenté en France, comme dans la plupart des autres pays d’Europe continentale, mais elles y ont augmenté moins fortement qu’aux États-Unis, que ce soit pour les revenus et pour les patrimoines, depuis le point de rupture du début des années 1980. De la Première Guerre mondiale au début des années 1980, en Europe comme aux États-Unis, on observait un processus de baisse des inégalités de revenus, et de baisse très marquée de la concentration des patrimoines. Ce phénomène s’est infléchi dans les pays riches à partir du début des années 1980, pour des raisons politiques. En 1980, si on regarde la part du revenu touchée par les 1 % les plus riches aux États-Unis et en Europe continentale, elle était de 10 % dans les deux cas. Le point de départ, juste avant la révolution reaganienne et l’arrivée au pouvoir des socialistes en France, était donc à peu près le même. Puis les États-Unis sont passés de 10 % à 20 % aujourd’hui des revenus pour les 1 % les plus riches, contre 10 % à 12 % en Europe continentale.
C’est une augmentation, mais elle est plus faible qu’outre-Atlantique. Deuxième chose : bien que l’augmentation des inégalités soit plus faible ici qu’outre-Atlantique, je pense qu’on aurait bien tort de ne pas s’en préoccuper. Souvent, le discours utilisé à des fins de conservatisme consiste à dire : la France ne s’en tire pas si mal par rapport à d’autres pays. En réalité, les choses peuvent changer très rapidement. Aux États-Unis, les inégalités ont augmenté en quelques années, en particulier entre la grande réforme fiscale de Reagan de 1986 et la fin des années 1990. On a vu comment, en dix ans, la société, l’économie pouvaient être chamboulées. Avec, à terme, des conséquences politiques qui peuvent être cataclysmiques.
Troisième point : on sait trop peu de choses sur l’évolution des inégalités de fortune en France, parce qu’il y a eu une démission de la statistique publique sur ces questions. Avec une opacité très forte sur la question de la concentration des patrimoines. Compte tenu de leur concentration, on est obligé pour les étudier de s’intéresser à ce qui se passe au sommet de la distribution. Quand l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) existait, une base d’éléments empiriques permettait de suivre, même avec beaucoup d’incertitudes, les hauts patrimoines. Maintenant que l’ISF a été supprimé et remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) en 2018, on a cassé le thermomètre. Dans ce contexte, le vide est rempli par d’autres acteurs. Le magazine Challenge publie une liste annuelle des grandes fortunes françaises. On y lit une dynamique d’explosion des plus grandes fortunes : la richesse des milliardaires a été multipliée par trois en France entre 2010 et 2022, dans un contexte de quasi-stagnation des salaires, du PIB et du revenu national par tête.
Camille Landais : Il faut bien comprendre que, pour appréhender les différences de niveau de vie tout en haut de la distribution, la notion de revenu, mesurée à travers les sources fiscales, est problématique, et qu’il est impératif de la croiser avec des données sur les patrimoines. Tout en haut de la distribution des patrimoines, aujourd’hui, il est possible de ne plus jamais réaliser de revenus imposables ! Les très, très riches Français peuvent mettre leur capital au sein de holdings, et emprunter contre les plus-values latentes de ces holdings : ils créent donc de la dette qui est garantie par les plus-values implicites qu’ils ont faites et qui leur permettent de financer leur consommation. Cela signifie que la notion même de revenu peut se révéler complexe et très mauvaise pour appréhender les inégalités de niveau de vie tout en haut de la distribution des patrimoines.
Peut-on dire, comme l’expliquent certaines théories économiques, que les inégalités relatives ne sont pas si importantes, si elles permettent de favoriser le pouvoir d’achat de tous ?
Gabriel Zucman : La révolution reaganienne a eu lieu il y a quarante ans. On peut donc essayer d’en dresser un bilan et de voir si, en dérégulant le marché du travail, en abaissant la progressivité de l’impôt, en affaiblissant le pouvoir des syndicats, en libéralisant la finance, on peut générer de la croissance bénéficiant aux classes moyennes et aux classes populaires. Donc, quel bilan ? L’élément numéro un, c’est d’abord le déclin de la croissance macroéconomique des États-Unis sur la période 1980-2020. De fait, elle a été faible : 1,4 % par an par adulte en moyenne, alors que sur la période de l’après-guerre 1946-1980, la croissance a été en moyenne de 2 % par an par adulte.
« Depuis les années 1980, le lien entre croissance et prospérité des classes populaires et moyennes s’est rompu »
Deuxième fait, plus important encore : il n’y a quasiment pas eu de gains de revenus avant impôts et transferts sociaux depuis 1980 pour les classes populaires. Alors que les plus riches ont bénéficié de taux de croissance de 3, 4, 5, 6 % par an en moyenne depuis 1980. La révolution reaganienne nous apprend qu’on peut avoir des pays où, pendant des décennies, la croissance ne bénéficie qu’à certains groupes sociaux. Il n’y a pas de forces qui, naturellement, font en sorte que la croissance profite partout à tout le monde. Les économistes ont longtemps cru à cette fable. Pendant les Trente Glorieuses, il y avait cette idée que la croissance allait améliorer le sort de toutes les catégories sociales – et c’était pour l’essentiel le cas. Depuis les années 1980, le lien entre croissance et prospérité des classes populaires et moyennes s’est rompu.
Quel est le rôle des politiques économique, fiscale et budgétaire des gouvernements des trois derniers présidents – à savoir Sarkozy, Hollande et Macron – dans l’évolution des inégalités en France ?
Camille Landais : On a eu comme un mouvement de balancier. Le début du quinquennat Sarkozy correspond à une tentation de baisser les impôts, de faire une mini-révolution reaganienne. Des mesures assez fortes ont été prises vis-à-vis de l’imposition du patrimoine, mais aussi des successions. On a un sentiment de retour de balancier sous François Hollande, avec l’augmentation de la fiscalité des revenus du capital, et la fameuse taxe à 75 %. Ce qui me frappe vraiment dans ces allers-retours, c’est le côté grand bidouillage. Quand Hollande arrive au pouvoir, il n’a pas réfléchi à ces questions. Il crée un choc fiscal au pire moment, alors que nous sommes en pleine crise de la dette européenne, et les mesures mises en place sont bricolées par les cabinets sans vision d’ensemble. La taxe à 75 % en est vraiment l’exemple absolu. Un article récent de Malka Guillot montre d’ailleurs que cette taxe a en réalité eu l’effet inverse de celui escompté, contribuant à l’augmentation des revenus du travail les plus élevés : au moment de sa mise en place, certaines des personnes concernées, des gros PDG et des joueurs de foot, ont refusé de voir leurs salaires diminuer. Par conséquent, leurs entreprises ont elles-mêmes pris en charge une partie de la taxe. Une fois celle-ci abolie, ces mêmes joueurs de foot ou PDG ont utilisé ce levier afin de négocier une augmentation de leurs salaires.
Qu’en est-il de l’ère Macron ?
Camille Landais : Le passage de l’ISF à l’IFI est complètement absurde du point de vue économique. C’est de la pure idéologie, fondée sur l’idée que l’immobilier n’est pas un capital productif. Toutes ces questions sont abordées de manière approximative. Elles ne sont jamais posées dans le débat public en vue d’animer une vraie discussion, mais sont gérées de manière opaque. La plupart du temps, le contrôle démocratique par l’Assemblée est minimal. L’évaluation de ces mesures est en général inexistante, ou bien, lorsqu’elle est mise en place, personne n’en prend acte. Sur l’IFI, sur la taxation du capital, des commissions d’évaluation ont été mises en place, qui ont montré que les effets escomptés n’étaient pas au rendez-vous, et pourtant rien n’a changé.
« Le passage de l’ISF à l’IFI est complètement absurde du point de vue économique »
Gabriel Zucman : Le grand tournant se produit dans la deuxième moitié du quinquennat Sarkozy, au moment du choix de l’austérité, en 2010-2011, qui a été ensuite prolongé par François Hollande et par le président actuel jusqu’à la crise du Covid. Ça a été un tournant majeur parce que ce choix fut un moteur pour les inégalités, en particulier les inégalités entre les travailleurs du secteur public et ceux du secteur privé, avec le gel du point d’indice pour les fonctionnaires depuis 2010. Ce qui, dans un contexte d’inflation de 1,5 % par an – peut-être 3 % l’année prochaine –, se traduit sur douze ans par une baisse du salaire réel de l’ordre de 25 %. On parle donc d’un appauvrissement profond, quoique graduel, qui a creusé un abîme entre les fonctionnaires et les travailleurs du secteur privé. C’est une grande ligne de faille qui est apparue et qui affecte l’ensemble des services publics. En dépit de tous les discours sur l’importance d’investir, par exemple, dans l’innovation – ce qui est fondamental si on veut lutter contre les inégalités –, la dépense par étudiant à l’université en France a baissé de 14 % entre 2008 et 2022 : moins 7 % sous le quinquennat Macron depuis 2017, et moins 7 % sous Hollande et Sarkozy. La détérioration des moyens de l’hôpital et de tous les services publics est aussi très nette et inquiétante. C’est d’autant plus choquant que ce tournant de la rigueur était injustifié. Le diagnostic posé à l’époque par les pouvoirs publics – à savoir : nous sommes à la veille d’une explosion des taux d’intérêt et la défiance à l’égard de la dette publique française va franchir un seuil dangereux – s’est révélé inexact. C’est une erreur d’analyse monumentale puisque les taux d’intérêt, en fait, n’ont fait que continuer à baisser.
Camille Landais : Ce tournant de l’austérité a été encore plus marqué dans des pays comme la Grande-Bretagne. Et la plupart des pays qui se sont fourvoyés en s’engageant dans cette voie essayent aujourd’hui d’en sortir. Même les conservateurs britanniques ont tiré ce constat. Ce qui me frappe vraiment, en France, c’est que cela reste le discours général accepté par tous.
Est-ce que la question de l’héritage, en France, aggrave encore davantage les inégalités ? On voit bien que c’est une ligne de fracture majeure entre différents courants politiques.
Gabriel Zucman : L’héritage est une source d’inégalités considérables. On voit depuis plusieurs décennies se dessiner une nouvelle ligne de fracture de la société française : est-ce que vous avez hérité de votre logement ou pas ? Dans les années d’après-guerre, quand les prix de l’immobilier et les loyers étaient relativement faibles, les salaires croissaient vite ; même sans hériter, il était possible d’accéder à la propriété. Aujourd’hui, du fait de salaires qui stagnent depuis dix à quinze ans, si vous n’avez pas hérité, devenir propriétaire est impossible à Paris et de plus en plus difficile dans les villes de province, maintenant que les prix de l’immobilier sont en pleine explosion depuis la crise du Covid.
Cela signifie-t-il qu’il faille augmenter les taxes sur l’héritage ?
Camille Landais : Il faut réaliser que nous sommes passés d’une société où l’importance de l’héritage s’était un peu effacée à une société où son existence est déterminante. Avant, si vous étiez malin, que vous ayez ou non hérité, vous pouviez vous hisser à un niveau de vie supérieur. Cette société très méritocratique, vécue par les cohortes qui sont nées dans les années 1910 à 1940, est en train de disparaître. L’autre point important, c’est le niveau de concentration des héritages, beaucoup plus important que celui des patrimoines. Personne n’a ça en tête. L’héritage médian, c’est 60 000 euros, perçus sur l’ensemble d’une vie. Le ratio entre ces 60 000 euros et l’héritage moyen des personnes dans le top des 0,1 % est de l’ordre de 180. Ce même ratio pour les inégalités de revenus du travail est, lui, de l’ordre de 1 à 10. Aujourd’hui, il est vraiment très compliqué de parvenir tout en haut de l’échelle si vous n’avez pas hérité. La réponse à cela, ce n’est évidemment pas de taxer comme des malades les petites résidences principales. Que des personnes accumulent par une vie de travail de quoi acheter une résidence principale qu’elles lèguent à leurs enfants, cela ne représente pas un problème et ce n’est pas ce qui entretient la dynamique des inégalités. Les très gros héritages jouent par contre dans une autre cour. Le patrimoine moyen des 1 % les plus riches s’élève aux alentours de 5 millions d’euros, un peu plus de la moitié provenant de l’héritage. Pour les 0,1 % les plus riches, on monte autour de 20 millions d’euros, issus à 65 % de l’héritage. Mais évoquer les questions de l’héritage est très difficile politiquement.
Est-ce lié au sentiment qu’ont les Français d’être soumis à une forte pression fiscale ? Notre pays est la grande économie qui a l’un des plus forts taux de prélèvements obligatoires au monde – environ 44 % actuellement, contre 33 % à la fin des années 1970.
Camille Landais : Sur ce point, beaucoup d’économies se tiennent dans un mouchoir de poche. Ce n’est pas comme si la France avait atteint un niveau incommensurable. Les grandes économies scandinaves aussi ont des taux de prélèvements obligatoires très élevés. Il est toujours très difficile de prendre en compte l’ensemble des prélèvements obligatoires à cause des nombreux niveaux de prélèvements (fédéral, local…) en fonction de la structure institutionnelle et de la nature de ces prélèvements (impositions versus cotisations sociales, etc.). Toutes ces comparaisons, il faut donc les prendre avec un peu de recul.
Par ailleurs, la très forte augmentation de la part des prélèvements obligatoires dans le revenu national de la plupart des grands pays développés depuis les années 1970 est essentiellement liée à une mutation du rôle des États : ce sont aujourd’hui d’énormes assureurs, entre les retraites, l’assurance chômage, l’assurance invalidité et l’assurance maladie. Tout cela explique l’énorme croissance dans le revenu national des prélèvements obligatoires, mais aussi des dépenses publiques. On vit dans des sociétés au niveau de développement tel que la demande est énorme pour ce genre de services qui sont à la fois des prestations d’assurance sociale et la fourniture de grands biens publics.
« L’héritage est une source d’inégalités considérables »
Gabriel Zucman : J’irais même plus loin. Je pense que le taux de prélèvements obligatoires est un indicateur peu pertinent et arbitraire. En France, on a choisi d’avoir des systèmes de retraite publics. Toutes les cotisations retraite sont donc comptées comme des prélèvements obligatoires. Idem pour l’assurance maladie. Parmi les autres pays, certains ont fait des choix similaires, et d’autres ont opté pour des cotisations retraite et santé obligatoires mais privées, comme aux États-Unis. On a l’impression qu’il y a moins d’impôts, sauf qu’en réalité, quand on regarde la fraction du revenu des salaires absorbée par les prélèvements obligatoires publics et privés, elle est souvent assez similaire à ce qu’on peut observer en France. Ensuite, il faut regarder la distribution de ces prélèvements obligatoires. En France, à peu près 50 % du revenu national est prélevé chaque année en impôts et en cotisations sociales. Et, en effet, quasi toutes les catégories sociales payent en impôts peu ou prou 50 % de leurs revenus quand on additionne les cotisations sociales, l’impôt sur le revenu, la TVA, etc. Avec une grande exception : les 1 % les plus riches, dont le taux d’imposition effectif baisse à 40, voire 30 %. Une étude de l’Institut des politiques publiques parue en novembre 2021 s’est intéressée aux 380 plus grandes fortunes françaises, avec l’objectif de calculer leur taux effectif d’imposition. Résultat : il s’élève à 15 %, tous impôts compris. C’est ça, de mon point de vue, le problème central, et c’est là qu’il devrait y avoir un débat.
Quel regard posez-vous justement sur l’état du débat économique, alors que nous entrons véritablement dans la campagne présidentielle ?
Camille Landais : Je suis assez terrifié. Il y a pour moi deux urgences à aborder durant cette campagne. La première, c’est l’urgence climatique, et la manière dont on va être capable de mettre en place des politiques qui y répondent tout en étant acceptables et socialement justes. De ce point de vue, on n’a pas entendu grand-chose. La seconde urgence, c’est le déclassement incroyable du système éducatif et de recherche français, qui trouve ses origines dans ce tournant de l’austérité et dans la baisse de l’investissement dans la fonction publique de l’éducation et de la recherche. Sur ce sujet-là aussi, on attend encore des propositions.
Gabriel Zucman : On ne peut pas dire, pour le moment, que le débat ait beaucoup porté sur les questions économiques. Éric Ciotti proposait durant sa campagne pour la primaire de la droite de supprimer l’impôt sur les successions et d’instaurer une flat tax de 15 % sur les revenus, c’est-à-dire un impôt à taux unique pour tous, ce qui avait le mérite de la clarté. Il faut simplement réfléchir aux implications de ce genre de politique fiscale, en regardant ce qui s’est passé dans les pays qui ont adopté des mesures similaires. Aux États-Unis, par exemple, cela a été un puissant moteur d’augmentation des inégalités. Prenons donc acte de ce que nous apprend l’histoire et des expériences internationales en la matière. Ce qui manque, ce sont des propositions qui seraient aussi claires chez les autres candidats, en particulier à gauche. On entend souvent l’idée qu’il faudrait restaurer l’ISF. C’est bien sûr possible. Est-ce souhaitable ? Pas forcément. À la veille de sa suppression, les plus grandes fortunes françaises, pour l’essentiel, ne le payaient pas – en raison des mécanismes de plafonnement et d’exonération de l’« outil de travail », c’est-à-dire des parts dans les sociétés que ces grandes fortunes possédaient. Veut-on rétablir un impôt qui, lors de sa création en 1982, s’appelait « impôt sur les grandes fortunes », mais qui, en pratique, ne taxait pas ces plus grandes fortunes ? Sans doute pas. Ce qui semblerait un peu plus logique, ce serait d’essayer de comprendre ce qui ne fonctionnait pas dans l’ISF et comment on pourrait recréer une forme d’imposition des patrimoines qui tire les leçons de l’expérience française et européenne. C’est ce type de propositions qui manque. Aux États-Unis, lors de la campagne des primaires démocrates, il y avait eu des propositions intéressantes, précises, réalistes, chiffrées. Bernie Sanders, par exemple, souhaitait introduire un impôt de 1 % sur les grandes fortunes à partir de 32 millions de dollars, puis augmenter les taux peu à peu jusqu’à 8 % au-delà de 10 milliards de patrimoine. On pourrait réfléchir à ce que cela signifierait dans le contexte français. En transposant la proposition de Sanders, on pourrait ainsi imaginer un nouvel impôt sur les grandes fortunes à partir de 20 millions d’euros de patrimoine, 1 % jusqu’à 30 millions, puis 2 %, etc., et jusqu’à 8 % au-delà de 10 milliards d’euros. On se rend compte qu’un impôt de cette nature-là générerait à peu près 25 milliards d’euros de recettes fiscales par an, soit un point de PIB et cinq fois plus que l’ISF, alors même qu’il concernerait beaucoup moins de foyers. Voilà une mesure concrète qui pourrait changer la trajectoire des finances publiques et de la concentration des patrimoines !
On pourrait vous opposer la crainte d’une fuite de ces grandes fortunes, qui placeraient leurs capitaux à l’étranger et rendraient donc la mesure contre-productive…
Gabriel Zucman : C’est en effet un risque, si on laisse les grandes fortunes partir sans les taxer en France. Mais le fait de ne pas taxer les expatriés n’est pas une fatalité, c’est un choix qui a été fait par la France, et on pourrait en faire d’autres. Les États-Unis, par exemple, font le choix inverse qui consiste à dire que si vous êtes né aux États-Unis, et que vous quittez le pays, même à l’âge de 2 mois, vous continuerez à payer des impôts aux États-Unis jusqu’à la fin de vos jours. Peut-être que ces deux systèmes sont trop extrêmes à leur manière, et qu’on peut imaginer un entre-deux ? Par exemple, si vous avez été résident fiscal en France pendant un certain nombre d’années, vous allez devoir continuer à y payer des impôts encore quelques années, même après avoir quitté le pays. Car si vous y êtes devenu milliardaire, c’est à l’évidence en partie parce que vous avez bénéficié des infrastructures publiques françaises, de travailleurs qui ont été formés dans les écoles françaises, des biens et des services publics du pays. Il n’y a aucun droit naturel à s’expatrier une fois fortune faite. Il faut simplement se libérer de l’étau de pseudo-contraintes qui limite le débat public.
Un autre exemple de ces pseudo-contraintes, c’est la taxation des multinationales. Pendant longtemps, le discours tenu par le pouvoir en place consistait à dire que si on les taxait trop, elles allaient délocaliser leurs bénéfices à l’étranger, et qu’il valait donc mieux baisser le taux d’imposition sur les sociétés pour les convaincre de rester chez nous. Sous le quinquennat Macron, ce taux est ainsi passé de 33 à 25 %. Mais, en 2021, a été préparé un accord international sur l’imposition minimale des sociétés multinationales avec un taux de 15 %. C’est intéressant, car cela montre qu’il n’y a rien de naturel ni d’inéluctable dans la logique de la concurrence fiscale internationale. C’est un choix qui est fait, entre pays, d’avoir ou pas un taux minimum. Maintenant, l’un des débats qu’il faudrait avoir pendant cette campagne présidentielle est le suivant : est-on satisfait de ce taux de 15 % ou souhaite-t-on aller au-delà ? Dans un pays où les gens payent en moyenne 50 % de leurs revenus en impôts, 15 % pour les acteurs économiques les plus puissants, qui ont le plus bénéficié de la mondialisation et de l’intégration économique européenne, est-ce vraiment l’idéal ? Pourrait-on envisager d’autres taux, par exemple 25 % ? Cela permettrait de dégager 25 milliards d’euros supplémentaires par an, qui pourraient être utilisés pour baisser les impôts des classes moyennes et populaires ou pour investir dans la recherche, l’enseignement supérieur et les services publics.
Camille Landais : Le débat public est pollué par le tapage fait autour de ces fausses contraintes, la prétendue délocalisation des hauts revenus ou des profits des multinationales. En réalité, des études ont été faites pour mesurer précisément ces phénomènes. Est-ce que certains Français très fortunés ont fui l’ISF ? Oui, évidemment, mais le nombre de ces départs pour des raisons fiscales est très faible. L’expérience nous montre que baisser les impôts auxquels sont soumis les plus fortunés pour les encourager à rester en France ou à s’y installer entraîne toujours une perte considérable de recettes fiscales : on perd ainsi bien plus que ce qu’on gagne à les ménager.
De l’autre côté de l’échelle des revenus, les propositions pour le pouvoir d’achat des catégories populaires se concentrent sur l’augmentation des salaires, notamment le Smic – 1 400 euros net immédiatement pour Jean-Luc Mélenchon, 1 500 euros en fin de mandat pour Yannick Jadot, par exemple. Est-ce possible ?
Gabriel Zucman : C’est possible et cela peut se faire simplement grâce à l’outil fiscal. Il faut se souvenir que, dès le Smic, les gens payent beaucoup d’impôts par le biais des cotisations sociales : la CSG et la CRDS représentent quasi 10 % du revenu de chacun. On pourrait tout à fait imaginer qu’au niveau du Smic, ces taxes soient supprimées ou fondues au sein d’un nouvel impôt sur le revenu qui pourrait être très faible ou nul, avec ensuite un taux progressif. Cela permettrait d’augmenter tout de suite de 10 % le salaire net de ces travailleurs à bas salaires, et donc leur pouvoir d’achat. C’est un débat qu’il faut avoir, parce que c’est une anomalie internationale : aucun autre pays n’a, comme la France, un système mixte avec une flat tax importante dès le premier centime d’euro gagné, puis un impôt sur le revenu progressif mais mité de niches fiscales et qui rapporte assez peu sur les plus hauts revenus !
Camille Landais : La question du pouvoir d’achat dans le bas de la distribution des revenus va se poser en raison de deux points clés. Le premier, c’est que l’on ne sait pas où va aller l’inflation dans les mois à venir. Le deuxième enjeu, c’est l’urgence climatique : si on n’a pas mis en place des outils qui nous permettent d’organiser une redistribution de manière flexible, simple et transparente, afin de redonner du pouvoir d’achat aux bas revenus dans les prochaines années, on va au-devant de grandes difficultés.
La question du pouvoir d’achat découle directement de celle des inégalités ?
Camille Landais : La question du pouvoir d’achat est intéressante, car elle ajoute à la dimension des revenus celle des prix des biens consommés par les gens à ces différents niveaux de revenus. Ce qu’on a appris au cours des vingt dernières années, c’est à quel point les niveaux d’inflation sont différenciés selon les niveaux de revenus et l’évolution des prix des différents paniers de consommation. Mais le pouvoir d’achat ne dit pas tout, notamment sur la question du bien-être, de la santé, de l’éducation ou des perspectives dans la vie, qui sont autant de dimensions importantes des inégalités.
Cette question du pouvoir d’achat figure aujourd’hui au sommet des préoccupations des Français : 45 % d’entre eux la placent en haut de leurs priorités, selon un sondage Odoxa. Comment l’expliquez-vous ?
Gabriel Zucman : La crise du pouvoir d’achat, c’est la conjonction de deux phénomènes : la stagnation des salaires depuis quinze ans et l’augmentation des loyers, des frais de santé et d’énergie. Quelles solutions apporter ? On peut agir de deux façons. Soit par des politiques visant à augmenter les revenus primaires avant impôts et avant transferts – par exemple, en augmentant le Smic. Soit par le biais des politiques fiscales, en jouant sur les impôts et sur la redistribution. Les États qui arrivent le mieux à lutter contre les inégalités – les pays scandinaves, notamment – se servent de ces deux leviers. Ils ont à la fois une politique volontariste en matière d’égalisation des revenus primaires et des systèmes de redistribution fiscale élaborés. En France, on pourrait donc supprimer la CSG et la CRDS au niveau du Smic. On pourrait aussi faire en sorte d’avoir une politique de lutte contre le changement climatique qui se traduise par un dividende climatique visible sur les feuilles d’impôts. Qu’est-ce que cela veut dire ? On l’a vu au moment des Gilets jaunes. La tentative de création de la taxe carbone a suscité un rejet très fort car cela engendrait des pertes de pouvoir d’achat. Pour que des dispositifs de ce type soient acceptés, il faut que leurs recettes soient intégralement redistribuées. Plusieurs façons de faire existent. On peut envoyer des chèques un an après, de façon peu transparente, peu lisible. Ou bien essayer d’intégrer la redistribution au niveau même des bulletins de salaire, en y ajoutant simplement une ligne qui dirait : « Votre salaire est augmenté de 100 euros correspondant à une redistribution immédiate et complète des revenus tirés des taxes sur les carburants. »
Pour que les Français gagnent plus, suffirait-il de travailler plus, que ce soit dans la semaine ou tout au long de la vie ?
Camille Landais : Il y a de nombreuses manières d’aborder le sujet. La première grande réponse, c’est que l’idée de travailler plus va à l’encontre des deux cents dernières années de développement économique. C’est un fait historique : quand on est plus riche, quand on se développe et qu’on est plus productif, on travaille moins. De ce point de vue, je ne pense pas que l’avenir de l’humanité soit de revenir aux charges de travail d’il y a deux siècles. Ensuite, il y a de nombreuses raisons politiques pour lesquelles la valeur travail est importante. Ça a été une très bonne manière de capter un électorat populaire, pour lequel le travail est la seule source de revenus et structure fortement les statuts sociaux. La valeur travail a par exemple été un ciment de l’électorat communiste pendant une longue période. Cette valeur a un petit peu disparu du discours politique de gauche au cours des années 1990 et 2000. Et le sarkozysme a eu l’idée géniale de se rattacher à cette valeur pour ramener à droite une partie des déçus de l’extrême gauche. Mais ces visions n’ont rien d’économique. Par exemple, il n’est pas vrai que les différences de niveau de PIB par tête entre pays de l’OCDE s’expliquent par les différences de temps de travail. Tellement de choses sont fausses dans ce discours qu’on ne sait pas par où commencer !
« L’idée de travailler plus va à l’encontre des deux cents dernières années de développement économique »
Gabriel Zucman : En effet, si on veut augmenter le pouvoir d’achat, il ne faut pas aller à rebours de l’histoire en travaillant plus, mais bien augmenter le revenu par heure travaillée, donc la productivité. Et comment augmente-t-on la productivité ? En investissant dans l’éducation, la formation, l’enseignement supérieur, la recherche. Tout le monde est à peu près d’accord avec ces idées. Après, si l’on regarde en pratique les montants alloués à l’enseignement supérieur sous les quinquennats Sarkozy, Hollande puis Macron, c’est une baisse continue des dépenses par étudiant. Donc là, il y a plus qu’une hypocrisie. Il y a une anomalie, une faillite intellectuelle et politique qu’il faut dénoncer vigoureusement. Ça fait maintenant trois quinquennats, avec des gouvernements de sensibilités différentes, qu’on mène cette politique qui, à terme, appauvrit dramatiquement la France et va contribuer à la poursuite de la stagnation, voire au déclin des salaires dans les années à venir. Voilà un sujet sur lequel il faudrait qu’il y ait un débat plus précis dans le cadre de la campagne présidentielle : combien mettre concrètement dans les universités, pour assurer des parcours multidisciplinaires de qualité, pour inverser cette tendance à la baisse des dépenses par étudiant, pour offrir des formations au meilleur niveau international qui répondent aux attentes des étudiants actuels ?
Sommes-nous contraints par l’endettement public ?
Gabriel Zucman : On en revient à cette question des fausses contraintes. Les taux d’intérêt sont très bas ; si la dette publique est élevée, la charge du paiement des intérêts est en fait à un niveau plutôt historiquement faible. Donc, il y a des possibilités budgétaires réelles.
À trois mois de cette présidentielle, est-ce que vous espérez, en tant qu’économistes, que certains sujets soient débattus sur le fond ?
Camille Landais : La chose qui m’angoisse de manière fondamentale, c’est l’absence de débat sur un Green New Deal, un package de mesures climatiques. Il est vraiment important de rappeler que c’est notre dernière chance ! Après 2022, la seule autre opportunité d’en parler, ce sera 2027, et ce sera déjà beaucoup trop tard. C’est donc vraiment la question que je voudrais voir émerger dans le débat public aujourd’hui. Cela dit, je ne me fais pas non plus d’illusions, et je me dis que c’est aussi notre responsabilité d’économistes d’être capables de le nourrir, d’apporter davantage de propositions à ce sujet. Ce sont des questions complexes et si nous, chercheurs, ne participons pas aux débats, ces sujets ne vont pas émerger spontanément de la tête d’une équipe de campagne.
Gabriel Zucman : Une autre question fondamentale qu’il faudrait aborder, c’est la manière dont, concrètement, on réoriente la construction européenne, c’est-à-dire comment faire évoluer les traités existants vers des institutions plus soutenables. L’intégration économique européenne actuelle se caractérise par une concurrence fiscale sanctifiée, puisque la règle de l’unanimité s’impose en matière fiscale pour toute politique commune, ce qui contribue à enrichir les plus grands gagnants de l’intégration économique européenne, dont l’imposition fond : les hauts revenus, les grands patrimoines et les grandes sociétés multinationales. Ça ne peut que conduire à un désamour entre les classes populaires et moyennes et l’Europe. D’ailleurs le divorce est déjà bien entamé, mais il pourrait encore s’accentuer. C’est un premier problème. Le second, c’est que face à ce constat, les propositions formulées sont trop pauvres. Soit on dit qu’il faut tout envoyer balader, sans jamais préciser au profit de quels traités alternatifs ; soit on exalte de manière un peu creuse l’idée d’Europe, sans expliquer clairement comment répondre aux lourds problèmes structurels existants. J’attends donc des candidats qu’ils nous disent clairement comment ils comptent réorienter la construction européenne, avec quels partenaires et quelle coalition de pays, autour de quelles idées, et selon quelle démarche unilatérale ou à plusieurs pays. On ne va pas attendre que l’Irlande, la Hongrie, le Luxembourg et Malte soient d’accord pour un taux minimum d’imposition des multinationales de plus de 15 % ! Est-ce qu’il y a aujourd’hui des hommes et des femmes politiques qui seraient prêts à dire : « Si j’accède au pouvoir, j’irai à 25 %, même si certains partenaires européens bloquent ! » et capables d’expliquer la démarche qu’ils suivraient ? Serait-elle purement unilatérale ? Passerait-elle par la formation d’une coalition de pays, et, si oui, laquelle ? Il est urgent de nouer des alliances avec des partenaires possibles pour donner un horizon d’évolution et, à terme, créer un effet d’entraînement.
Camille Landais : D’autant plus qu’il y a une véritable main tendue de la part de la nouvelle coalition allemande. Leur accord de coalition est incroyable, surtout d’un point de vue français. On rêverait d’avoir ce niveau de détails dans les propositions politiques. Et sur la question des traités, ils sont assez offensifs. Nous disposons donc peut-être d’une fenêtre d’opportunité pour faire bouger les choses. Il ne faudrait pas la gâcher.
Propos recueillis par ÉRIC FOTTORINO & JULIEN BISSON
Dessins SERGE BLOCH
Les inégalités, un choix politique ?
Gabriel Zucman
Camille Landais
Les économistes Gabriel Zucman et Camille Landais partagent le constat que la politique d’austérité menée au long des trois derniers quinquennats est fondée sur une erreur de diagnostic et a nettement contribué à creuser les inégalités en France.
[Inégalités]
Robert Solé
À cause de cette fichue épidémie, leur pouvoir d’achat en a pris un sacré coup ! Les patrons des entreprises du CAC 40 n’ont touché en moyenne que 3,8 millions d’euros en 2020, soit 1 million de moins qu’en 2019.
A-t-on abandonné la question sociale ?
Vincent Martigny
Membre du comité éditorial du 1, le politiste montre comment la substitution du concept de catégorie socioprofessionnelle à celui de classe a profondément modifié le discours de la gauche, devenu moins structurel.








