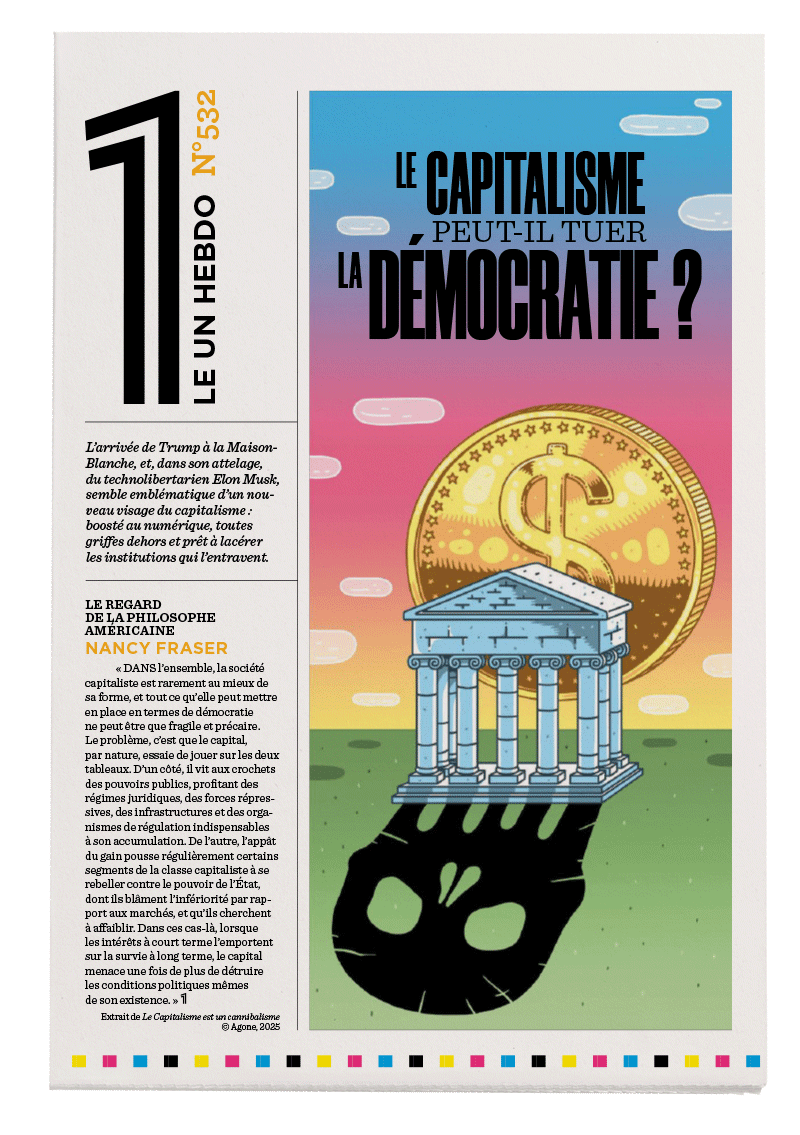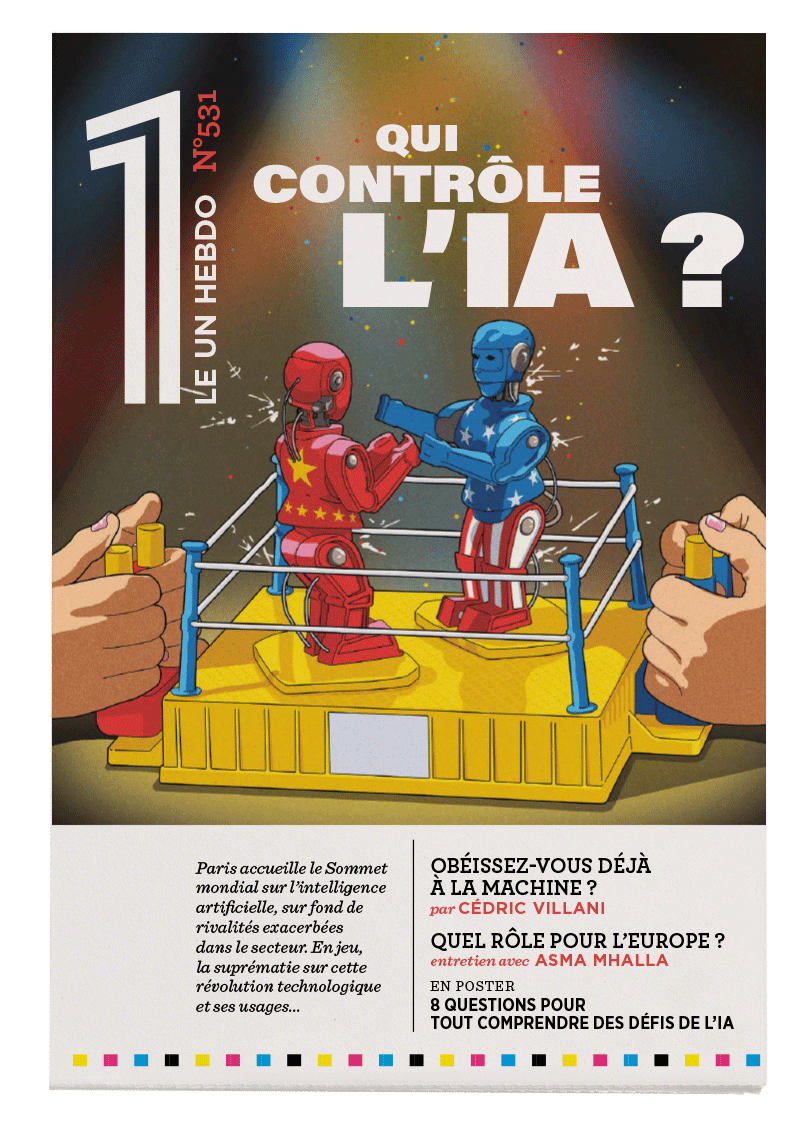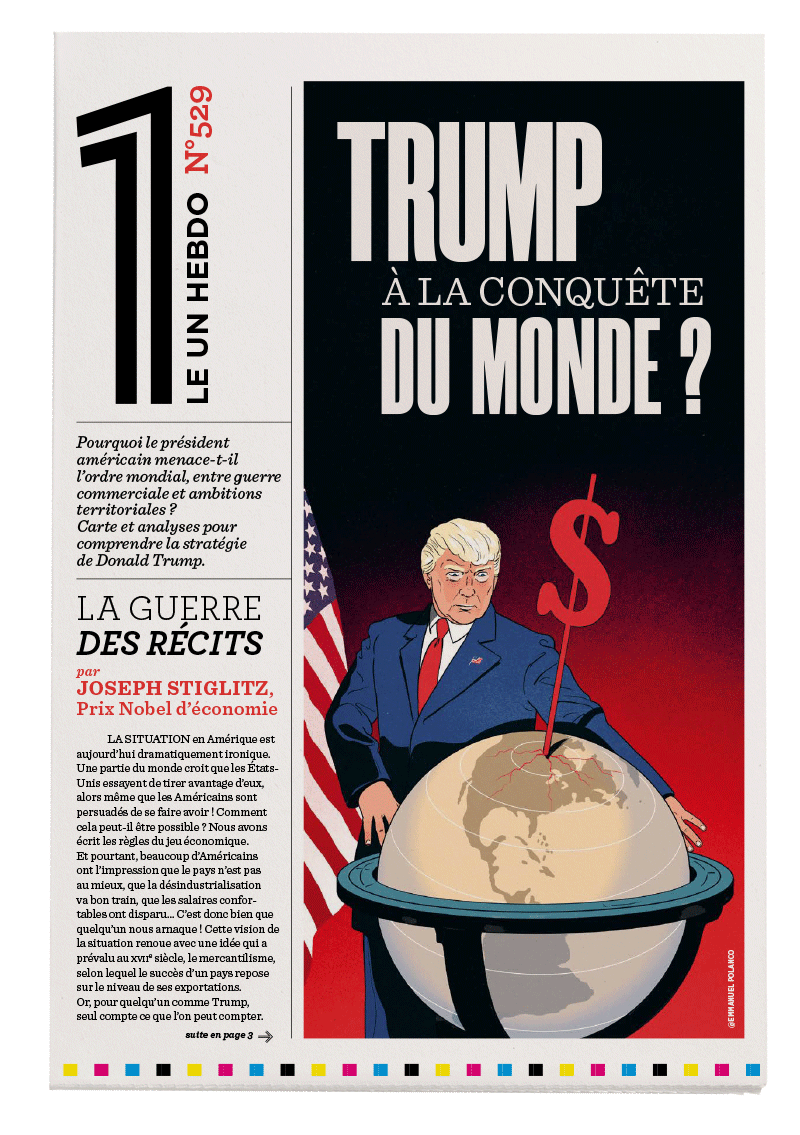Joe Sacco
Porter le crayon dans la plaieTemps de lecture : 5 minutes
Les rayonnages de bandes dessinées se sont désormais habitués à porter de longs récits graphiques, usant de l’art du dessin pour mieux explorer le réel. Des Chroniques de Jérusalem de Guy Delisle au Printemps à Tchernobyl d’Emmanuel Lepage, du Saison brune de Philippe Squarzoni au Monde sans fin de Christophe Blain et Jean‑Marc Jancovici, la BD documentaire s’est imposée au fil des ans comme une étrange auberge de papier, capable de réunir sous son toit des familles variées de lecteurs. Une façon à la fois noble et populaire de transmettre le savoir, qui contribue désormais activement au prestige du neuvième art.
Mais il n’en était pas encore de même au tout début des années 1990, lorsqu’un journaliste américain encore inconnu d’une trentaine d’années a publié un gros volume de 300 pages dans un noir et blanc charbonneux, récit d’un reportage en immersion dans les territoires palestiniens occupés pendant la première intifada. Paru sous forme de série aux États-Unis entre 1993 et 1995, Palestine va révéler au monde de la BD le nom – et la méthode – de Joe Sacco. Deux mois à tenir le crayon, observer, noter, documenter, mais aussi à tendre l’oreille, à écouter les voix oubliées, à leur rendre leur part d’humanité. Quant au dessin, il est à la fois sobre et expressif, autant que le texte est abrasif. « C’est le premier livre que j’ai réalisé dans ce genre que j’appelle “BD-journalisme”, et donc le livre qui m’a montré le chemin que je suis depuis », se souvient l’auteur. « Dans Palestine, on trouve aussi un humour très particulier qui marchait plutôt bien à l’époque, mais qui ne me semble plus approprié à mes ouvrages les plus récents. »
Deux mois à tenir le crayon, observer, noter, documenter, mais aussi à tendre l’oreille, à écouter les voix oubliées, à leur rendre leur part d’humanité
Depuis ce coup d’éclat, Joe Sacco a en effet continué de porter le crayon dans la plaie, trimbalant sa silhouette fluette sur tous les continents. Parfois, il croque des récits courts, de l’Irak au Caucase en passant par Malte, son île natale, en partie réunis dans le recueil Reportages. Le plus souvent, ce sont des documentaires de longue haleine, où le texte, dense, généreux, vient mettre en relief le choc des images, leur offrir un contexte, une profondeur historique, un brin d’empathie aussi. Dans Goražde par exemple, paru en 2000, Sacco retrace le calvaire des habitants de cette enclave bosniaque et musulmane, martyrisés par leurs voisins serbes. Dans Jours de destruction, jours de révolte (2012), c’est aux zones sinistrées du rêve américain qu’il s’intéresse avec le reporter Chris Hedges, depuis la réserve lakota de Pine Ridge, ravagée par l’alcoolisme, jusqu’aux banlieues à l’abandon du New Jersey, ou aux champs de tomates de Floride où s’épuisent les migrants. L’an passé encore, Joe Sacco portait ses carnets jusqu’en Inde avec Souffler sur le feu, récit des émeutes sanglantes opposant musulmans et hindous dans l’Uttar Pradesh.
Mais c’est encore vers le Proche-Orient que ses crayons le ramènent, inlassablement. Depuis le succès de Palestine, qui lui a valu un American Book Award, le dessinateur a consacré deux autres ouvrages au conflit israélo-palestinien. Le premier, Gaza 1956 : en marge de l’histoire, paru en 2009, retrace de façon magistrale l’histoire des massacres méconnus de Rafah et de Khan Younès, commis en marge de la crise de Suez. Près de 400 civils palestiniens tombèrent alors sous les balles israéliennes, dans l’indifférence de la communauté internationale. Joe Sacco revient avec émotion sur cet épisode funeste, l’extirpe des notes de bas de page de l’histoire, pour comprendre les rouages de ces tueries, mais aussi les graines de colère semées alors dans les camps de réfugiés. La bande de Gaza, nous dit Sacco, est une plaie ouverte, une blessure jamais refermée où prospèrent la haine et le désespoir. Pas étonnant dès lors de l’avoir vu publier à l’automne dernier Guerre à Gaza, un « cri » d’une trentaine de pages en réponse au conflit en cours. Cette fois, pas de reportage sur place, pas d’enquête minutieuse, mais un pamphlet contre la complicité de l’Amérique dans le massacre engagé depuis quinze mois, en même temps qu’un dégoût généralisé envers le Hamas comme le gouvernement de Netanyahou.
« De par sa nature profonde, le dessin est un acte subjectif, la BD-journalisme doit donc pour moi permettre d’embrasser cette subjectivité »
Tout le sens de son travail est là, dans cette révolte contre le grand char de l’Histoire, piloté par des fous ou des tueurs, et prêt à écraser sans gémir les petites gens. Joe Sacco lui oppose la puissance du récit, le salut de la mémoire, l’hommage rendu aux victimes. À chaque fois, dans ses reportages, la même attention au détail et aux personnages rencontrés – le même soin, aussi, de dénuder les discours qui viennent nourrir la violence et la justifier. Lui-même n’est pas absent de ses récits. Presque à chaque page, il est là, reconnaissable à ses lunettes opaques et à ses lèvres charnues, témoin accablé des horreurs de l’époque. « De par sa nature profonde, le dessin est un acte subjectif, la BD-journalisme doit donc pour moi permettre d’embrasser cette subjectivité », explique-t-il. « Je crois sincèrement que la subjectivité autorise une certaine liberté que de nombreux journalistes américains ne se permettent pas, trop drapés dans leur neutralité ! Je suis un personnage de mes histoires. Les interactions que j’ai avec les gens sont un matériel essentiel de mon travail, particulièrement lorsqu’elles révèlent quelque chose d’une situation ou d’un événement. »
À bientôt soixante-cinq ans, Joe Sacco use moins qu’avant ses semelles de vent. Il n’en reste pas moins un bourreau de travail, obsédé par les projets insensés. Depuis plusieurs années, il prépare une épaisse biographie dessinée des Rolling Stones. Mais son œuvre la plus incroyable reste sans doute son livre--accordéon sur la Grande Guerre : cette fresque de sept mètres de long représente le premier jour de la bataille de la Somme, le 1er juillet 1916, reconstituée heure par heure, depuis la promenade matinale du général Haig jusqu’à l’inhumation des tués. Terrible résumé de ce qu’est la guerre, dans toute son affreuse banalité.
« L’Ukraine nous protège d’une Troisième Guerre mondiale »
Timothy Snyder
L’historien américain Timothy Snyder, spécialiste de l’Europe centrale et orientale, déconstruit la mythologie européenne pour mieux nous aider à prendre la mesure de ce qui se joue dans la guerre en cours en Ukraine.
[Après-guerres]
Robert Solé
CHAQUE guerre a ses mérites, chantait Brassens, qui ne cachait cependant pas son penchant pour celle que l’on qualifie de « Grande »...
À qui profite la paix ?
Renaud Bellais
Quoi qu’on en dise, peu d’États et d’entreprises tirent véritablement avantage des situations de guerre : entretien avec l’économiste Renaud Bellais.