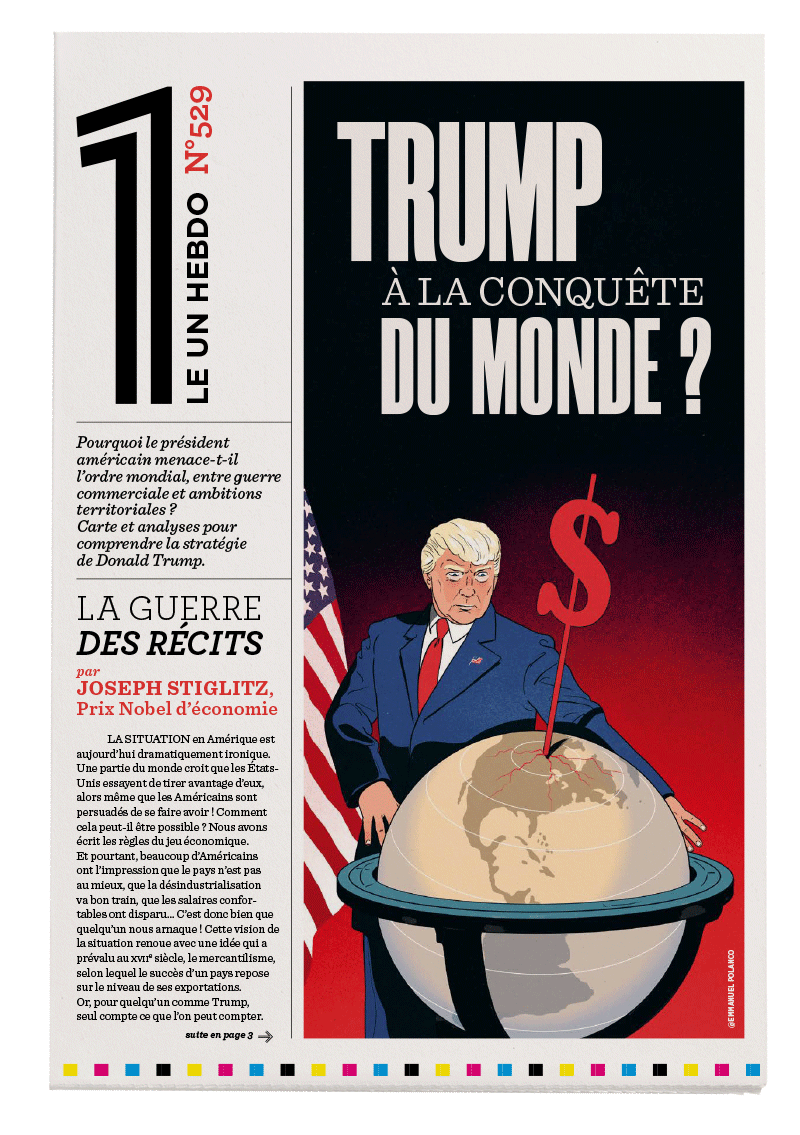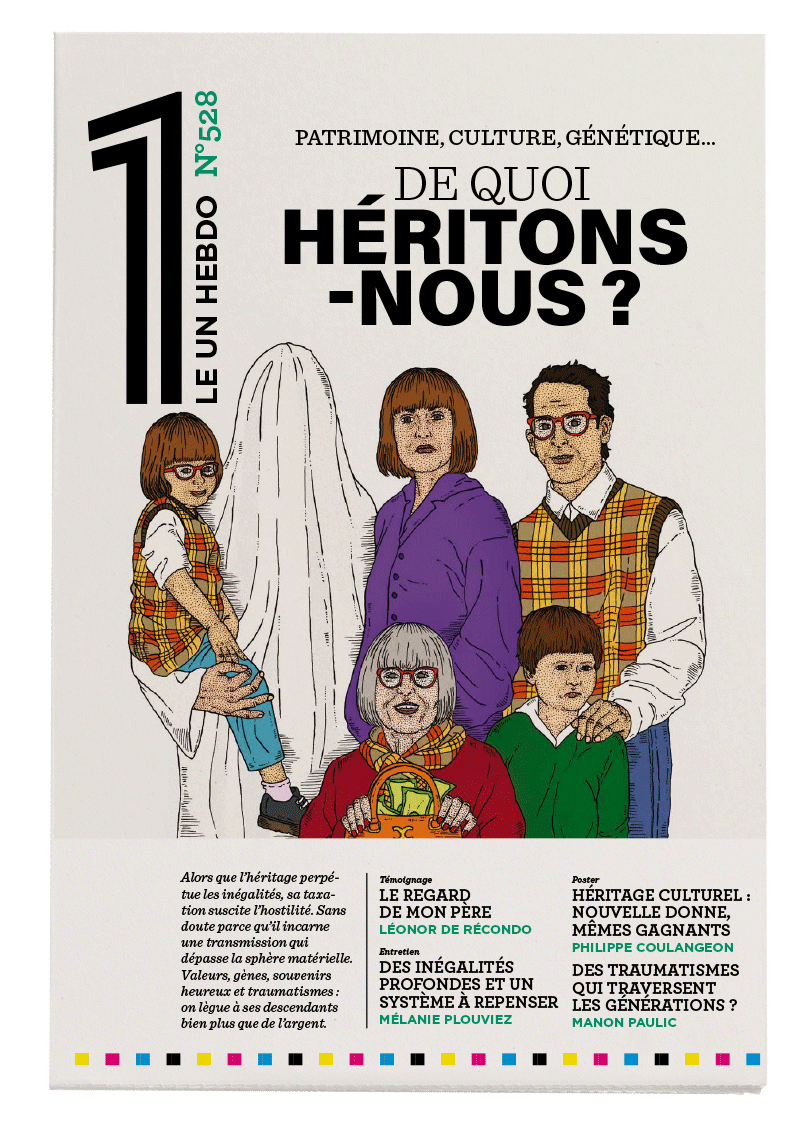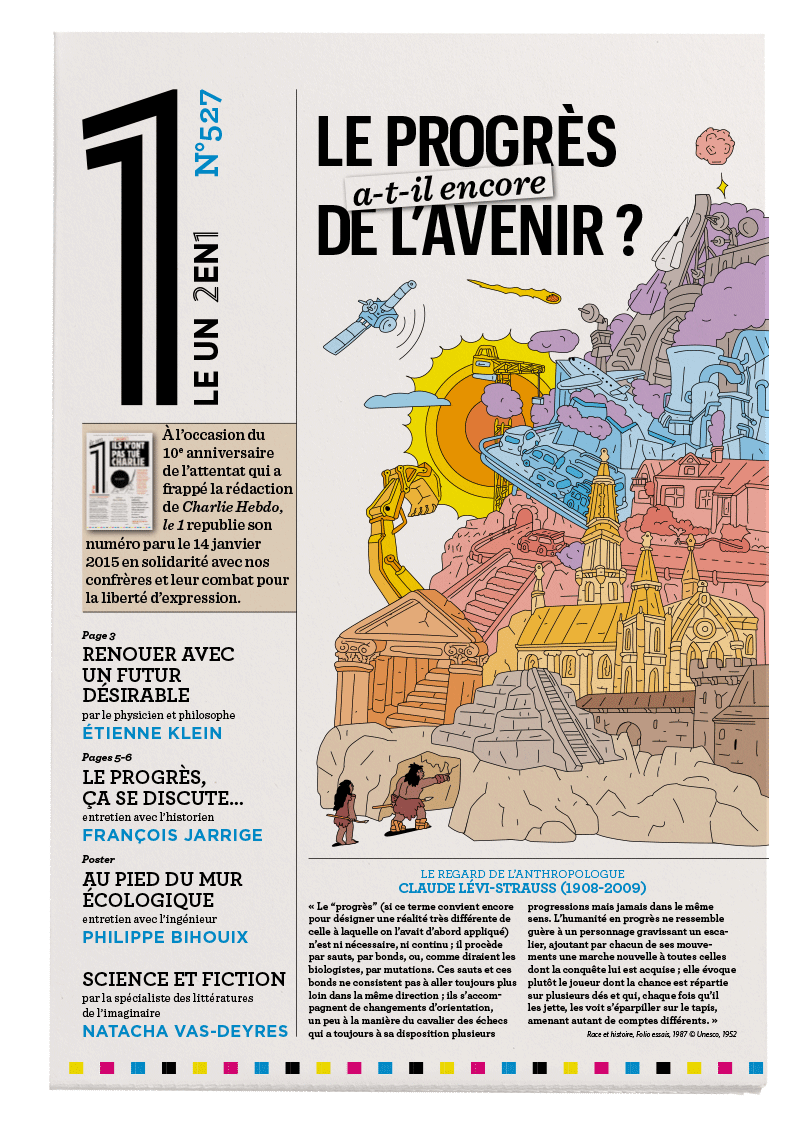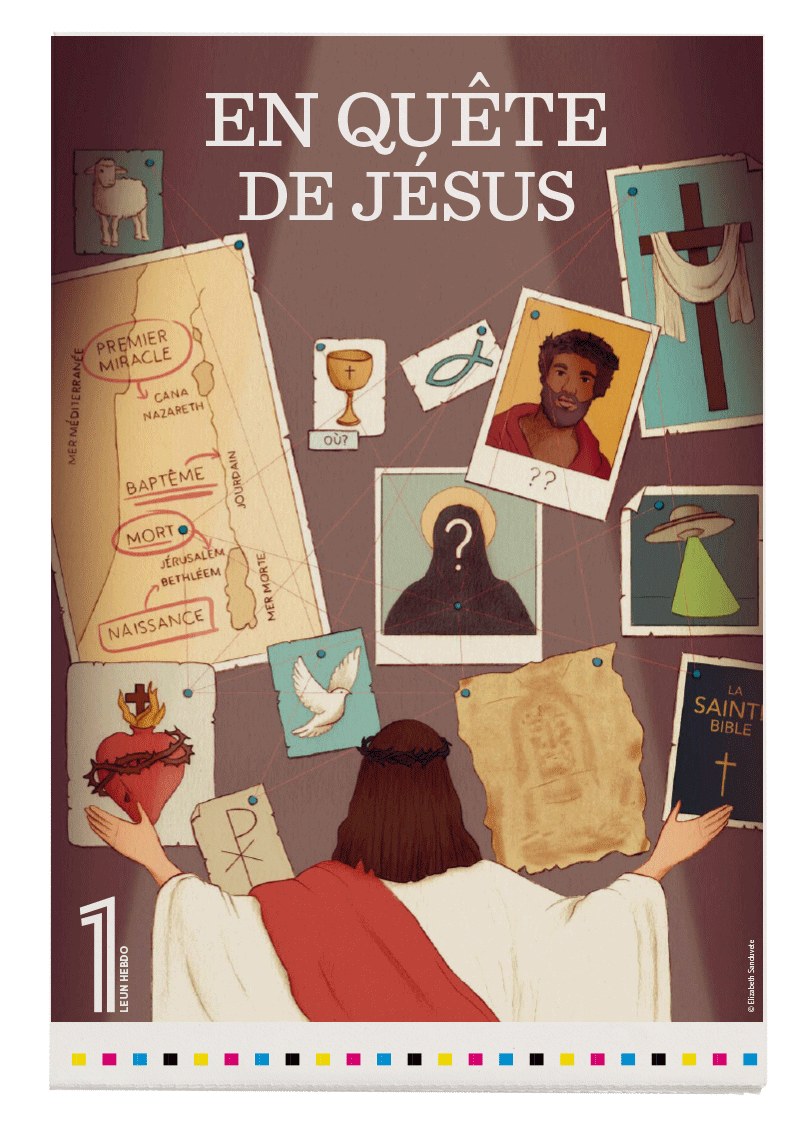La guerre des toiles
Temps de lecture : 8 minutes
On y revient toujours. Les frères Lumière contre Georges Méliès, le documentaire contre l’imaginaire. Dès la naissance du cinéma, en 1895, ces deux genres de récit s’opposent, et aujourd’hui encore, même s’ils ont trouvé une façon de vivre ensemble. Quand les opérateurs Lumière arpentent le monde pour en raconter les faits et gestes, Georges Méliès, lui, fabrique des images qui nourrissent les rêves, parfois les cauchemars. La science-fiction – et plus encore le corpus « films de l’espace » qui s’y rattache – n’a cessé de dessiner cette médaille et son revers (sans préciser ce qui est l’endroit et ce qui est l’envers) : allier la rigueur scientifique et les fantasmes de la fiction, les découvertes technologiques et la peur de l’inconnu.
Et que croyez-vous qu’il arriva ? Ce fut Georges Méliès qui gagna. En 1902, inspiré par Jules Verne, il tourne Le Voyage dans la Lune,qui met en scène le professeur Barbenfouillis (effectivement, sa barbe est en fouillis). Seize minutes de bonheur. Un petit pas pour l’homme, un grand pas pour le cinéma. S’il faut insister sur ces origines, c’est pour dire qu’à l’heure où le monde était occupé à s’industrialiser et où le voyage dans l’espace était loin d’être effectif, l’imaginaire précédait, comme souvent, la raison ; Gaston Bachelard n’avait pas encore défini ses « rêveries de la volonté » que le cinéma en dessinait déjà les prémices. Après Méliès, d’autres cinéastes « primitifs » ont raconté l’espace, mais il faudra attendre l’après-guerre pour que le cinéma s’y replonge avec force – Destination Lune (1950) et Planète interdite (1956), aux titres évocateurs, sont les deux films-références de l’époque.
Que les deux grandes périodes de la conquête de l’espace au cinéma soient les années 1950 et 1970 n’est pas étonnant. La première correspond au moment où la technologie et l’ambition politique permettaient d’envisager d’aller visiter le cosmos (Kennedy lance le « programme Apollo » en 1961), la seconde, après la balade de Neil Armstrong sur la Lune, poussait les Américains à voir encore plus loin. Oui, les Américains… Il n’a échappé à personne que la « filmographie intergalactique » est essentiellement américaine.
On va y revenir, mais il faut avant cela préciser ces voyages sur grand écran. D’un côté, les extraterrestres arrivent sur Terre ; de l’autre, les humains conquièrent l’espace. Le premier groupe dessine une métaphore, notamment en pleine guerre froide. Le message est belliciste : l’ennemi est l’alien, sous-entendu le Russe. Ou le pacifiste : il faut se mettre d’accord, sinon l’humanité court à sa perte, comme dans Le Jour où la terre s’arrêta (1951) avec le premier extraterrestre gentil du cinéma, Klaatu, personnage rare dans le genre. Le second groupe raconte un avenir potentiel – habiter l’espace et sauver la Terre –, répond à une interrogation métaphysique – sommes-nous seuls dans l’Univers ? – et dessine, lui aussi, une métaphore : conquérir l’espace, c’est se placer en tête des nations du monde.
Nous y revoilà. America great again… Quand le cinéma explore le monde, il met en scène une vision politique, au sens large, même en orbite ou en route pour Jupiter. Exemples : L’Étoffe des héros et Apollo 13, mélanges d’aventure romanesque et de récit historique. Deux grands succès. Le premier, réalisé par Philip Kaufman en 1983, met en parallèle le destin de Chuck Yeager, premier pilote à franchir le mur du son en 1947, et celui de l’équipage du programme Mercury, qui réussit le premier vol orbital américain en 1961. Le second, signé Ron Howard et sorti en 1995, retrace le déroulement de la mission pour la Lune de 1970 qui a failli virer au drame. Leur popularité est loin d’être anecdotique ; elle offre un large écho à ce que ces voyages sur grand écran tentent de dire du monde dans ces années-là.
Chacun, à leur manière, diffuse ce sous-texte : les États-Unis sont un pays qui brasse du romanesque, fiction et réalité mêlées, pour raconter la façon dont il voit – et compte ordonner – le monde. Ici, le héros messianique et l’engagement collectif sont portés aux nues et la planète se façonne à l’aune de l’engagement des « forces du bien » – toujours cette bonne vieille guerre froide (et des étoiles), même si elle paraît plus complexe aujourd’hui, vu le nombre de pays qui y participent.
Tiens, parlons-en de cette Guerre des étoiles, puisque le dernier volet de la saga imaginée par George Lucas – dès 1973 ! – est actuellement à l’affiche. Si on veut bien accrocher cette saga à trois (excellents) films sortis récemment Interstellar (Christopher Nolan, 2014), Premier contact (Denis Villeneuve, 2016) et Ad Astra (James Gray, 2019), on voit se dessiner la façon dont le cinéma raconte l’espace aujourd’hui… Et elle n’est pas différente d’hier, finalement. La Guerre des étoiles, c’est du romanesque XXL qui oppose des valeurs ancestrales communes à l’humanité (pour faire simple, le combat du bien contre le mal). Interstellar verse, lui, dans la fiction de la science, proche en cela de Philip K. Dick, pour explorer les théories d’un autre espace-temps. Premier contact voit des extraterrestres débarquer sur Terre et une scientifique essayer de les comprendre alors que la guerre est proche – élan pacifiste dans un environnement où l’inconnu domine toujours. Quant à Ad Astra, l’histoire d’un astronaute parti aux confins de l’Univers à la recherche de son père et, peut-être, d’une autre vie, il joue la carte métaphysique (qui somme-nous ? où allons-nous ?) avec un plaisir certain. Les fantasmes, les peurs, les désirs, les rêves, tout ce qui nourrit un imaginaire plus ou moins commun, sont donc toujours de la partie. Les cinéastes actuels sont peut-être moins visionnaires qu’il y a soixante ans, à l’époque où la conquête spatiale ressemblait encore à un « conte de fées » ; ils sont sans doute davantage attachés aux faits, mais ils restent des raconteurs d’histoires et, en cela, des voyageurs de l’imaginaire.
Mais des voyageurs qui se trouvent de plus en plus confrontés aux connaissances scientifiques. Ni Méliès ni les cinéastes des années 1950-1960 n’avaient évidemment conscience de la réalité spatiale. L’esthétique de 2001, avec son grand vaisseau high-tech, sert non seulement à « faire beau », mais aussi à figurer un ailleurs dont la blancheur virginale ajoute au malaise du spectateur. Par opposition, le bazar du Faucon Millenium de Han Solo paraît beaucoup plus sympathique. Et plus proche de la réalité. Comme le sont les habitacles minuscules d’Apollo 13 et de Gravity. Ou le matériel technique du Seul sur Mars de Ridley Scott, censé coller au discours scientifique. Ainsi le genre est aujourd’hui sans cesse partagé entre la reproduction documentée, puisqu’aujourd’hui on touche du doigt le voyage spatial pour tous, et le fantasme, puisque l’espace reste un lieu de rêve et de cauchemar. Conclusion (provisoire) et souriante : l’espace et le film d’espace n’ont pas de limite et bougent sans cesse.
On pourrait aussi résumer l’affaire en remarquant que si les « films de l’espace » sont largement moins nombreux que les polars ou que les westerns, ils peuvent s’enorgueillir d’être mieux placé qu’eux dans les dictionnaires du septième art, et cette liste définit l’éclectisme du genre. Le premier film (court) de fiction : Le Voyage dans la Lune. Le plus mauvais film de l’histoire : Plan 9 from Outer Space d’Ed Wood en 1959. Le plus commenté au monde : 2001, l’Odyssée de l’espace de Stanley Kubrick (1968). Le film réalisé par le plus philosophe des cinéastes : Solaris d’Andreï Tarkovski (1972). La plus grande saga du cinéma : La Guerre des étoiles (1977-2019). Le film le plus flippant : Alien de Ridley Scott (1979)…
Aventure humaine, interrogation scientifique, envolée existentielle : les sujets que traitent tous ces films sont finalement les mêmes depuis le Big Bang du septième art, soit depuis Méliès et les Lumière. Seules les avancées technologiques et l’imaginaire humain protéiforme ont permis de renouveler sans cesse ces récits. Tant qu’il y aura des questions sur l’Univers, le cinéma continuera de tourner.


« Lutter contre le réchauffement et explorer l’univers vont de pair »
Claudie Haigneré
La conquête spatiale semble avoir été mise en sommeil ces dernières décennies. Fait-elle aujourd’hui l’objet d’un nouvel élan ?
La communauté…
[Déjà-vu]
Robert Solé
Comment oublier ce moment historique ? Pour la première fois, un homme foulait le sol de la Lune. On l’a vu, revêtu de son scaphandre, descendre de l’engin spatial, puis faire quelques pas. Et, déjà, il était rejoint p…
À l’école de l’espace
Manon Paulic
ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN (Bas-Rhin). Debout sur l’estrade, Christina Giannopapa lève les yeux vers la grappe d’étudiants qui occupe l’amphithéâtre. La pièce est chaleureuse. Sur les murs habillés…