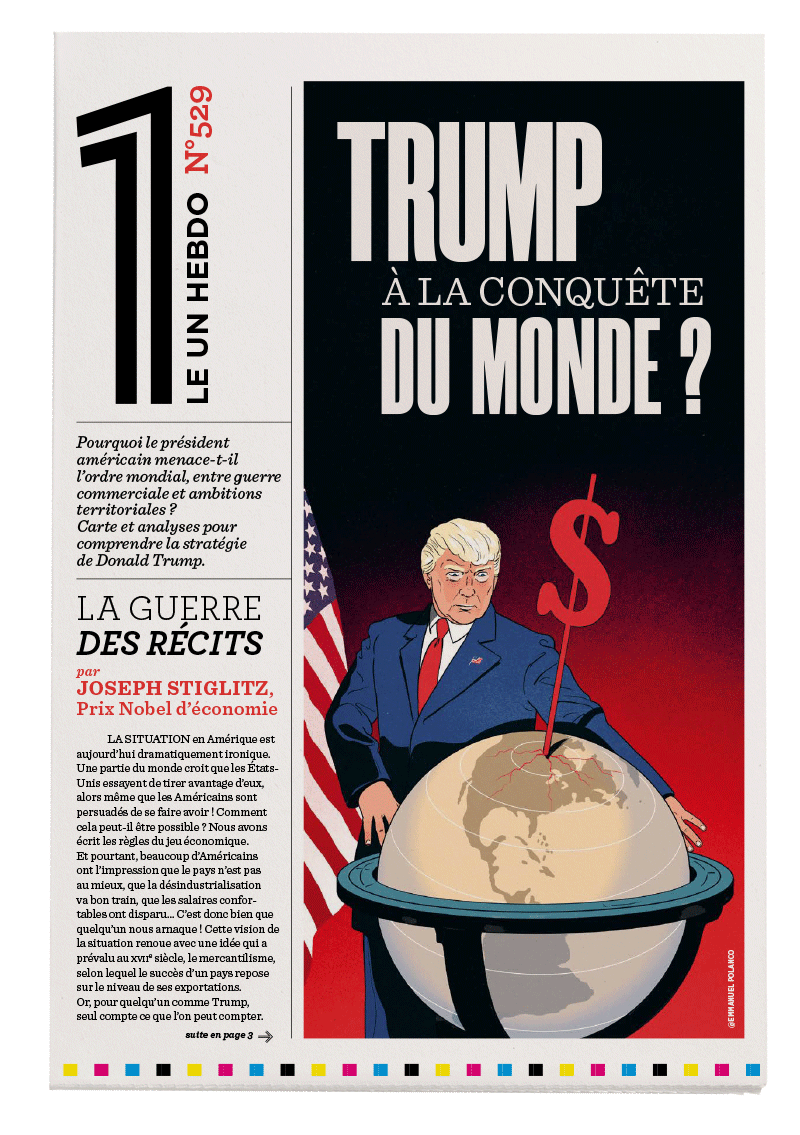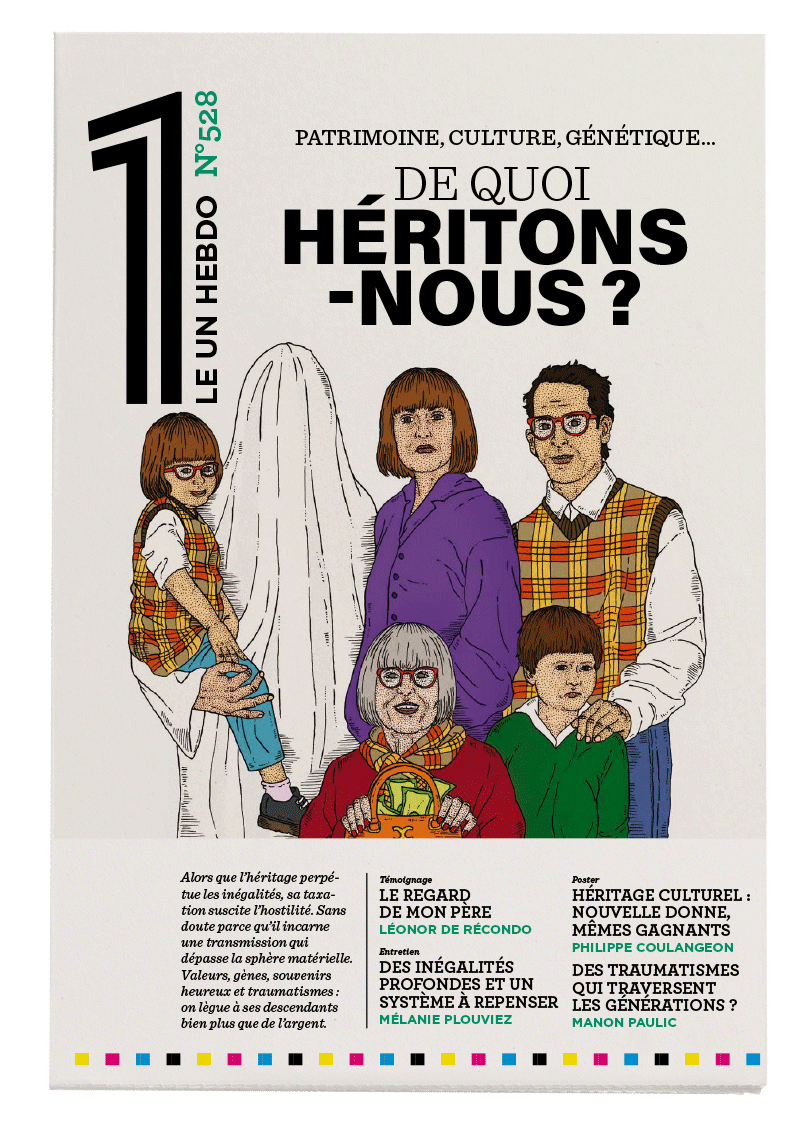En 1977, Senghor et le chorégraphe Maurice Béjart vous confient la mission de diriger le premier centre de danse africaine contemporaine, Mudra-Afrique. Quelle danseuse êtes-vous alors ?
Je dis toujours que j’ai l’instinct béninois et le geste sénégalais. Je suis née au Bénin et je suis venue au Sénégal vers l’âge de 9 ans. J’ai étudié à Dakar puis dans un lycée parisien, où j’ai reçu mon diplôme de professeure d’éducation physique et sportive. C’est au cours de mes affectations dans des lycées de jeunes filles au Sénégal que j’ai commencé à faire danser des élèves. J’ai créé ensuite mon premier studio.
On parle alors de mon travail au président Senghor, lui qui voulait faire du Sénégal la Grèce de l’Afrique. Il avait la littérature, les arts plastiques. Il lui manquait la danse, le premier des arts au Sénégal et en Afrique. Senghor a demandé à voir mon travail. Il l’a apprécié, mais a voulu avoir l’avis de son ami Maurice Béjart, qui a été impressionné par mon travail, ma technique de danse. Senghor a ensuite mis à sa disposition le Musée dynamique, où les Sénégalais avaient pu découvrir Soulages, Picasso… puis toute la peinture nouvelle sénégalaise et africaine.
Quel est votre projet ?
C’est vraiment une mission. L’idée est de concevoir une danse contemporaine africaine qui sera goûtée par tous. Senghor a énoncé les bases de cette danse dans la préface de mon livre Danse africaine. Il y a un moule commun, mais les élèves disposent de beaucoup de liberté. Il fallait qu’un danseur puisse être chanteur, acteur, musicien, qu’il fasse de son corps un instrument total. La danse classique est enseignée par le Cubain Jorge Lefebre, le solfège par le Sénégalais Julien Jougua, les rythmes par son compatriote Doudou N’diaye Rose. On apprend aussi la technique de jeu théâtral, et différents professeurs dispensent des cours de danse traditionnelle venant d’ailleurs. Leurs élèves serviront de cobayes à ma technique de danse africaine contemporaine, qui se diffusera dans le monde entier.
Cette technique n’a rien de commun avec la danse contemporaine de l’époque…
Je suis inspirée par la nature. La colonne vertébrale est l’arbre de vie, la poitrine le soleil, les fesses la lune, et le pubis les étoiles. Le symbole de ma technique, c’est le fromager, un arbre énorme dont les racines s’enfoncent profondément. Il s’élance vers le ciel pour capter de nouvelles influences, mais reste lui-même. Il s’agit de donner et de recevoir, selon le précepte si cher au président Senghor.
Mudra a duré tant qu’il était là. Après son départ, son successeur Abdou Diouf ou bien son entourage n’ont pas voulu prolonger sa politique culturelle. Mudra-Afrique a fermé ses portes au bout de cinq ans, en 1982. Mais une idée ne meurt jamais… C’est à ce moment-là que j’ai rencontré mon mari Helmut Vogt, et nous avons fondé l’École des sables en 1998, à Toubab Dialaw, au sud de Dakar.
Senghor intégrait la culture à un grand projet politique. Quelle peut être la place du corps dans cette optique ?
Certains écrivent. Moi, ma plume, c’est mon corps. Donc si j’ai envie de dire des choses, je les dis avec mon corps, et je continuerai. Parce que quand on danse avec le corps, on n’a pas parlé. On n’a pas dit. Alors on ne peut rien vous faire, n’est-ce pas ?
Avant de rencontrer Senghor vous aviez dansé son poème « Femme nue, femme noire ». C’était votre premier solo, il y a plus de cinquante ans. Qu’aviez-vous ressenti ? Qui était votre modèle ?
Je n’avais pas de modèle noir, je n’avais jamais vu de danseuse noire. Pour moi, le seul modèle noir, c’était la Vierge noire à qui je vouais une dévotion. Celle de la basilique de la Daurade à Toulouse, ou celle de Lyon.
Je n’imaginais pas avant que je pourrais danser en solo. Ça n’existait pas au Sénégal. Cela s’est passé au théâtre Daniel-Sorano, Joseph Zobel disait le poème. Je m’étais fait accompagner par un technicien avec un bugarabou [triple ou quadruple tambour] et je jouais moi-même de la kôra. Je me demande comment j’ai pu, seule avec un technicien, avoir l’idée de faire la musique et de danser dessus. J’ai lu après, dans des journaux français, qu’à la même période les solos se sont beaucoup développés en France et en Europe. J’ai l’impression que, parfois, une chose nouvelle, par une sorte de transcendance qui dépasse les frontières, arrive en même temps dans différents pays.
Je me souviens que peu après, Maurice Béjart est venu au Sénégal avec les élèves de Mudra, l’école qu’il avait fondée à Bruxelles en 1970. Ils ont eux aussi dansé des poèmes de Senghor. Diane Gray, l’une des danseuses, a même fait un solo sur une lecture de « Femme nue, femme noire ». J’étais dans la salle et je me disais : « Maurice, Maurice... », puis j’ai rencontré le président Senghor et je lui ai dit : « Maurice Béjart a fait danser “Femme nue, femme noire”. Et moi, j’ai dansé “Femme nue, femme noire”. Qu’en pensez-vous ? » Il a répondu : « Vous, vous avez dansé la femme du Sahel et, elle, elle a dansé la femme de la forêt. » Donc, les deux étaient valables. Il était très diplomate !
La chorégraphie du Sacre du printemps de Stravinsky par Pina Bausch vient d’être recréée avec trente-six danseurs venus de différents pays africains. Vous-même êtes sur scène avant l’ouverture du ballet pour un duo avec Malou Airaudo. Qu’est-ce qui a changé ces dernières années ?
La danse n’est pas aidée, mais, heureusement, les jeunes danseurs s’accrochent et travaillent ; la danse urbaine a explosé, la danse contemporaine aussi. De jeunes Sénégalais gagnent des concours, mettent toute leur foi dans la danse. Et en Afrique, de manière plus générale, n’en parlons pas ! La compagnie burkinabè Salia nï Seydou et plein d’autres voyagent à travers le monde.
Ce Sacre, qui réunit des danseurs de quatorze pays africains, a brisé tous les codes. C’est un projet gigantesque, et notre École des sables a formé la majorité des participants de ce ballet historique. On a transmis à ces danseurs le même Sacre qu’aux Européens. Avec la technicité, l’élégance, la précision de la chorégraphie de Pina Bausch. Mais bon, comme je l’ai dit, l’émotion n’est pas dans le cou-de-pied ; l’émotion est dans le buste. Et je peux vous dire que, depuis que ces danseurs africains dansent le Sacre, ils donnent beaucoup d’émotion.
Propos recueillis par IMAN AHMED