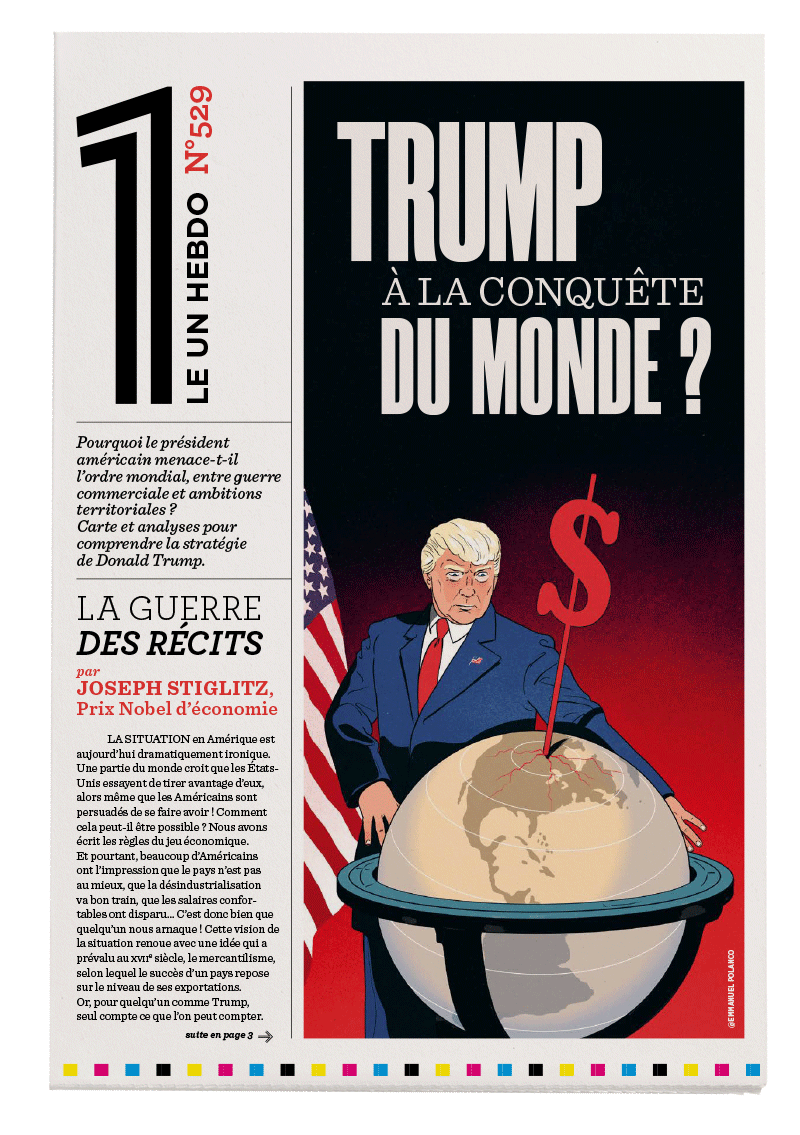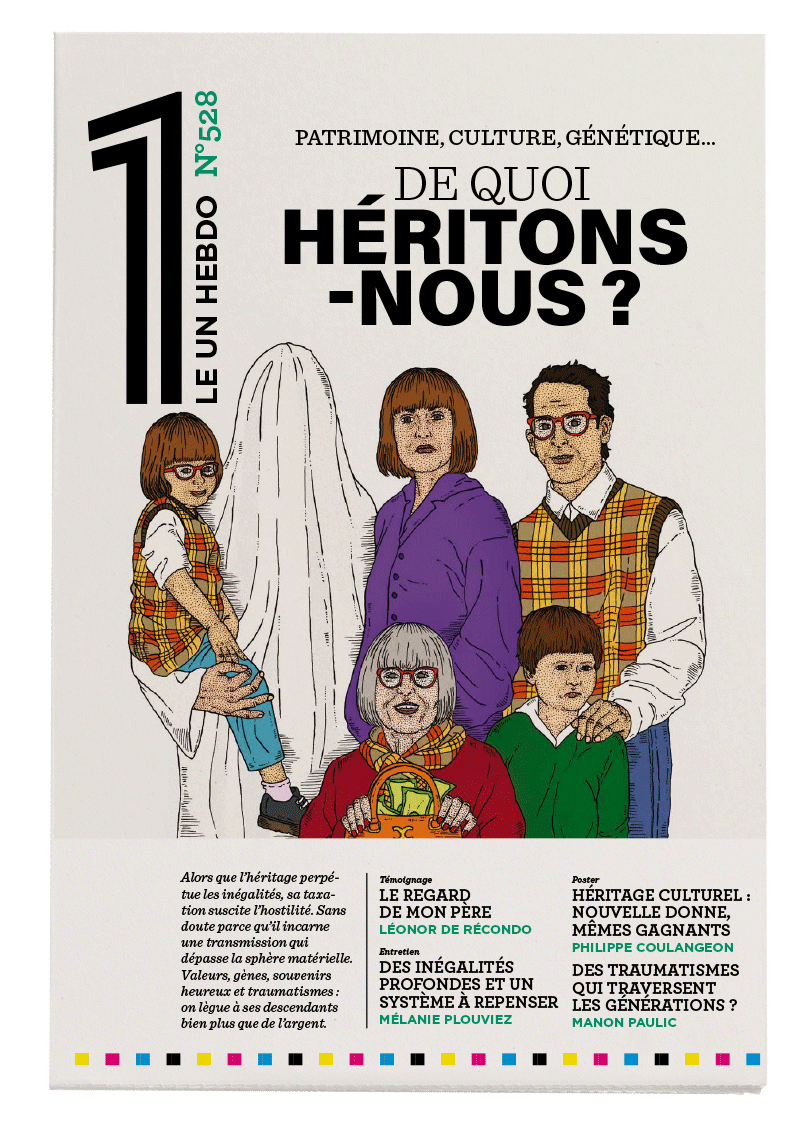Léopold Sédar Senghor souhaitait qu’on ne retînt de lui, tout compte fait, que la poésie, bien sûr. Mais c’est le malheur des grands morts, et notre privilège, parfois notre devoir, qu’on puisse désobéir à leur testament pour mieux déchiffrer leur existence. Celle de notre homme fut si longue, riche, combative, ambiguë, paradoxale, multiple, que je crois impossible d’en saisir le sens profond si on l’ampute de la moindre de ses dimensions. C’est tout entier qu’il faut (com)prendre Senghor ; et alors seulement voit-on combien la pensée philosophique, l’action politique et la création poétique furent, chez lui, subsumées sous la culture.
Voilà l’une des pierres angulaires du Sénégal. Je ne suis pas chauvin, mais je pense que si ce tout petit pays d’Afrique de l’Ouest, globalement pauvre, est (re)connu, s’il jouit encore d’une sorte d’estime, faisant même parfois, à diverses occasions et à mon grand étonnement, figure d’exemple sur le continent africain, c’est surtout pour sa culture. Le pays produit, qu’elles travaillent sur place ou ailleurs, une quantité extraordinaire de figures artistiques et intellectuelles mondialement célébrées et respectées dans leur domaine. Nombre de ces hommes et de ces femmes ont été formés, en partie, au Sénégal ; ils portent avec eux non seulement la culture de leur pays, enracinée, mais aussi une certaine vision de la culture, ouverte et humaniste. Ces personnes – j’en fais peu ou prou partie – ont leur talent, leur force de travail, leur génie personnel ; mais il me semble évident qu’elles viennent d’une tradition d’excellence intellectuelle et de rayonnement par la culture dont Senghor fut, sinon le fondateur, du moins l’acteur le plus décisif. Et le plus exemplaire : enfant, comme j’aimais les livres et les jeux de lettres, comment me surnommait-on, parfois ? « Petit Zeng. » C’était l’un des petits surnoms de Léopold, dans ma famille. Avant même de connaître Senghor, j’ai compris ce qu’il symbolisait. Je ne suis pas le seul.
Il croyait au pouvoir réel, c’est-à-dire révolutionnaire, de la culture
À cause des grands mythes culturels qu’il a créés (le premier Festival mondial des arts nègres de 1966, à Dakar, par exemple), et de l’aura quasi mystique dont le mot de Culture – il lui mettait souvent une majuscule – se pare dans son œuvre, je me représente souvent Senghor en une sorte de bagnard infatigable. Il appartenait à une génération de Sisyphes africains dont le rocher ne pouvait être plus ingrat. Après tant de siècles au cours desquels la capacité à porter et créer une culture fut déniée aux « Nègres », c’était à cette génération que revenait l’exténuante tâche de démontrer l’inverse, de prouver que cette culture existait, était riche, et se situait aux origines de l’odyssée humaine. Senghor n’a pas reculé devant la montagne. Sans doute n’était-il pas dupe du piège de la Négation qu’il combattait : vouloir prouver à l’Autre qu’on a une culture aussi valable que la sienne, c’était encore donner à cet Autre le pouvoir de la reconnaître ou non. Pouvait-il, cependant, faire autre chose ? Y avait-il d’autres manières de lutter pour la culture, sinon que de lutter par la culture, d’en faire le moyen et la fin, la preuve et le verdict de toute dignité humaine ? Peut-être. Mais c’est parce qu’il a, avec d’autres, mené ce combat, que cette question n’en est plus une pour des Africains de ma génération.
Il y a quelques années, lors de polémiques le concernant, je me commettais d’office avocat de sa cause, avec la passion et l’intransigeance de la jeunesse. J’estimais que nombre de ses détracteurs ne l’avaient pas lu, ou alors superficiellement. J’avais souvent raison. Plus je l’ai lu, cependant, et moins il m’a été facile de le défendre tout le temps et pour tout. Les évolutions de l’homme et de ses idées, ses positions fines, nuancées, fluctuantes, parfois ambiguës, quelquefois erratiques, sur certains sujets, m’ont obligé à une prudente retenue. Mais voilà tout Senghor : il vous oblige à l’attention, à la patience, à une lecture serrée, extensive, et dans le temps.
Il croyait au pouvoir réel, c’est-à-dire révolutionnaire, de la culture. C’est pour cela que j’ai toujours trouvé injuste qu’on lui reproche, comme homme politique, d’avoir choisi la culture plutôt que la vie concrète (l’économie, par exemple), comme si la culture ne faisait pas partie, n’était pas une expression concrète de la vie concrète. De toutes ses définitions de la culture, celle que je préfère date d’un texte de 1950 (« Le problème de la culture », dans Liberté 1 : négritude et humanisme, Seuil, 1964) : « La Culture, écrit-il, pourrait être définie comme la civilisation en action. » Ce dernier mot est crucial : l’action. Sédar, fidèle à ce prénom sérère*, n’a pas à avoir honte de la sienne. Je l’imagine même heureux, tenant à bout de bras cette grosse pierre, la culture, dont certains se demandent parfois à quoi elle sert, et à qui il répondrait que « c’est là, dans cet effort de Sisyphe, que réside la grandeur de l’Homme ».
* Dans la langue de ce peuple, troisième ethnie du Sénégal, en nombre, après les Wolofs et les Peuls, Sédar signifie « qu’on ne peut humilier ».