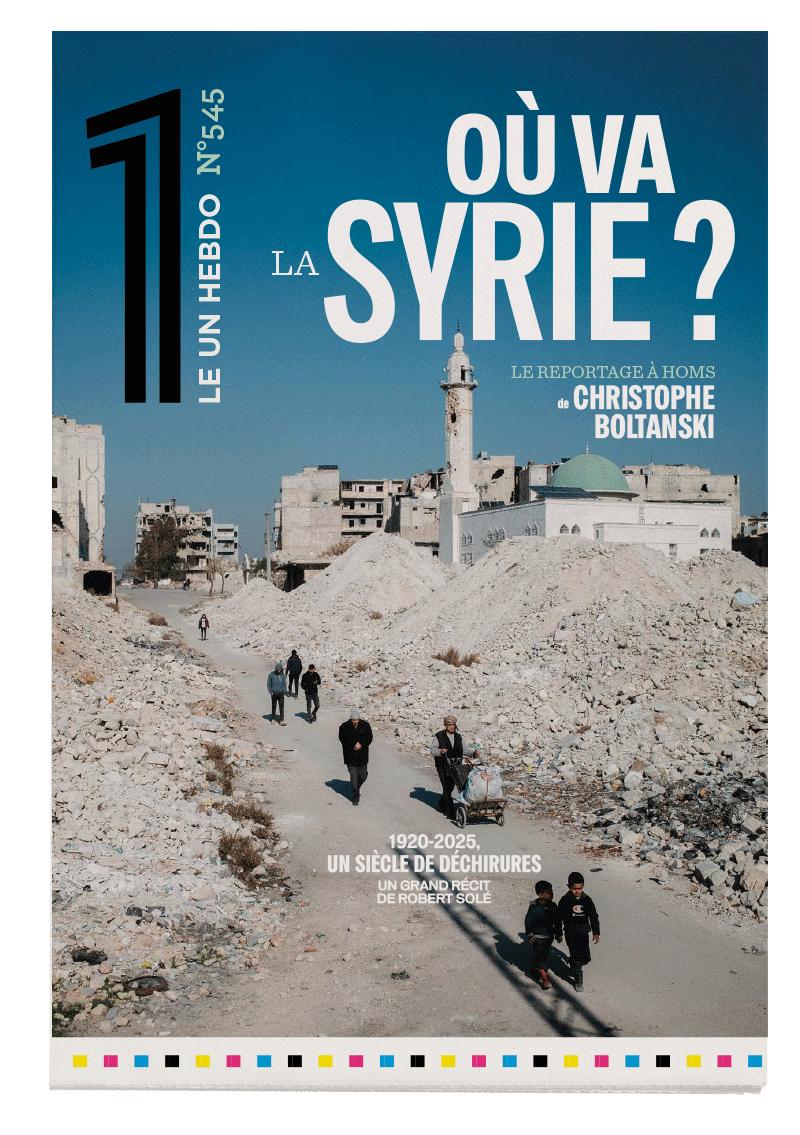« Culture d’abord ! » Ce mot d’ordre, Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire et leurs amis noirs le lancent à Paris dans les années 1930. Le futur président du Sénégal restera fidèle toute sa vie à ce credo. Il ne cessera de marteler à son peuple, au risque d’être incompris des plus humbles, que la culture est supérieure à toute autre forme d’activité humaine. À ses yeux, la culture précède la politique, et l’engagement militant présuppose une émancipation personnelle, le rejet de l’assimilation, la volonté d’être soi-même et de vivre en accord avec sa « négritude », ce concept forgé dès 1935 par Césaire et Senghor pour célébrer les valeurs des peuples noirs.
Chez Senghor, la prise de conscience culturelle remonte à son enfance paysanne. À l’heure de la veillée familiale, le petit Sédar, encore illettré, mais intelligent et hypersensible, vibre à l’écoute des contes et légendes que les vieux transmettent à leur auditoire en haleine. Il entend les griots évoquer la grandeur perdue des empires d’autrefois. Il s’émerveille lorsque le dernier roi sérère fait halte au village, magnifiquement chamarré. Le souvenir ébloui de ces visites fastueuses s’imprimera dans la mémoire de l’enfant et du poète. Les émotions et les images, les visions et les rêves des premières années de jeunesse irrigueront les versets de son œuvre.
L’adieu à son « Royaume d’enfance » est un choc culturel. Voici ce gamin studieux confié, pour douze ans, aux missionnaires. Sa première rencontre avec les fastes et les rites du catholicisme impressionne et fait vibrer sa jeune âme païenne. Wolof, français, latin : Léopold découvre et absorbe simultanément trois lexiques, trois grammaires, trois langues non maternelles qui lui deviendront aussi familières que son sérère natal. Il « savoure comme des bonbons » ses premiers mots de français. Il se nourrit du latin « comme d’un lait fort et tonique de paysanne ». Il s’enthousiasme pour Corneille et surtout pour Hugo, qu’il nomme le « Maître du tam-tam ».
Au fil des ans, le jeune homme rêve de devenir prêtre et enseignant, mais s’irrite de la mentalité colonialiste des curés. L’Église, qui le trouve trop indocile, lui barre l’entrée du séminaire. Dégoûté, déprimé, il se sent humilié. Il ne portera jamais la soutane, mais décide de donner un sens à sa vie, en prouvant l’idée d’une « civilisation noire mais égale » : « C’est à ce moment que je perçus que le meilleur moyen de prouver la valeur de la culture noire, c’était de voler aux colonisateurs leurs armes : d’être un meilleur élève encore. » Mission accomplie trois ans plus tard lorsque Senghor, brillant bachelier, s’embarque pour la France. Mais il se sent déjà « déchiré » entre l’éducation familiale et les disciplines scolaires importées d’Europe, entre sa « conscience chrétienne » et son « sang sérère ».
L’adieu à son « Royaume d’enfance » est un choc culturel
Pendant ses trois années de khâgne à Louis-le-Grand, Senghor se jette à corps perdu dans les livres. En même temps qu’il le convertit au socialisme, son camarade Georges Pompidou lui sert d’« éveilleur ». Il l’initie aux textes récents et contemporains. Les romanciers et essayistes : Barrès, Gide, Péguy, Proust, Valéry. Les dramaturges dont ils vont applaudir les œuvres : Claudel, Giraudoux, Montherlant. Les poètes : Apollinaire, Baudelaire, Rimbaud. En exaltant la terre, Barrès le fait rêver de race et de nation. Senghor tient Gide pour le « prosateur classique des temps modernes ». Le Rimbaud d’Une Saison en enfer – « Je suis une bête, un Nègre » – l’émeut profondément. Il emprunte à Claudel la forme du verset poétique.
Son amitié avec le Martiniquais Césaire et le Guyanais Léon-Gontran Damas lui ouvre d’autres horizons. Il se lie avec les sœurs Nardal, trois Martiniquaises qui, le dimanche, à Clamart, transforment leur appartement en un salon littéraire et musical où se retrouve l’intelligentsia noire. Son compagnonnage avec les Antillais et les Antillaises de Paris est décisif. Par leur entremise, il rencontre des penseurs et des écrivains noirs américains en exil, découvre leurs œuvres, apprend par cœur leurs vers. Il lit avec ferveur le sociologue W.E.B. Du Bois, le leader panafricaniste Marcus Garvey, le philosophe Alain Locke. Il s’enthousiasme pour les poètes de la Harlem Renaissance : Langston Hughes, Claude McKay, Countee Cullen, Jean Toomer. Grâce à eux, il remonte aux sources de l’émancipation noire aux États-Unis tout en approfondissant sa propre réflexion identitaire. « Ce fut pour nous une révélation », résumera Césaire. Les deux amis ne cesseront de reconnaître leur dette intellectuelle envers le mouvement négro-américain.
Dans sa quête d’identité, Senghor mûrit sa réflexion à l’écoute et à la lecture de ses maîtres africanistes du Quartier latin, linguistes – Lilias Homburger et Marcel Cohen – ou ethnologues – Marcel Mauss, Paul Rivet et Marcel Griaule, pionniers de l’anthropologie éclairée et du relativisme culturel. Leur enseignement lui apporte un réconfort intellectuel et moral. Un autre maître l’inspire, Maurice Delafosse, mort en 1926. Cet homme de science expliquait à ses étudiants quelques idées simples mais politiquement audacieuses pour l’époque : l’Afrique a sa propre civilisation, ses propres aspirations et ses propres besoins ; son Moyen Âge fut en bien des points comparable à celui de l’Europe ; il n’existe aucune preuve de l’infériorité intellectuelle des Noirs.
Premier agrégé africain de l’Université française, professeur à Tours, ardent militant du Front populaire, Senghor est ébloui jusqu’à l’aveuglement par un autre africaniste, l’Allemand Leo Frobenius (1873-1938), dont les idées-forces l’enfièvrent : le « Nègre barbare » est une invention européenne ; les Africains de l’ère précoloniale étaient « civilisés jusqu’à la moelle des os » ; chaque culture est unique, vouloir les hiérarchiser n’a aucun sens. « Nous sommes autres : ni plus ni moins civilisés que les Blancs », conclut Senghor.
Le monde, selon son goût, « sera métis ou ne sera pas »
La pensée de Senghor présente alors paradoxalement quelque analogie avec les thèses essentialistes, dans la mesure où elle établit la réalité d’une culture propre aux Africains sur un fondement biologique. Pour le Senghor de cette époque, le renouveau négro-africain doit se fonder sur une réalité ethnique. Il reconnaîtra s’être fourvoyé dans une « négritude-ghetto » : « Notre fierté sombra dans le racisme. » Il faudra attendre l’enchaînement des catastrophes – l’arrivée au pouvoir des partis fascistes européens, la guerre et la défaite de la France – pour que prenne fin ce que Senghor tiendra rétrospectivement pour des « années d’ivresse ».
Prisonnier de guerre en France pendant vingt mois, professeur à Saint-Maur-des-Fossés jusqu’à la Libération, Senghor finit par « tomber » en politique. Élu député du Sénégal, il entre au Palais-Bourbon en octobre 1945. Doublement loyal à la France et à l’Afrique noire, il se convertit au métissage culturel comme « idéal d’une civilisation de l’Universel ». Le monde, selon son goût, « sera métis ou ne sera pas ». Deux hommes renforceront cette conviction, un poète et un philosophe. Saint-John Perse incarne à ses yeux « le jalon entre la tradition des griots et la poésie française ». Dans la cosmologie optimiste du savant et penseur jésuite Pierre Teilhard de Chardin, Senghor trouve de quoi étayer son universalisme et raviver sa foi chrétienne chancelante.
En 1945, Senghor rassemble ses poèmes composés depuis 1936 et les publie dans un premier recueil intitulé Chants d’ombre. Un second recueil, Hosties noires, paraît en 1948. À la fin de l’année 1947 survient un événement majeur dans l’aventure intellectuelle des Noirs d’Afrique francophone : la parution du premier numéro de Présence africaine, revue imaginée et animée par le Sénégalais Alioune Diop. Dans son prestigieux comité de parrainage, tous les grands intellectuels français de l’époque côtoient Césaire et Senghor. Fille de la négritude, Présence africaine deviendra son plus bel outil, et, plus généralement, un haut lieu de la pensée noire.
En septembre 1948, Senghor publie son Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de langue française, précédée d’un texte retentissant de Jean-Paul Sartre. Intitulée « Orphée noir », cette préface est une profession de foi où le philosophe veut montrer le lien entre la notion de négritude et la théorie marxiste de la révolution. Senghor ne peut rêver, pour sa cause, d’un meilleur propagandiste. En septembre 1956, il se retrouve avec Césaire et Alioune Diop au centre d’un événement aujourd’hui un peu oublié, le premier Congrès international des écrivains et artistes noirs. Une soixantaine d’entre eux débattent pendant quatre jours à la Sorbonne. Ils viennent d’Europe, des États-Unis, des Antilles et des Caraïbes, d’Afrique et de Madagascar. Lorsque le Congrès s’achève, Diop et Senghor ont atteint leur objectif essentiel : rendre visible l’homme noir, dans sa diversité, au regard de ceux qui refusaient de le voir.
En 1946, Senghor avait consacré son premier discours de député à l’enseignement, « base de l’évolution des peuples », qui a pour but « de préparer à la Culture, d’en donner le goût ». Pendant ses treize années au Palais-Bourbon, il revient souvent sur ce thème. Devenu président du Sénégal en 1960, il met en œuvre une profonde réforme de l’enseignement, africanisant les programmes et les personnels. Il se donne les moyens de son ambition : l’éducation et la culture représentent jusqu’à 33 % du budget de l’État contre 12 % alloués à la défense.
La culture vaut qu’on la célèbre avec joie et fierté. Du 1er au 24 avril 1966, Dakar accueille le premier Festival mondial des arts nègres. Senghor a vu grand : pendant trois semaines, des centaines d’artistes, poètes, écrivains, musiciens, chanteurs, danseurs venus de trente-deux pays et de tous les continents animent ce rendez-vous de l’Afrique avec elle-même et avec sa diaspora.
Parmi les invités de marque figurent Joséphine Baker, Duke Ellington, les chanteuses Marion Williams et Marpessa Dawn, les chorégraphes Katherine Dunham et Alvin Ailey. Cœur symbolique du festival, le « Musée dynamique », inauguré pour l’occasion, accueille une exposition sur l’« art nègre ». Senghor est comblé de pouvoir offrir, sur sa terre natale, une illustration fulgurante de l’irruption en force sur la scène mondiale d’un art une fois pour toutes réhabilité. Ce festival aura été un immense succès pour le Sénégal, un événement dont on parle encore aujourd’hui avec nostalgie à Dakar.