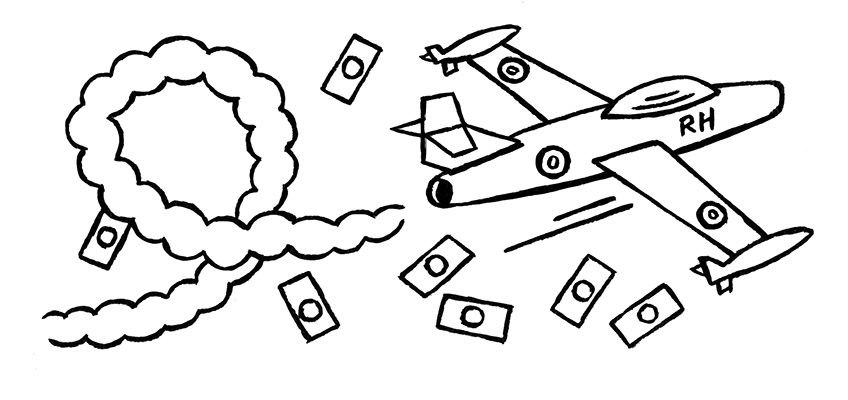« L’enjeu est de sortir d’une spirale d’injustice fiscale »
Temps de lecture : 11 minutes
De qui parle-t-on, quand on parle des riches ?
C’est un terme qui peut se révéler très flou. Pour pouvoir comparer les « riches » de différents pays ou de différentes époques et mesurer les inégalités, le plus simple reste encore d’identifier des groupes statistiques : les 1 % des individus les plus riches, par exemple, qui ont aux États-Unis des revenus supérieurs à 500 000 dollars par an. Ces revenus ont été multipliés par deux depuis 1980 : à l’époque, ils captaient 10 % du revenu national ; aujourd’hui, 20 %. Et si l’on parle de patrimoine, les super-riches – soit le 0,1 % le plus fortuné de la population (plus de vingt millions de dollars) – possédaient 7 % du patrimoine américain en 1980, contre 20 % aujourd’hui – l’équivalent de ce que possèdent les 90 % du bas. En Europe de l’Ouest, ces inégalités étaient semblables en 1980, mais le revenu capté par les 1 % les plus riches ne représente aujourd’hui que 12 % du revenu national. Ce qui prouve que la hausse des inégalités ne peut pas être simplement due à la mutation technologique ou au phénomène de mondialisation – elle est essentiellement le résultat de politiques publiques, en matière d’éducation, de marché du travail, et surtout de fiscalité.
Que s’est-il passé de ce point de vue ?
Depuis les années 1980, on assiste à un déclin général de la progressivité du système fiscal. Aux États-Unis, par exemple, les classes moyennes et populaires payent environ 28 % de leur revenu en impôts, avec un tout petit peu de progressivité pour les plus pauvres, mais avec une exception forte pour les milliardaires qui, depuis la réforme fiscale de Trump, ont un taux d’imposition global d’environ 23 %. C’est comme si vous aviez un impôt proportionnel géant, qui devenait dégressif pour les plus riches ! Dans le détail, on a assisté à une détaxation du capital sous toutes ses formes et à une augmentation de l’imposition du travail. Jusque dans les années 1980, l’Amérique avait un impôt sur les sociétés de 50 %, des taux marginaux sur les dividendes de près de 90 %, des taux de succession allant jusqu’à 80 % – une taxation du capital beaucoup plus lourde que ce qui a jamais pu exister en France. Aujourd’hui, le produit de l’impôt sur les sociétés est passé de 8 % du revenu national à 1 %, quand les cotisations sociales ont fait exactement le chemin inverse.
Que pensez-vous des appels de certains milliardaires à être davantage taxés ?
Il y a quelques années, Warren Buffett avait regretté que son taux d’imposition sur le revenu soit plus faible que celui de sa secrétaire. Mais ce n’est qu’une petite partie du problème. Car Warren Buffett, comme beaucoup de milliardaires, ne tire pas sa fortune de ses revenus : il possède des actions dans une compagnie, Berkshire Hathaway, qui ne verse pas de dividendes. Ses bénéfices sont épargnés ou réinvestis, et augmentent ainsi la valeur de la société. Quand Warren Buffett a besoin d’un peu d’argent, il peut vendre quelques actions : en en vendant quarante, il touchera 12 millions de dollars de plus-value, sur lesquels il sera imposé à 20 %. Mais entre-temps, sa compagnie aura généré des milliards de bénéfices, sur lesquels il n’est pas taxé ! Donc, en réalité, son taux d’imposition, en proportion de son véritable revenu économique, est proche de zéro. Et ce n’est pas l’augmentation de l’impôt sur le revenu qui pourra changer cela.
Comment faire payer ces milliardaires, alors ?
Pour s’attaquer au cœur de l’injustice fiscale, il faut développer des propositions plus ambitieuses, comme celles que font Elizabeth Warren ou Bernie Sanders, avec un impôt sur la fortune qui ferait contribuer les milliardaires à hauteur de leurs revenus : puisque leur fortune croît en moyenne de 8 % chaque année, alors Sanders propose un taux d’imposition sur la fortune de 8 % au-delà de 10 milliards de dollars. C’est audacieux, mais c’est une manière de répondre à une demande de justice fiscale de plus en plus pressante.
Pourtant Reagan et Thatcher hier, Donald Trump et Emmanuel Macron aujourd’hui n’ont-ils pas été élus avec un programme fiscal qui ne cachait pas leur volonté de diminuer l’imposition du capital ?
Ce volet de leur programme n’a jamais été déterminant dans leur élection. Et les études d’opinion montrent qu’aux États-Unis comme en Europe, la population est majoritairement favorable à une augmentation des impôts pour les plus riches. En revanche, tous ces dirigeants ont adopté un discours selon lequel il n’y avait pas d’autre choix possible que celui de baisser les impôts sur le capital. Que la concurrence fiscale allait pousser les grandes fortunes à partir. Que l’imposition des multinationales allait encourager l’exil dans les paradis fiscaux. Et qu’il fallait donc baisser les taux marginaux supérieurs ou supprimer les impôts sur la fortune pour s’adapter à une mondialisation incontrôlable. Mais c’est faux, et c’est en cela que ce triomphe de l’injustice a des airs de déni de démocratie. C’est une analyse ignorante de ce qu’a pu être la taxation avant les années 1980 et qui porte un diagnostic erroné sur ce que peut être la mondialisation.
C’est-à-dire ?
Nous disposons aujourd’hui de traités de libre-échange, mais il n’existe aucune forme de coordination fiscale. Vous avez la possibilité d’avoir un taux d’imposition nul, mais pas celle d’instaurer des barrières douanières ! C’est un choix qui a été fait, mais qui peut être renversé, avec des traités commerciaux qui incluent un volet fiscal. Ensuite, il est faux de dire que les États ne peuvent rien contre les entreprises installées dans des pays où la fiscalité est avantageuse. Si une multinationale française ne paye que 5 % d’impôts dans un paradis fiscal, la France a tout à fait le droit de demander à collecter les 20 % manquants, dans un rôle de percepteur fiscal de dernier recours. Tout comme elle peut décider d’imposer une grande fortune française installée en Suisse, au nom de la contribution nationale qui a permis à cette fortune de se constituer, grâce à l’éducation ou à la santé par exemple. Les États-Unis imposent ainsi à vie tous leurs citoyens, quel que soit leur lieu de résidence. La France pourrait adopter un compromis, qui lui permettrait de continuer à imposer pendant cinq ou dix ans quelqu’un qui s’expatrierait pour raisons fiscales.
Comment interprétez-vous les tergiversations sur la taxe GAFA ?
Mettre davantage à contribution les multinationales qui échappent aujourd’hui à l’impôt, y compris en faisant cavalier seul au début, est une idée importante et nécessaire. Mais pourquoi limiter cette taxe à l’industrie numérique ? La délocalisation des profits dans les paradis fiscaux concerne aussi bien le numérique que l’industrie financière, le luxe ou l’agroalimentaire ! En ciblant ce seul secteur, constitué essentiellement d’entreprises américaines, cette taxe ne pouvait que susciter une levée de boucliers outre-Atlantique. Il aurait été plus difficile pour Trump de dénoncer une agression si la France avait mis en place un système d’impôt minimal pour l’ensemble des multinationales.
Est-il possible de mettre fin aux paradis fiscaux ?
Oui, c’est possible, avec une approche volontariste et si nécessaire unilatérale. Pendant des décennies, on a répété que le secret bancaire suisse était sacro-saint, jusqu’à ce que l’administration Obama vote la loi Fatca : soit les banques suisses divulguaient leurs informations, soit elles étaient tenues de payer des taxes très lourdes, à hauteur de 30 %, sur les dividendes et intérêts en provenance des États-Unis. Les banques ont obtempéré, tous les autres pays ont suivi, et l’échange automatique d’informations bancaires est devenu la norme. Il est possible aujourd’hui, avec un peu de volonté politique, de faire de même avec les paradis fiscaux comme les Bermudes ou les îles Caïmans. Et je suis assez optimiste sur le fait qu’on finisse par y arriver, car les grands États n’ont rien à gagner à poursuivre cette course au moins-disant.
Vous plaidez pour un taux idéal d’imposition pour les très hauts revenus de 60 %, avec un taux marginal supérieur de 75 %. Pourquoi cette idée, proposée par François Hollande en 2012, pourrait-elle réussir aujourd’hui ?
Ça n’a pas marché en France parce que ça n’a pas réellement été essayé. En revanche, ça a longtemps marché aux États-Unis, avec un taux marginal supérieur de plus de 90 % entre les années 1940 et 1970. Roosevelt jugeait même qu’« aucun citoyen américain ne devrait avoir un revenu net, après impôts, de plus de 25 000 dollars par an » (l’équivalent d’un million de dollars aujourd’hui). Or, durant cette période, l’économie ne s’est pas effondrée, bien au contraire ! Taxer ainsi les très hauts revenus a une double motivation : augmenter les recettes fiscales – de près de 4 % du revenu national dans le cas américain –, mais aussi réguler les inégalités en favorisant une meilleure distribution des richesses. Reste que l’impôt sur le revenu n’est qu’un outil, qui a ses limites. Aujourd’hui, c’est avant tout via l’impôt sur la fortune qu’on peut s’attaquer à l’hyperconcentration des richesses.
L’économie a-t-elle besoin de « premiers de cordée », comme l’a affirmé Emmanuel Macron ?
La politique fiscale d’Emmanuel Macron illustre très bien l’impasse dans laquelle la plupart des pays se sont engouffrés depuis les années 1980 : réduire les impôts sur les assiettes fiscales les plus mobiles (bénéfices des sociétés, grandes fortunes), et augmenter ceux sur les assiettes fiscales les moins mobiles (salaires, retraites, petites entreprises…). C’est une impasse car ce n’est pas soutenable : si la mondialisation signifie moins d’impôts pour ceux qui en profitent le plus, et davantage pour ceux qui en sont déjà les perdants, alors cela ne peut que créer un sentiment d’injustice et de révolte, et marquer la fin d’une forme de concorde démocratique. Depuis Reagan, les États-Unis ont fait l’expérimentation des avantages donnés aux « premiers de cordée ». Pour quels résultats ? Une stagnation du revenu moyen des classes populaires, un déclin récent de l’espérance de vie, une explosion du coût de la santé, du logement et de l’éducation, et, politiquement, une dérive ploutocratique qui a mené à l’élection de Trump. Ces conséquences sont incontestables. C’est donc un contresens historique regrettable que d’essayer aujourd’hui d’aller dans cette direction, en espérant que cela améliore la vie des gens.
Y voyez-vous un péril démocratique ?
La ploutocratie elle-même est instable. Je suis frappé par les similarités entre la situation actuelle et le Gilded Age, cette période de prospérité de la fin du XIXe siècle marquée par une fiscalité régressive, une explosion des inégalités et la constitution de grands monopoles privés. Résultat : au début du XXe siècle, il y a eu en quelques années un grand retournement qui a permis de mettre en place le système fiscal le plus progressif au monde. Aujourd’hui, l’émergence de figures politiques comme les démocrates Warren et Sanders aux États-Unis laisse penser qu’un autre modèle est possible. Quant à la France, où les prélèvements obligatoires sont déjà élevés, l’enjeu n’est pas de les augmenter encore, mais de sortir de la spirale d’injustice fiscale en échappant au nihilisme actuel : oui, on peut encore agir et renverser la table, à condition d’y mettre un peu de volonté politique.
Propos recueillis par JULIEN BISSON
« L’enjeu est de sortir d’une spirale d’injustice fiscale »
Gabriel Zucman
De qui parle-t-on, quand on parle des riches ?
C’est un terme qui peut se révéler très flou. Pour pouvoir comparer les « riches » de différents pays ou de diff&…
[Jackpot]
Robert Solé
Les médias nous rebattent les oreilles avec les Arnault, les Bettencourt, les Pinault… Ils ne parlent jamais de nous, richards potentiels, qui sommes des millions.
– Vous ?
– O…
Sus à la pauvreté !
Olivier Babeau
Comme l’avait souligné Tocqueville, la France a la passion de l’égalité. Mais, obsédés par l’idée de limiter la fortune des plus riches, nous prenons le problème par le mauvais bout.
Les différences de fortunes entre les plus aisés et les plus pauvres paraissent aujourd’hui vertigineuses.…