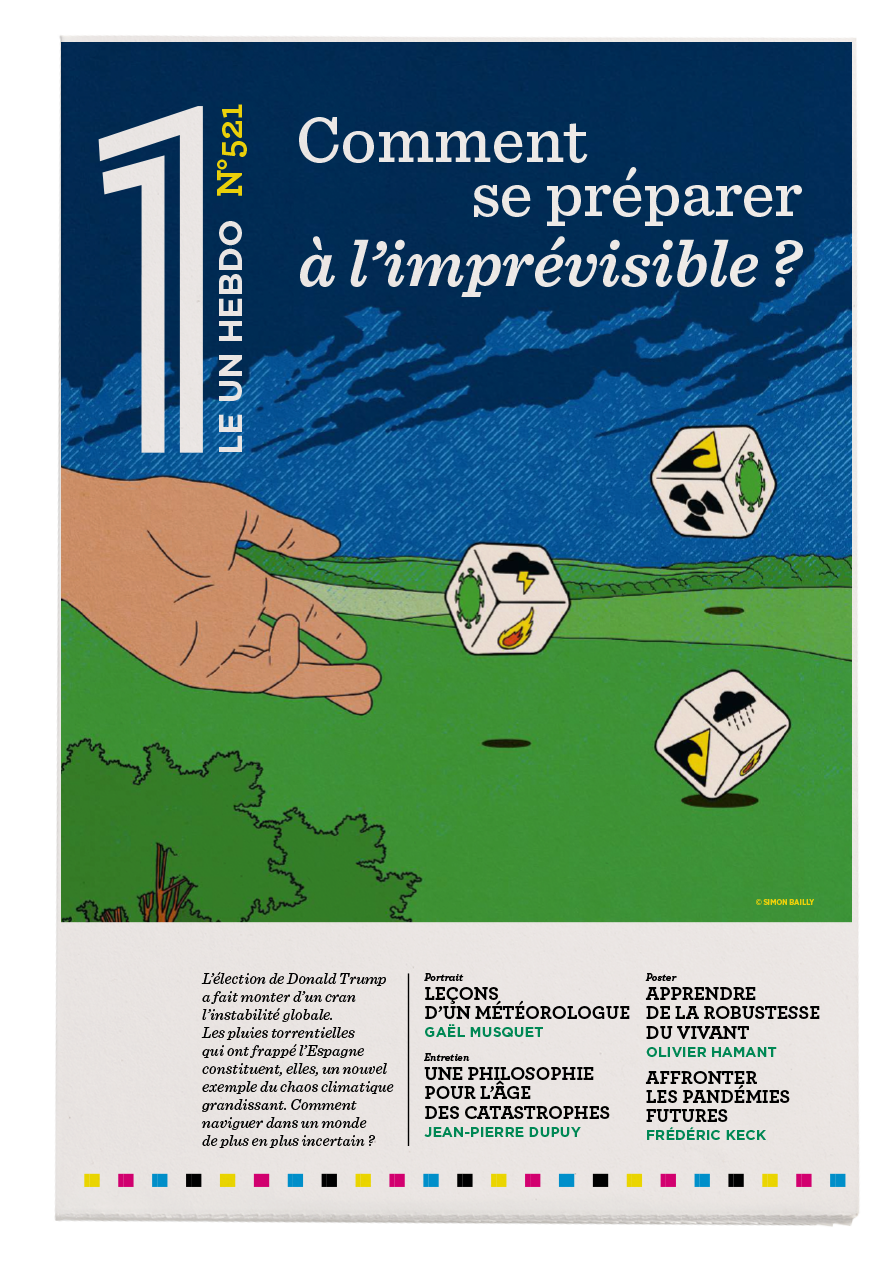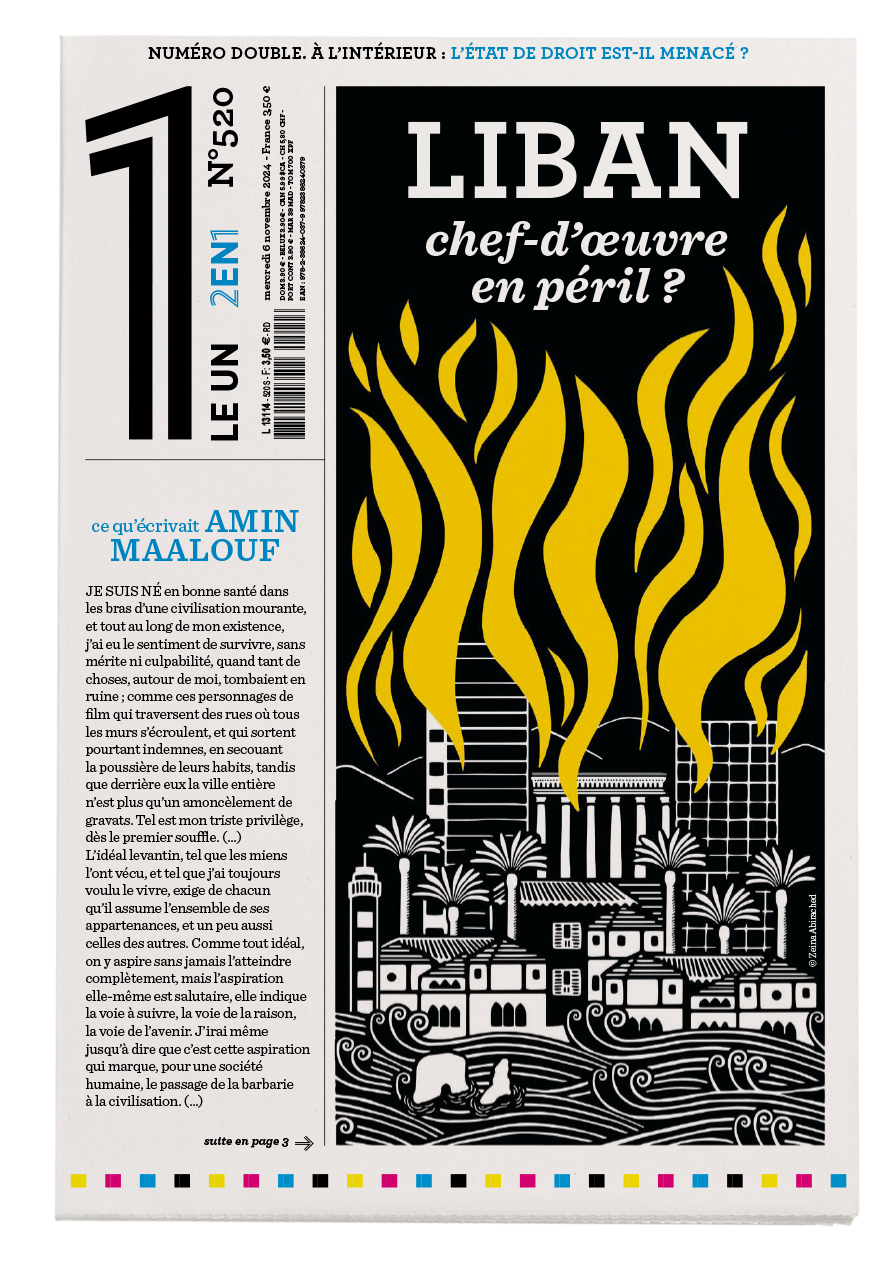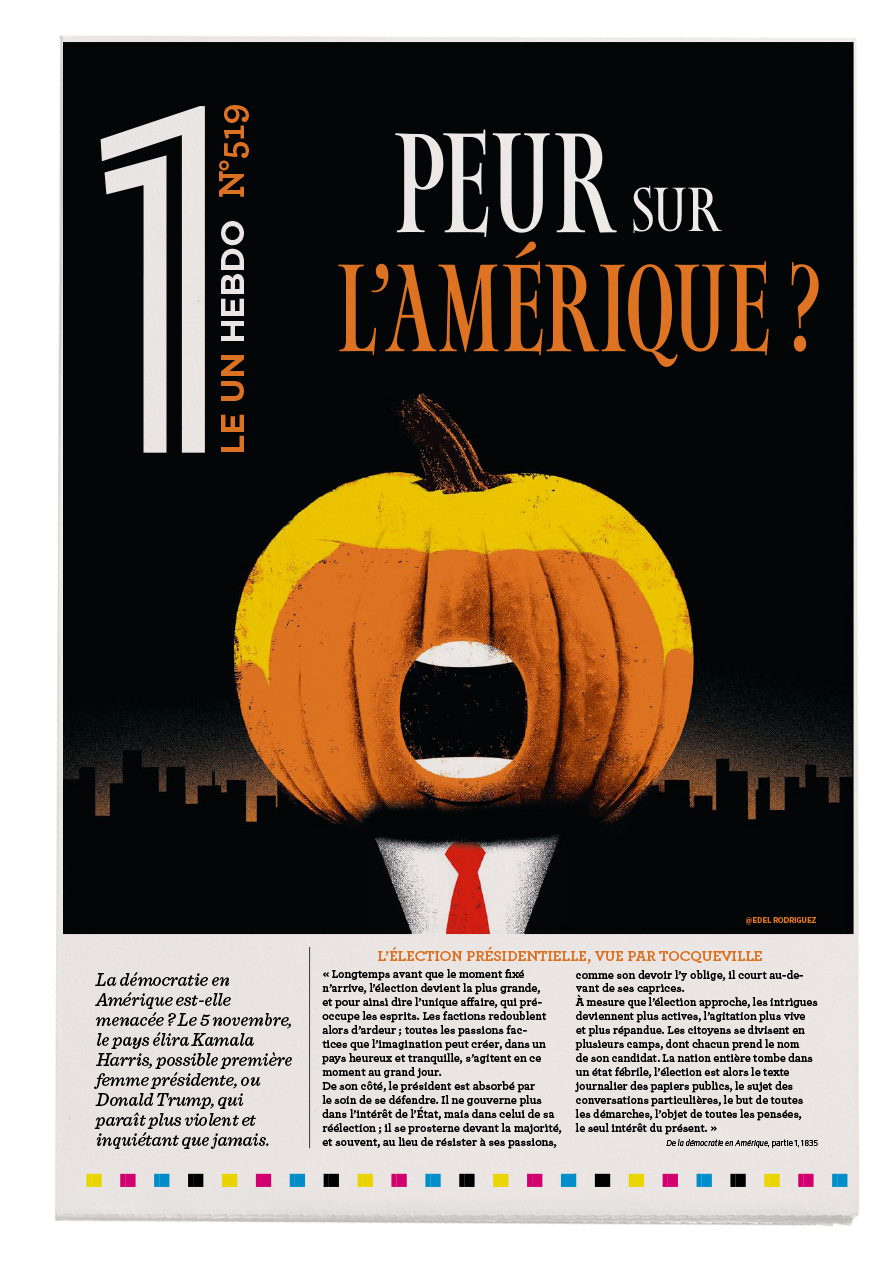« Toute réforme impopulaire génère un choc des légitimités »
Temps de lecture : 9 minutes
Comment qualifier le moment politique que nous vivons ?
Au-delà du sentiment qu’Emmanuel Macron brutalise les institutions, nous assistons à l’explosion de la déconnexion entre deux légitimités. La légitimité institutionnelle dont se prévaut le président est perçue comme une coquille vide par une majorité des citoyens. Parce que subsiste en arrière-plan l’histoire d’une souveraineté populaire qui s’inscrit dans la Déclaration des droits de l’homme de 1789, puis dans le préambule de la Constitution de 1958. La position de M. Macron est théoriquement légitime si on se réfère à son statut de président, au rôle de sa majorité, à l’usage du parlementarisme rationalisé. Mais il existe une autre forme de légitimité, plus impalpable, dont on sait qu’elle a toujours été en filigrane des décisions politiques, et pas seulement sous la Ve République, qui est la légitimité de la souveraineté populaire. La démocratie ne fonctionne que par l’assentiment du plus grand nombre. Contrairement à ce qu’affirmait M. Macron dans sa dernière intervention télévisée, il ne s’agit pas de la foule mais du peuple en tant qu’organisation fixée par le droit. Je préfère parler de citoyens régis par des règles et qui, par le biais de corps intermédiaires et de manifestations, font entendre une autre légitimité.
Ce choc brutal des légitimités est-il nouveau ?
Non, mais on est à l’apogée de cette dialectique. Ce qui compte est la manière dont le pouvoir négocie ce moment. On peut considérer que toute réforme impopulaire génère ce choc. Mais je ne vois pas d’exemple où il n’ait pas été résolu par une sorte de négociation de la part du pouvoir. Lorsque se présente la crise de Mai 1968, de Gaulle va chercher à réaffirmer sa légitimité à travers une dissolution de l’Assemblée et de nouvelles élections législatives. En avril 1969, ayant le sentiment que sa légitimité institutionnelle ne coïncide plus avec la légitimité de la souveraineté populaire, il va rechercher l’adhésion du peuple par un référendum. Et, faute de la trouver, va jusqu’à démissionner. En 1995, lors d’un précédent projet de réforme des retraites, Jacques Chirac demande au Premier ministre Alain Juppé de s’incliner face à la légitimité populaire en retirant une partie de son texte, qui concerne les régimes spéciaux, alors même que M. Juppé bénéficie d’une légitimité parlementaire inattaquable. En 2006, fort d’une légitimité institutionnelle encore incontestable, avec une loi du CPE votée et promulguée, M. Chirac décide néanmoins de ne pas l’appliquer en raison de la contestation dont elle fait l’objet.
Y a-t-il des contre-exemples ?
Oui. Quand, en 1981, François Mitterrand, à rebours de l’opinion majoritaire, enclenche le processus d’abolition de la peine de mort. Mais il n’a pas face à lui un mouvement social.
Rien à voir avec ce qui se passe maintenant. Aujourd’hui, la souveraineté populaire ne tient pas seulement aux sondages. Elle repose aussi sur la position des corps intermédiaires, des syndicats, des associations, du mouvement social en lui-même. Le point de départ de ce divorce des légitimités peut remonter au référendum de 2005, avec le refus par le peuple français de la Constitution européenne, suivi par cet acte de déni de légitimité : la ratification du traité de Lisbonne en 2007 par Nicolas Sarkozy, au détriment du choix fait par le peuple.
« Paradoxe de ce jeune président révolutionnaire qui passe à côté d’une “révolution” démocratique »
Il existe une ambiguïté dans ce choc des légitimités. On peut redouter que le choix des citoyens conduise à une gouvernance populiste par la pression de l’opinion. Mais la Constitution de la Ve est assez fluide pour qu’on réfléchisse à ses conditions d’utilisation. Elle donne un énorme pouvoir à l’exécutif. Il faut donc que ce dernier tienne compte du contrepouvoir institutionnel mais aussi social.
Quelles sont les conséquences du refus de la part du président de prendre en compte cette légitimité populaire ?
L’usage du 49.3, qui s’inscrit dans un processus démocratique légitimé par les institutions, a fait changer de nature le mouvement social. À la contestation d’une réforme tenue pour socialement injuste est venue se substituer l’indignation face à une manière d’user des règles établies qui ne correspond plus à l’usage démocratique d’aujourd’hui. Dans cette nouvelle phase de la crise des retraites – une forme de « giletjaunisation » du mouvement social, jusqu’ici encadré par les syndicats –, le président n’a pas vu ou pas compris qu’il se jouait des choses plus profondes, la déconnexion entre le pouvoir politique et les citoyens. Il dénie d’abord l’intervention des syndicats dans la crise, et leur capacité à jouer un rôle dans ce dialogue social mais aussi politique. Il dénie ensuite aux citoyens la capacité de jugement, ou de raison, qu’il réserve à la sphère institutionnelle, et en particulier au pouvoir exécutif qu’il incarne. De facto, il impose donc cette supériorité de la légitimité institutionnelle par rapport à la légitimité populaire.
Notre histoire est faite de ce rejeu permanent de l’exigence de démocratie
C’est un paradoxe total car, ayant disqualifié cette légitimité populaire en ce qui concerne les retraites, il semble la reconvoquer dans son dispositif de réforme à venir, entendant s’adresser cette fois précisément aux corps intermédiaires et à la société civile, c’est-à-dire aux citoyens, par le biais de leurs représentants extra-institutionnels ! Cela n’a été compris que comme une nouvelle phase de la déconnexion. Après que l’exécutif a conçu cette réforme des retraites en tronquant le dialogue social nécessaire, puis minoré le Parlement et usé du 49.3, nous assistons à une quatrième phase où le peuple, renvoyé à sa propre ignorance, vient valider une perception collective qui date du début du premier quinquennat d’Emmanuel Macron : celle d’une présidence qui a pris ses distances avec les citoyens.
L’exigence démocratique exprimée aujourd’hui est-elle inédite ?
Non, mais elle s’exprime différemment. Notre histoire est faite de ce rejeu permanent de l’exigence de démocratie, que ce soit au moment du Front populaire, avec l’occupation des usines pour faire pression sur les décisions du gouvernement de Léon Blum, de Mai 68 et de ses formes d’utopie démocratique, ou encore des mouvements du type Nuit debout. Mais s’y ajoute aujourd’hui une évolution culturelle forte, qui a plusieurs origines. D’abord, l’influence de modèles étrangers : des modèles institutionnels, avec les républiques parlementaires scandinaves ou anglo-saxonnes, mais aussi des modèles de mouvements sociaux, comme Podemos ou les Indignés, qui ont mis en lumière la déconnexion en France entre l’institutionnel et le populaire. Il y a ensuite un sentiment d’échec des politiques publiques depuis plusieurs décennies, exacerbé par la déception propre au projet macronien, dont on pouvait attendre il y a six ans une ouverture plus forte au niveau du volet démocratique. Enfin, il y a une remise en question générationnelle de la verticalité dans tous les pans de la société – dans la famille, dans l’entreprise, dans l’administration, et donc logiquement dans la politique. Tout cela converge vers une exigence de démocratie participative, ou de démocratie directe, qui prend une forme d’urgence aujourd’hui. Cette exigence existe dans toutes les démocraties, mais notre système semi-présidentiel, voire très présidentialisé, est peut-être encore moins à même d’y faire face que les régimes parlementaires de nos voisins.
Une évolution technologique est-elle envisageable pour répondre à la demande d’une démocratie augmentée ?
La prégnance des nouveaux outils numériques conforte en effet toute une génération dans l’idée qu’il pourrait y avoir une « veille » démocratique plus immédiate. Par exemple, de nombreux think tanks réfléchissent à la manière dont on pourrait utiliser les outils numériques pour intervenir dans la fabrication des lois, mais aussi dans leur évaluation, ou encore pour déclencher plus rapidement des référendums d’initiative partagée grâce aux réseaux sociaux. Il est clair que le numérique facilite et accélère l’intervention du citoyen dans le champ et la décision politiques. Il est nettement plus facile de faire signer une pétition aux 4,8 millions de citoyens nécessaires au déclenchement d’un référendum d’initiative partagée avec les outils d’aujourd’hui qu’avec les feuilles de papier d’il y a cinquante ans.
Paradoxe de ce jeune président révolutionnaire qui passe à côté d’une « révolution » démocratique
Quant à la réponse d’Emmanuel Macron sur ces enjeux, elle semble s’appuyer sur une vision assez archaïque de la démocratie participative. C’est assez surprenant de la part d’un jeune président qui avait compris l’utilité des Marcheurs et d’une démarche « bottom-up » [du bas vers le haut] pour construire des propositions politiques. Il semble ne pas avoir mesuré la nécessité de ces outils numériques. En cela, il est assez isolé, car ces questionnements sont très présents chez les autres acteurs politiques. Paradoxe de ce jeune président révolutionnaire qui passe à côté d’une « révolution » démocratique.
Est-ce qu’il est possible, dans le cadre de la Constitution de la Ve République, de reconnecter légitimité institutionnelle et légitimité populaire ?
Les institutions de la Ve République se sont révélées suffisamment souples et adaptables pour contribuer à cette reconnexion. À son origine, cette Ve République correspond à une pensée dialectique entre la tradition parlementaire issue de la Révolution française, liée au citoyen, et une verticalité du pouvoir très bonapartiste, selon la vision du général de Gaulle. Michel Debré, qui conçoit ces institutions, a veillé à ce que soit préservé l’équilibre d’une république parlementaire. Et ce que montrent les périodes de cohabitation, mais aussi, de manière un peu surprenante, les élections législatives de 2022, c’est que cet équilibre est possible. Tout ce qui peut aujourd’hui aider à persuader les citoyens, en particulier les jeunes générations, que leurs institutions sont en connexion avec cette souveraineté populaire, doit être utilisé.
Je suis convaincu qu’un retour à l’esprit initial des institutions, tout en conservant la centralité de la figure présidentielle et cette forme de verticalité, qui reste chère à une grande partie des Français, est possible. Un passage à une VIe République parlementaire risquerait de bousculer les choses de manière excessive. On peut tout à fait redonner plus d’espace au Premier ministre, le chef effectif du gouvernement, et replacer le président de la République sur une fonction plus proche de celle d’un président italien ou allemand. Le tout est de trouver où placer le curseur. Mais nous pouvons renouer avec l’esprit du domaine réservé, c’est-à-dire un président qui s’occuperait de l’international, des affaires étrangères, et qui, pour l’intérieur, laisserait plus de marge de manœuvre au Premier ministre. Un Premier ministre qui est, selon les termes de la Constitution, « le Chef de majorité parlementaire », c’est-à-dire qu’il tire tout de même sa légitimité des électeurs et est responsable devant eux.
Pour résumer, il n’est pas nécessaire de quitter la Ve République. Mais il faudrait réussir à redonner plus de pouvoir au Parlement, inclure les citoyens dans le processus législatif par la coproduction de lois et par le contrôle et l’évaluation des procédures, et densifier ces moments de participation et de contrôle en recourant aux référendums d’initiative partagée.
Le président de la République dit accepter d’être impopulaire. Peut-il ne rien changer au niveau de sa méthode ?
Je pense que c’est une conception rigide des vertus de l’impopularité, comme une sorte de légitimation de la pertinence de sa politique. C’est la lecture de quelqu’un qui ne comprend pas que le risque d’impopularité, pris par des nombreux présidents, de De Gaulle à Mitterrand, ne les a pas empêchés de rechercher l’assentiment populaire. En l’occurrence, c’est presque une perversion des vertus de l’impopularité.
Propos recueillis par JULIEN BISSON & ÉRIC FOTTORINO
« Toute réforme impopulaire génère un choc des légitimités »
Jean Garrigues
Pour l’historien Jean Garrigues, la crise actuelle porte à son apogée la déconnexion entre la légitimité institutionnelle et la légitimité, plus impalpable, de la souveraineté populaire.
[Caligula]
Robert Solé
Mes chers compatriotes, je vous ai compris.
(Applaudissements, cris, chants. « On â ga-gné ! On â ga-gné ! »)
Attendez. J’ai compris que vous n’aviez pas compris la nécessité de cette réforme des retraites qui est pourtant vitale…
Qui est le peuple ?
Stéphanie Roza
La philosophe et chargée de recherche au CNRS Stéphanie Roza analyse le concept de « peuple », de l'Antiquité à la Commune de Paris.