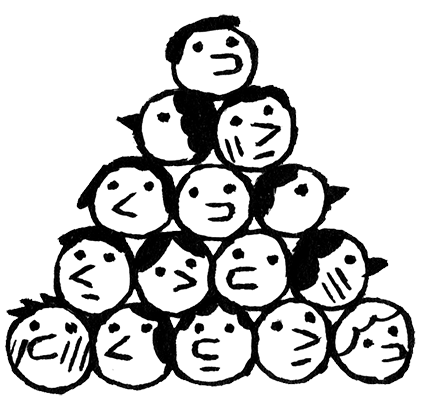« Il n’y a rien de plus contagieux que les paranoïas collectives »
Temps de lecture : 8 minutes
Comment jugez-vous le moral des Français ?
Calamiteux ! Je le constate tous les jours, c’est affolant. Mes consultations se sont transformées en un bureau des plaintes, des pleurs, de l’angoisse et de la colère. Même moi qui suis plutôt connu pour mon optimisme, je suis un peu débordé par cette situation. C’est très inquiétant.
Paradoxalement, au printemps, pour des proches mais aussi des patients, le moment avait été fécond. Nous vivions pourtant un traumatisme, quelque chose d’inattendu auquel nous n’étions pas préparés, mais la plupart avaient réussi à réinventer leur quotidien, même parmi les patients en psychiatrie à l’hôpital, souffrant de pathologies plus lourdes. Aujourd’hui, ces derniers sont atterrés, détruits à la perspective du deuxième confinement. Je fais le même constat pour mes patients au cabinet. Tout le monde est catastrophé.
Qu’est-ce qui fait la différence entre les deux confinements ?
La temporalité, je pense. La première fois, nous avions un horizon, l’été, puis une rentrée qu’on imaginait pleine d’opportunités – contre toute vraisemblance, on le constate aujourd’hui. Cette fois, nous sommes dans un tunnel, sans perspective de lumière. C’est d’autant plus angoissant qu’on va vers l’hiver, le froid, vers des fêtes de fin d’année qui n’auront peut-être pas lieu. On sent monter une angoisse et une colère dont on ne sait pas très bien contre qui elle s’exprime vraiment. Le tissu social paraît complètement effiloché, voire déchiré, on s’invective, on perd son sang-froid, jusqu’au gouvernement. Tout cela laisse la part à la désinformation, aux théories du complot pour certains…
« On sent monter une angoisse et une colère dont on ne sait pas très bien contre qui elle s’exprime vraiment »
Quel effet cumulatif les attentats terroristes ont-ils provoqué ?
La décapitation d’un professeur a tout de suite enclenché quelque chose, et d’abord une accentuation de la peur, une peur protéiforme et invisible. Le virus frappe dans des conditions encore mal connues. Quant au djihadiste, on lui retourne le cerveau en trois secondes et il peut frapper n’importe où. Et puis, la teneur du débat autour du terrorisme m’est apparue consternante. On n’arrive plus à se parler, on est soit islamo-gauchiste, soit islamophobe. On a l’impression qu’on ne peut plus tenir un discours nuancé qui prenne en compte les contradictions de ces phénomènes complexes.
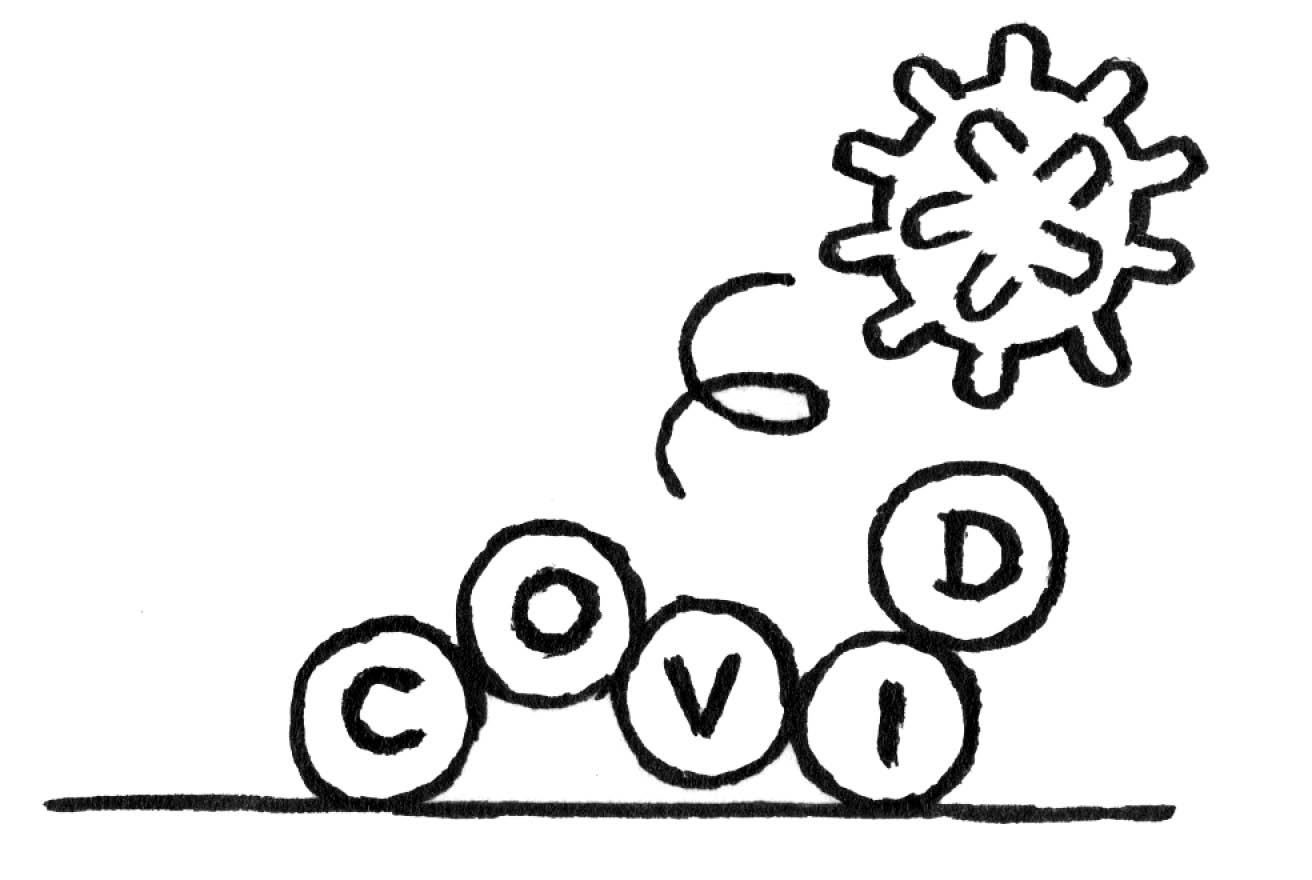
Pouvez-vous définir les contours psychiques de ce moment traumatique ?
Le traumatique est généralement un moment de sidération, mais aussi de galvanisation des défenses et des forces. Il y a ensuite le post-traumatique, souvent un moment d’épuisement parce qu’on a brûlé beaucoup d’énergie. Là, on réaménage les choses du mieux qu’on peut. Il me semblait que le post-traumatique avait plutôt bien fonctionné après le premier confinement, mais ce qui me frappe, après coup, c’est l’intensité du déni dans lequel nous avons été plongés. Nous avons traversé cette phase post-traumatique en croyant mordicus que nous étions sortis d’affaire. En réalité, le deuxième traumatisme est arrivé alors que le premier n’était pas digéré.
Quelles réactions observez-vous le plus fréquemment ?
Une majorité de personnes peuvent réagir sur un mode dépressif. Nombre de patients ont l’impression d’être paralysés, ils sont chez eux, ils arrivent vaguement à faire un peu de télétravail et sinon ils n’ont envie de rien, ils écoutent en boucle les chaînes d’information comme des zombies. D’autres sont sur le versant de la colère, ils se sentent enragés contre tout le monde, même leurs meilleurs amis : ils veulent absolument avoir raison et ne supportent pas la contradiction. L’autre devient vite un ennemi au lieu d’être un partenaire. La paranoïa n’est pas loin !
Avez-vous le souvenir de telles crises psychiques collectives ?
Non. Peut-être que si on remontait à la crise de 1929, on enregistrerait un même sentiment d’angoisse collective. Il faut prendre garde à ce qu’elle ne dégénère pas en paranoïa collective, il n’y a rien de plus contagieux. C’est un mécanisme sur lequel je me suis penché à l’occasion de voyages d’études au Rwanda. Six mois de terreur instillée par la radio des Mille Collines ont contribué à faire basculer la moitié d’un pays dans le meurtre… La paranoïa collective, c’est désigner un ennemi, un responsable, un bouc émissaire extérieur ; cela n’a rien à voir avec les structures de personnalité de chacun – il n’y avait pas un million de paranoïaques au Rwanda. Nous n’en sommes évidemment pas là, mais on voit comment l’accentuation de la peur tend à faire émerger des théories du complot, à désigner des coupables et à les stigmatiser.
Au-delà des soins individuels, quelles solutions collectives imaginez-vous ?
Puisque la marque de cette crise, c’est une forme de déliaison, il faut réfléchir aux valeurs autour desquelles nous devons tenter de restaurer du lien social. Dans un pays farouchement divisé sur les réponses collectives, il me semble que seul un idéalisme républicain peut remplir cette fonction. Cette crise nous a renseignés sur le caractère essentiel de la fonction soignante et de la fonction enseignante. La fonction soignante, au sens large, ce sont tous ces dispositifs du care, ce « soin de l’autre » que Martine Aubry avait voulu promouvoir en 2010. On l’avait accusée de défendre « une société de mémère », on voit aujourd’hui à quel point elle avait raison.
Quant à la fonction enseignante, on vérifie – par l’absurde, avec l’assassinat de Samuel Paty – la place centrale qu’elle tient dans la diffusion des valeurs de la République. Il me semble qu’il faut affirmer clairement que l’on va consentir un effort considérable pour restaurer ces fonctions, ce qui passe par la revalorisation des traitements des enseignants comme de ceux des soignants, mais aussi par la refondation de ces institutions.
Quel miroir la pandémie nous renvoie-t-elle ?
La France se sent très vite attaquée dans sa grandeur passée. Ce sentiment de puissance perdue a été revivifié par la comparaison de notre gestion du Covid avec celle de nos voisins. Cette nostalgie s’exprime sur d’autres sujets, comme la difficulté à débattre de notre passé colonial. Les nouvelles visions des diverses discriminations des minorités, l’intersectionnalité, me paraissent être des grilles de lecture éminemment respectables. Il ne s’agit pas d’entrer dans la culpabilité, mais il y a quelque chose à analyser. La puissance des oppositions révèle que l’on touche là un point crucial, comme si ces examens historiques giflaient l’homme blanc hétérosexuel, au risque qu’il devienne une pauvre poupée de chiffon, on en est tout de même très loin ! Nous avons certes tété le lait d’une France brillante, universelle et laïque, nous devrions tout de même réussir à discuter aujourd’hui des questions du multiculturalisme, de l’intégration sans nous déchirer.
Ce virus percute-t-il notre toute-puissance narcissique ?
Quand on parle du narcissisme contemporain, on parle d’un individu qui ne serait plus relié qu’à lui-même, totalement désarrimé de l’ensemble des appartenances, des prescriptions et de la loi. Narcisse, c’est le créateur de lui-même, celui qui est toujours en relation avec son image, son désir et son plaisir. Cela décrit en partie l’individu d’aujourd’hui placé en miroir face à son écran mais, aussi séduisante soit-elle, cette image ne permet pas, à mon sens, d’analyser complètement nos sociétés.

Pourquoi ?
Il est vrai que notre autonomie est plus grande que dans les sociétés traditionnelles, mais il ne faut jamais oublier que c’est une liberté toute relative. Nous continuons à être, malgré tout, des individus nourris par le lien aux autres, des liens auxquels nous participons mais dont nous ne sommes pas les créateurs, des liens par lesquels nous avons à renoncer à notre indépendance absolue. Nous naissons dans un monde d’interlocutions, nous sommes dépendants de l’ensemble de ces liens que nous avons peut-être un peu trop oubliés dans les moments où tout allait bien, où nous étions tentés de nous tourner vers notre bon plaisir. Cette crise nous fait à nouveau comprendre l’importance du collectif. La philosophie du care est essentielle : se soucier de l’autre, c’est la seule façon de vraiment se soucier de soi-même.
Notre société est-elle ébranlée par le retour de la mort ?
Sur le plan psychique, le seul réel irreprésentable, c’est effectivement celui de la mort. Ce retour nous replace dans notre petite stature d’être humain, et non pas de surhomme qui s’auto-engendre. Un être humain, c’est un être incomplet qui ne peut rentrer dans le monde qu’à travers l’autre, c’est ce nourrisson qui a un besoin vital de se raccrocher à des figures qui vont le porter. Ce retour de la mort fait resurgir l’importance des rituels, de l’accompagnement, l’importance d’être avec l’autre, pas seulement à travers un écran. La fin de vie de ma mère en mars dernier a représenté pour moi un vrai moment de bifurcation. Si je n’avais pu passer ces dernières heures à ses côtés, je crois que je ne m’en serais pas remis. Il s’agit de lien corporel : ce n’est pas une représentation de l’affect, c’est l’affect brut qui se vit dans le corps.
Pensez-vous que votre père, s’il vivait encore, pourrait toujours prononcer sa phrase préférée : « Ça pourrait être pire » ?
C’est à travers cette phrase que mon pauvre papa m’a appris l’optimisme et, oui, je crois qu’il pourrait continuer à la prononcer. Et moi aussi, je pense que ça pourrait être pire, très largement. Imaginons que l’on ait eu 16 ans au moment de la guerre de 14-18 ; 20 ans au moment de la grande crise économique ; 25 ans au moment de la guerre civile espagnole ; 35 ans pendant la Seconde Guerre mondiale… Et si par hasard on avait été juif ! Je pense que ces époques représentent une autre dimension du malheur collectif.
Devons-nous nous résoudre à affronter notre « malheur ordinaire », pour reprendre le mot de Freud ?
Notre malheur ordinaire consistera peut-être à nous adapter au stop and go et à créer malgré tout une vie bonne. Toutes les générations qui nous ont précédés ont dû affronter toutes sortes d’horreurs, l’humanité a toujours connu des épidémies. Nous sortons peut-être, dans nos pays occidentaux, d’une parenthèse de quelques dizaines d’années et cette pandémie marque le retour du tragique dans nos existences. C’est peut-être ce qu’on a tant reproché à l’enseignement de Freud, cette conscience que l’être humain est voué à la mort, à la souffrance, à la perte des liens, au désamour. Mais il a aussi la capacité de vivre et d’aimer malgré cette dimension tragique.
Propos recueillis par PATRICE TRAPIER
« Il n’y a rien de plus contagieux que les paranoïas collectives »
Serge Hefez
Le psychiatre et psychanalyste Serge Hefez, qui juge calamiteux le moral des Français, estime urgent de réfléchir aux valeurs autour desquelles nous voulons restaurer du lien social, et vante les mérites du care, cette philosophie du souci collectif de l’autre.
[Cas contact]
Robert Solé
POURQUOI interdit-on ceci et pas cela ? Est-il vrai qu’un postillon infecté reste en suspension dans l’air ? Quand ce cauchemar cessera-t-il ? Et, en plus, des égorgeurs courent les rues au nom du Prophète… Le deuxième confinement est marqué …
Une France sur les nerfs
Oriane Raffin
« Depuis le début du reconfinement, les appels mentionnant le Covi…