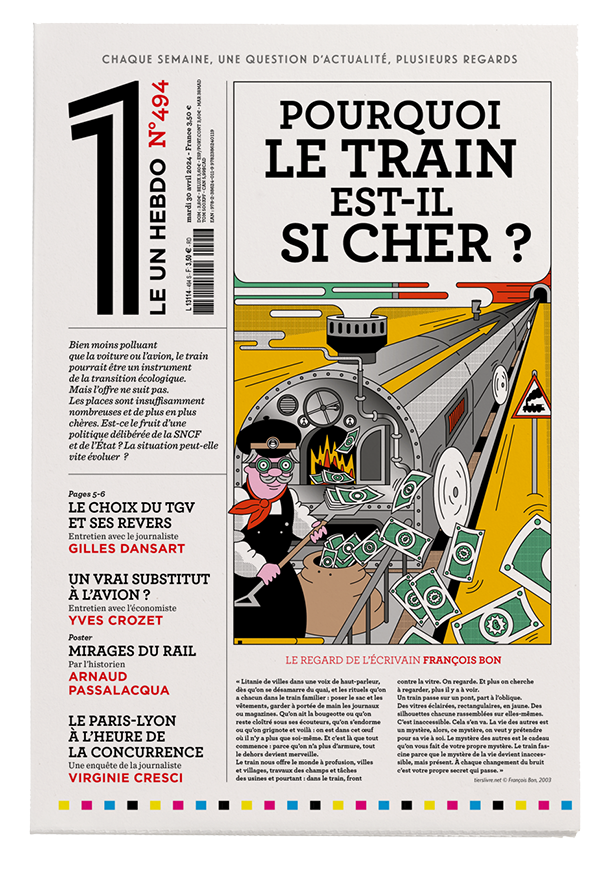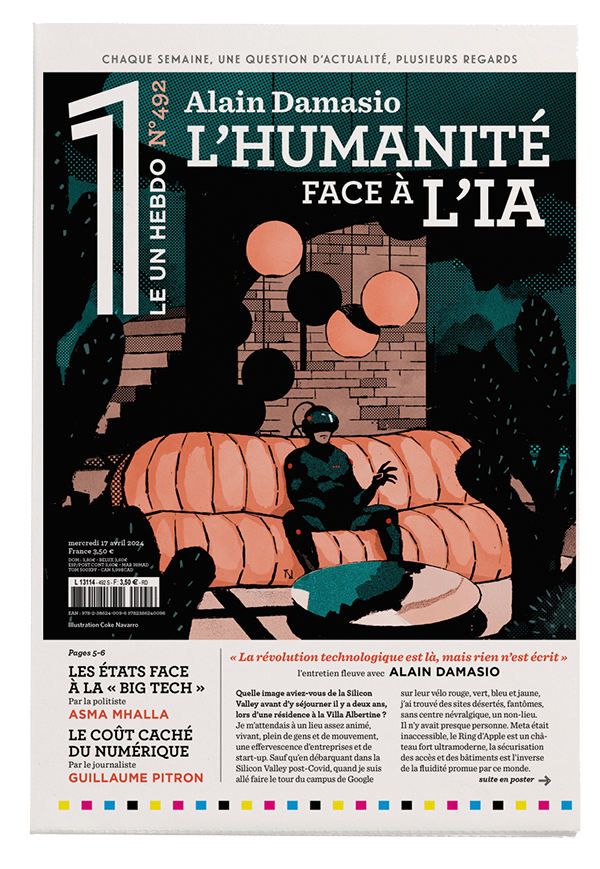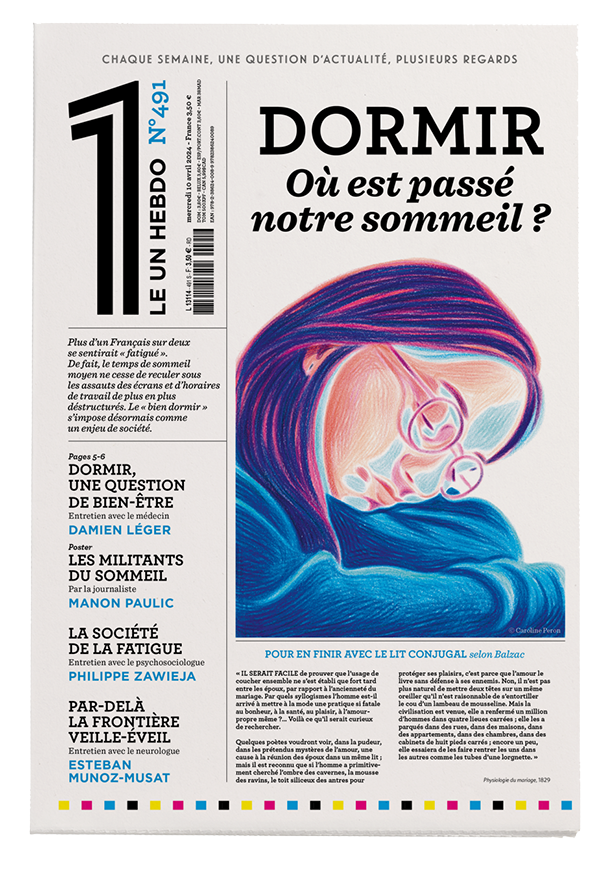Rire avec le diable
Temps de lecture : 12 minutes
Au début des années 1990, Augusto Pinochet dispose encore, au Chili, d’un pouvoir important : défait par le plébiscite de 1988, il a quitté la présidence en 1989, mais reste commandant en chef de l’armée de terre, dans un pays où celle-ci détient encore de significatives prérogatives constitutionnelles. Les relations avec le président démocratiquement élu Patricio Aylwin oscillent entre négociations, tensions et, au moins à deux reprises, gesticulations militaires. Avare de sa parole, le général décide de limiter drastiquement ses échanges et de ne plus parler à la presse. Avec quelques exceptions – deux ou trois journalistes étrangers. Bruno Patino est alors correspondant du Monde à Santiago du Chili. Le 8 décembre 1992, l’entretien en face-à-face a finalement lieu, après plusieurs mois d’attente, au siège de l’armée de terre à Santiago. Plus de trente ans après, Bruno Patino revient sur sa rencontre avec Augusto Pinochet.
Adolescents, nous fûmes un certain nombre à orner les murs de nos chambres avec deux photos qui résumaient à elles seules l’idée que nous nous faisions du continent de tous les combats, de cette Amérique latine dont Régis Debray écrivait qu’elle était l’écran vierge sur lequel nous projetions tous nos imaginaires. Côté lumière, il y avait le cliché de Che Guevara à la tribune d’une cérémonie d’hommage le 5 mars 1960, pris de loin, presque par hasard, par le photographe Korda (Alberto Diaz), qui mettrait des années avant d’en proposer une diffusion qui finirait par lui échapper. Le béret à l’étoile, le vent dans les cheveux appelaient à l’aventure. Le regard, comme perdu vers l’horizon, semblait promettre l’âge d’or. Côté sombre, rien n’égalait la photo en noir et blanc prise quelques jours après le coup d’État (le 19 septembre 1973) par le photographe de l’agence Gamma Chas Gerretsen, à la sortie d’une messe qui venait de célébrer dans la maison de Dieu « la gloire de l’armée chilienne ». Le général et ses officiers avaient pris la pose. Eux debout, lui assis, la casquette posée sur les genoux, le rictus mauvais, la moustache tombante, parallèle à la bouche au sourire inversé, les cheveux bruns plaqués, les bras croisés, la mâchoire serrée, le menton en avant. Les lunettes noires masquaient le regard : elles deviendraient le symbole des heures sombres de la dictature. Gerretsen racontait que le militaire avait refusé de les enlever pour la photo, avec comme seul argument celui de son identité : « Je ne les enlève pas. Je suis Pinochet ! » D’une certaine façon, bien lui en avait pris : son visage allait ainsi devenir la représentation presque universelle du dictateur. Le mal politique incarné.
Il se tenait là, vêtu d’un uniforme blanc aux galons d’or, sans lunettes, le sourire discret, quoique dépourvu de toute forme de bienveillance
L’homme qui se tenait devant moi n’avait plus grand-chose de commun avec cette icône. Le passage des ans avait joué son rôle, qui blanchit les cheveux, la moustache, tasse les épaules et alourdit – modérément – la silhouette. Mais il y avait autre chose. Il avait fait sienne l’apparence que ses conseillers en communication lui avaient forgée pendant la campagne perdue du référendum de 1988 : celle du bon vieillard protecteur de la nation, que les affiches électorales en faveur du « oui » à la prolongation de son mandat montraient, tout sourire, en compagnie d’un jeune enfant qui le regardait comme on regarde un grand-père naturellement indulgent, souvent trop généreux, et dont les rappels à l’ordre ne sont que de pure forme. Ça avait failli marcher. Mais la ficelle était trop grosse, et il est permis de croire que les 44 % de Chiliens qui avaient voté en faveur du général connaissaient le prix de l’ordre maintenu, et n’avaient à aucun moment pensé que cela avait un quelconque rapport avec le comportement d’un grand-père gâteau. La défaite n’avait pas modifié la stratégie vestimentaire : il se tenait là, vêtu d’un uniforme blanc aux galons d’or, sans lunettes, le sourire discret, quoique dépourvu de toute forme de bienveillance, le dos légèrement voûté, les bras ouverts en signe de bienvenue. Il faisait son âge.
« Por aquí, don Bruno. » (« Par ici, Monsieur Bruno. ») Alors qu’il m’invitait à entrer dans une salle immense, meublée d’une seule table rectangulaire pouvant accueillir un état-major au complet, le ton était donné : une amabilité de circonstance, une marque de déférence ampoulée et grotesquement hors de propos destinée à ridiculiser l’interlocuteur, ou bien à commencer de s’amuser avec lui comme le fait un chat avec la souris qu’il a réussi à amener à portée de griffes. Il m’invita à le précéder dans la salle, que nous traversâmes en longeant la table, immense. Il me fit asseoir à l’extrémité la plus éloignée de la porte d’entrée. Et se posa à l’angle, à mes côtés, tourna la tête, me fixa et posa sa main gauche sur mon épaule. « Nous pouvons commencer. »
Le diable, je ne l’aurais jamais cru, avait de beaux yeux
La voix du diable me surprit plus encore que le mouvement de sa main. Notre imaginaire associe souvent l’exercice du pouvoir absolu à la détention d’une voix puissante, tonitruante, aux accents toniques soulignés, se prêtant à des envolées et des descentes en forme de montagnes russes. Nous croyons souvent qu’une tessiture étendue, un coffre ample, une résistance vocale à toute épreuve constituent les attributs nécessaires à la domination. Les images de la cinéaste nazie Leni Rifenstahl ont laissé en nous leurs rémanences rétiniennes et auditives. L’histoire, pourtant, dément le stéréotype, notamment dans la langue espagnole : les voix de Rafael Trujillo à Saint-Domingue, de Francisco Franco en Espagne, d’Alfredo Stroessner au Paraguay ne se caractérisaient ni par leur volume ni par leur capacité à faire jouer les basses. Il en était de même pour celle d’Augusto Pinochet. Aiguë, flûtée, dotée d’un chuintement assez perceptible qui soulignait l’accent chilien d’extraction populaire, elle pouvait terminer une phrase par un simple chuchotement. Le ton, vif, aiguisé et tranchant, traduisait cependant l’absence de faiblesse. Il en était de même pour le bleu céruléen des yeux : froid et intense. Le diable, je ne l’aurais jamais cru, avait de beaux yeux. Mais l’éclat malicieux forçait à la vigilance : le sourire laissait entrevoir une habileté de bonimenteur sans foi ni loi. Le poids de l’histoire était impressionnant, et le regard soulignait la roublardise de ce natif de la ville portuaire et populaire de Valparaíso, qui avait essayé de faire oublier une carrière militaire sans éclat par des écrits de polémologie – discipline qu’il enseignait à l’école de guerre. Son appartenance à la franc-maçonnerie et son obéissance servile à plus puissant que lui avaient nourri la confiance qu’il avait gagnée auprès d’un autre franc-maçon, originaire quant à lui de la ville voisine et bourgeoise de Viña del Mar, Salvador Allende.
Pinochet parlait du 11 septembre comme d’un bon tour joué au président suicidé
Promu à la tête de l’armée le 23 août 1973, Augusto Pinochet avait juré une fidélité indéfectible au président socialiste élu et lui avait proposé d’élaborer un plan de défense de la capitale alors que les rumeurs de sédition parcouraient le pays. Le jour venu, le 11 septembre, comme il me le raconterait, il lui avait suffi d’« inverser le sens du dispositif », qui de défensif était devenu offensif. Il en parlait comme d’un bon tour joué au président suicidé. Car le 11 septembre avait été une guerre éclair. En position dès 6 heures du matin, les troupes avaient marché sur Santiago. Dans son palais de la Moneda, à 7 h 30, Salvador Allende avait d’abord refusé de croire à la réalité du coup d’État, et à 8 heures du matin, alors que le mouvement ne faisait plus de doute, certain de la loyauté de son commandant en chef de l’armée de terre, il avait exprimé publiquement son inquiétude : « Pauvre Pinochet, ils doivent l’avoir arrêté… »
Le général riait sans discontinuer de son autre entourloupe. L’oligarchie chilienne, qui l’avait toujours méprisé, le traitant derrière son dos de huaso, de « péquenaud », avait pensé que les militaires agiraient « comme des femmes de ménage », « nettoyant le pays du socialisme », avant de rentrer tranquillement dans leurs casernes pour laisser la place à ceux qui, toujours, avaient gouverné le pays.
Mais voilà, moins d’un an après le coup d’État, Augusto Pinochet Ugarte aurait écarté les opposants militaires, dont le général Gustavo Leigh ; il se proclamerait le 6 août 1974 président de la République chilienne et fonderait son pouvoir sur le contrôle de la Dina, la police politique dont l’emblème, un poing d’acier serré, annonçait son programme : la terreur totale. Ceux qui l’avaient sous-estimé devraient se rendre à l’évidence : le temps du pouvoir absolu avait commencé. Il durerait dix-sept années.
« La guerre, jeune homme, la guerre, vous ne savez pas ce que c’est, la guerre »
Il ne fallait pas lui parler de coup d’État, de renversement d’un pouvoir démocratique financé et orchestré par une puissance étrangère avec la complicité de l’oligarchie locale. Les stades transformés en camps de prisonniers, les centres de torture, les corps attachés à des rails projetés dans la mer depuis un hélicoptère, les fosses communes que l’on avait retrouvées dans le désert ou en pleine montagne, les exils à l’étranger, les relégations intérieures, tout ceci se résumait en un seul mot que son interlocuteur, mû par un idéalisme dû à sa jeunesse et à son inexpérience, ne pouvait pas comprendre : « La guerre, jeune homme, la guerre, vous ne savez pas ce que c’est, la guerre. » On objectait à sa rhétorique militaire la longue litanie des faits, les images, les preuves apportées, rien n’y faisait. 1973 était, il n’en démordait pas, l’histoire d’une bataille intérieure. Et il n’y avait pas eu massacre des opposants, mais défaite militaire d’une opposition armée travaillant en sous-main pour Cuba et l’Union soviétique, et des ennemis tombés au combat. « La guerre, c’est évidemment violent, qu’est-ce que vous croyez ? » Le reste n’avait jamais existé, n’existait pas, et n’existerait jamais.
« 2 300 personnes, franchement, ce n’est pas grand-chose… Les Chinois en tuent des millions »
On lui demanda naïvement de confirmer qu’il n’avait ni remords ni regret, ce qu’il s’empressa de faire. Toutefois, devant mon insistance et voulant sans doute se montrer grand prince, il prit un air songeur et concéda, à défaut d’actes regrettables, quelques propos déplacés. Quelques années auparavant, il avait souri quand, lors de travaux dans le cimetière de Santiago, on avait découvert que certaines tombes comprenaient plusieurs corps. Des torturés à mort avaient été glissés dans des tombes occupées, ni vu ni connu. Le général avait feint l’ignorance, puis cédé à la provocation : « Je ne sais pas qui a fait cela, mais les responsables doivent être félicités pour leur sens de l’économie, cela fait autant de tombes à ne pas creuser. » Et là, aujourd’hui, devant moi, à vraiment y réfléchir, il voulait bien admettre une maladresse : « Oui, c’est vrai, j’ai dit cela, qu’on avait fait des économies de tombes. C’était une plaisanterie, mais vous allez me dire que c’est faux peut-être ? D’accord, ce n’était peut-être pas drôle pour tout le monde. Et puis, de quoi parle-t-on ? Vous me dites 2 300 personnes. Mais 2 300 personnes, franchement, ce n’est pas grand-chose… Les Chinois en tuent des millions, et on ne leur dit jamais rien, à eux. Alors, 2 300 personnes… »
Ma respiration s’arrêta. Je n’osais plus le regarder. Je vérifiai le fonctionnement de mon enregistreur, notai les propos. J’attendais qu’il revienne sur son aveu par une phrase qui aurait signifié que je n’avais pas entendu ce qu’il n’avait pas voulu dire. Mais rien ne vint.
Le temps passait, la conversation était comme abandonnée à elle-même, désordonnée et sans enjeu. Je ne pensais qu’à l’aveu, Pinochet semblait se laisser entraîner dans une sorte de bavardage. Détendu, il plaisantait sur la presse, les journalistes, les Français, et mon indifférence à ses éclats de rire étouffés n’altérait en rien sa bonne humeur. La faim se rappela à lui, il proposa de déjeuner, en vantant la qualité de la cuisine militaire. Il savait que je déjeunais avec mes contacts militaires à l’hôtel Carrera, situé à quelques pâtés de maisons du palais présidentiel. La cuisine était réputée pour être épouvantable. C’était bien meilleur ici, souligna-t-il. « Au Carrera, quand c’est mauvais, on renvoie le cuisinier ; ici, nous les militaires, on a d’autres moyens de motiver le cuisinier. Vous voyez ce que je veux dire. » Il partit d’un franc éclat de rire.
Et je me surpris aussi à rire de bon cœur. Ce ne fut pas long, un simple éclat, avant que le surmoi ne soit de nouveau à l’œuvre, et que je me fige dans une expression neutre qui ne pouvait masquer ni ma culpabilité ni sa victoire. Et je ne fus plus capable d’oublier ce simple fait : j’avais ri avec le diable. Les minutes, ensuite, passèrent, avec cette idée parasite. La cassette du dictaphone porte témoignage que les sujets qui devaient être abordés le furent. Et que le militaire ne pratiqua pas l’esquive dans ses réponses.
Le principal journal du pays lui restait dévoué et faisait l’éloge quotidien de son legs
Je ne revis jamais le général. Plus de cinq ans après notre entrevue, alors que j’étais revenu en France, je fus contacté par un réalisateur espagnol, José-Maria Berzosa. Il avait produit en 1977 Chili Impressions, un documentaire dévastateur sur le dictateur et ses proches. Peu de commentaires, la parole laissée libre au militaire, mais un montage implacable qui traduisait le règne par la terreur et révélait le satrape. Le projet de Berzosa était simple : faire regarder le film au général, capter ses expressions et ses commentaires. Après tout, la victoire du militaire était à ce moment complète. Atteint par la limite d’âge au sein de l’armée, il venait de faire son entrée au Sénat, comme sénateur à vie, et pourrait ainsi agir pour éviter toute réforme constitutionnelle. Le principal journal du pays lui restait dévoué et faisait l’éloge quotidien de son legs. L’armée lui était fidèle et les politiques de droite soucieux de prendre leurs distances avec le « régime militaire », comme ils l’appelaient encore, devaient, pour les plus charismatiques d’entre eux, affronter des polémiques qui ressemblaient à des opérations organisées par les services secrets de sécurité. Plus de 40 % des Chiliens exprimaient encore leur soutien à sa personne, et une des principales avenues de Santiago portait toujours le nom de 11-Septembre, date du coup d’État, comme s’il s’agissait d’une bataille remportée. La réponse des militaires se fit attendre, mais me parvint sous la forme d’une promesse. Le général était disposé à nous recevoir, sous réserve que la projection puisse avoir lieu dans sa résidence secondaire. Nous pouvions déjà commencer à proposer quelques dates, mais pas dans les semaines à venir. Il devait en effet subir une petite opération chirurgicale qui lui imposait un déplacement à Londres. À son retour de la capitale britannique, nous serions les bienvenus.
On sait ce qu’il advint. Le 16 octobre 1998, Augusto Pinochet fut arrêté à la demande des juges espagnols Baltasar Garzón et Manuel García Castellón. Il avait voulu soigner son entrée dans l’histoire mais devenait l’objet d’événements qu’il ne contrôlait plus guère. L’addition lui était présentée, de son vivant. Il avait déclaré qu’aucune feuille ne bougeait au Chili sans qu’il le sache, et désormais toute une forêt se mettait à pousser. Viendrait, d’abord, la démonstration d’allégeance de la part des forces armées et du pouvoir civil, le président Frei en tête, qui obtiendrait son extradition au pays. Puis la provocation, quand le vieux général se lèverait de son fauteuil roulant sur le tarmac de l’aéroport comme pour affirmer, au milieu des personnes venues l’accueillir, sa foi en sa résurrection politique. Mais, peu à peu, leur succéderaient le temps de la conquête de l’indépendance, les poursuites du juge chilien Juan Guzmán, les levées d’immunité de la Cour d’appel en 2000, et le pitoyable refuge du militaire dans une prétendue démence qui lui permettrait d’échapper à la justice et d’attendre la mort, qui le rattrapa en 2006, loin des honneurs.
Il avait fini de rire.
« Au Chili, il semble que la Révolution est toujours triste »
Patricio Guzmán
Dans ses documentaires, le réalisateur chilien Patricio Guzman n’a cessé, depuis les années 1970, d’explorer l’actualité et l’histoire récente de son pays. Il nous explique comment celui-ci conserve certains stigmates des années sombres de la dictature, dans son organisation économique et policiè…
[Pinocchio]
Robert Solé
À peine nommé commandant en chef de l’armée chilienne en 1973, Augusto Pinochet renversait le président Allende et s’emparait du pouvoir. Ce général aux dents longues complotait, paraît-il, depuis plusieurs semaines sous le nom de code de… Pinocchio.
Pablo Neruda trouvera-t-il la paix ?
Manon Paulic
Une grande enquête de la journaliste Manon Paulic sur les zones d’ombre qui entoure la mort suspecte du poète et ancien sénateur communiste chilien, mais aussi sa postérité. Figure adulée dans son pays natal, le Prix Nobel de littérature 1971 fait depuis 2018 l’objet d’une vive contestation, impu…