Des noces contre-nature
Temps de lecture : 6 minutes
Enfant, je rêvais devant les continents colorés des mappemondes, avec leurs allures de gros berlingots. On en dénombrait alors cinq. Les doigts d’une main et les anneaux olympiques suffisaient à les énumérer. Les glaces de l’Antarctique comptaient pour du beurre, que l’humanité insouciante se moquait bien de voir fondre. Il n’existait pas plus de sixième que de septième continent, celui que forment à présent nos déchets de plastique rassemblés par les grands courants marins avant d’être broyés menu par l’action conjuguée du soleil, du sel et de l’eau. Une expression me faisait rêver : la dérive des continents. L’idée que l’humanité ait pu un jour lointain flotter sur un même radeau terrestre, avant que des failles doucement ne détachent l’Amérique et l’Afrique de notre vieille Europe. L’imagination prenait le dessus. Je voyais d’immenses plaques s’éloigner insensiblement, le sol tremblant dans un temps géologique inconcevable à l’échelle humaine.
Peut-être la catastrophe en cours est-elle de cet ordre-là. Un phénomène qui nous dépasse au point de nous rendre impuissants à le résoudre, nous qui sommes si forts à le créer dans une impavide insouciance. Sans le savoir – sans le vouloir ? –, nous n’en finissons pas d’envoyer des bouteilles à la mer. Des bouteilles en plastique que l’on croit vides, mais remplies d’un message mortel. Des sachets de courses, des godasses, des flacons d’ambre solaire pour huiler les océans, des casques de chantier paraît-il, des débris, déchets et détritus flottants qui alimentent ce fameux septième continent.
L’expression fait aussi fantasmer les écrivains. Dans son roman à paraître à la rentrée, Le Règne du vivant (Actes Sud), Alice Ferney donne la parole à un caméraman sous-marin digne de la Calypso de feu le commandant Cousteau. Elle prête à son héros, Gerald Asmussen, ces propos apocalyptiques : « J’ai cherché les grands poissons, les mérous géants, les espadons, les requins monstrueux. Ils avaient disparu. J’ai regardé la mer intouchée et la mer épuisée. Au cœur du Pacifique, dans le nœud de ses courants vers le nord, j’ai filmé la grande décharge du monde : sur trente mètres de profondeur un continent de plastique, sacs, bidons, bouteilles, de toutes les marques, dans toutes les langues et de toutes les couleurs. Jusque dans ces espaces inatteignables, le globe terrestre devenait l’égout des hommes. » Daniel Pennac, dans Le Sixième Continent (la comptabilité est parfois aléatoire) se présente comme le librettiste d’un « opéra-bouffe de nos gadoues ». Cette pièce pleine d’improvisation raconte l’histoire d’une famille qui, en trois générations, se rendra coupable de la plus grande pollution des océans. Un personnage sans vergogne rêve même de changer cette étendue plastifiée en un îlot touristique.
La réalité est moins frappante, c’est pourquoi elle est plus dangereuse car insidieuse et sournoise. Dans ces eaux lointaines où le plastique supplante le plancton, rien ne ressemble plus à un bout d’algue qu’un déchet de plastoc colonisé par des micro-organismes végétaux trompant la vigilance des poissons. L’enrobage cache le poison. Qu’on le dise, qu’on l’écrive, qu’on le crie aussi : le plus grand tueur des mers n’est pas le requin mais le plastique. C’est un récidiviste que rien n’arrête. Nous en mourons, lui ne meurt jamais. Alice Ferney touche juste quand elle écrit : « L’homme est une sale bête autant qu’une bête sale ». Et le droit ? Mais quel droit ? Tout le monde se lave les mains dans la soupe de plastique. C’est si loin. Ni vu ni connu. Impossible de passer les menottes à l’humanité entière, pas même à ces monstrueux cargos déféquant à l’insu du monde au milieu des eaux les plus pures qu’ils transforment en dépotoirs à mer ouverte. Pas de gouvernement mondial, pas de gendarmes des océans pour lutter contre le cynisme, la bêtise et l’inconscience. Le geste qui sauve relève de chacun, dans un temps où la force de l’inertie et de l’ignorance souffle à plein. Pouvoir, c’est d’abord savoir. Puis vouloir.
Je me souviens d’une marche d’automne sur une longue plage déserte de l’Atlantique. À côté d’un cadavre d’oiseau, une poignée de coquillages semblaient respirer à l’air libre, toutes coques ouvertes. Leur pointe était fichée dans une méduse. Pas le mollusque globuleux aux allures de grosse soucoupe dont sont parsemées nos côtes. Une méduse en plastique, ces sandales souples qui protègent des coupures contre les cailloux et les rochers submergés. J’ai d’abord observé ce spectacle avec fascination. En réalité, je n’ai pas compris aussitôt ce que je voyais. Ces noces contre-nature entre une semelle de plastique et ces coquillages qui la tétaient comme une mère avaient quelque chose de beau, d’étrange, d’attirant. L’ensemble était magnifié par la lumière douce de novembre que projetait un petit soleil enroué. J’ai emporté dans ma voiture cette drôle d’installation qui me semblait relever d’un art nouveau, une collaboration de hasard entre l’homme et la faune marine. Mais à la nuit tombée, retournant voir mon butin déposé sur une porte-fenêtre, j’ai soudain éprouvé un malaise. Les coquillages se tordaient sur leur socle de plastique. La belle lumière de la mer avait disparu. Ne restaient plus que cette semelle rigide et les taches noires par-dessus, maculées de bulles, dansant une douloureuse chorégraphie pénible à regarder. Le lendemain matin, je me suis approché avec une sourde appréhension. Plus rien ne bougeait. Les coquillages étaient morts.


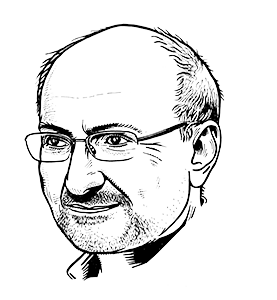
« Au cœur du 7e continent »
Patrick Deixonne
À quoi ressemble le septième continent vu d’un bateau ?
C’est une zone de déchets qui flottent sur des milliers de kilomètres carrés. À l’échelle terrestre, ce serait comme traverser la France par l’autoroute, en &ea…
La mer empoisonnée
Gilles Boeuf
Une mission scientifique française dénommée l’« Expédition 7e continent » a récemment effectué un périple dans l’Atlantique nord et nous ramène des observations qui défraient la chroni…
Plastique
Erik Orsenna
Pour une fois, proposons un chiffre : cent millions de tonnes. C’est une malédiction. C’est la masse de plastique, tous déchets confondus, dont il faudrait débarrasser la planète.
Nouveau monde
Ollivier Pourriol
– Et l’écologie ?
– L’écologie ? Il faut voir plus loin. Ce qui compte ce n’est pas demain, mais après-demain. Si vous voulez vraiment laisser une trace… Regardez les pyramides. Elles sont dans un é…







