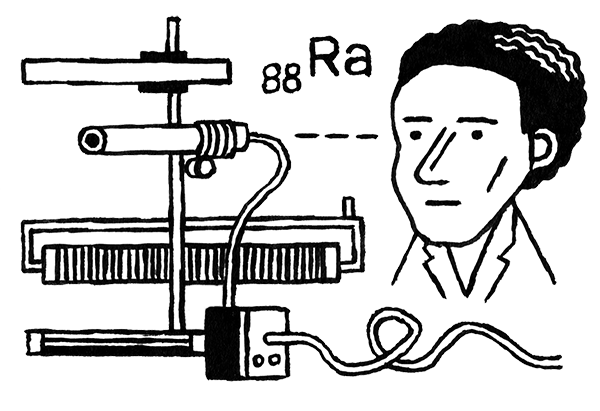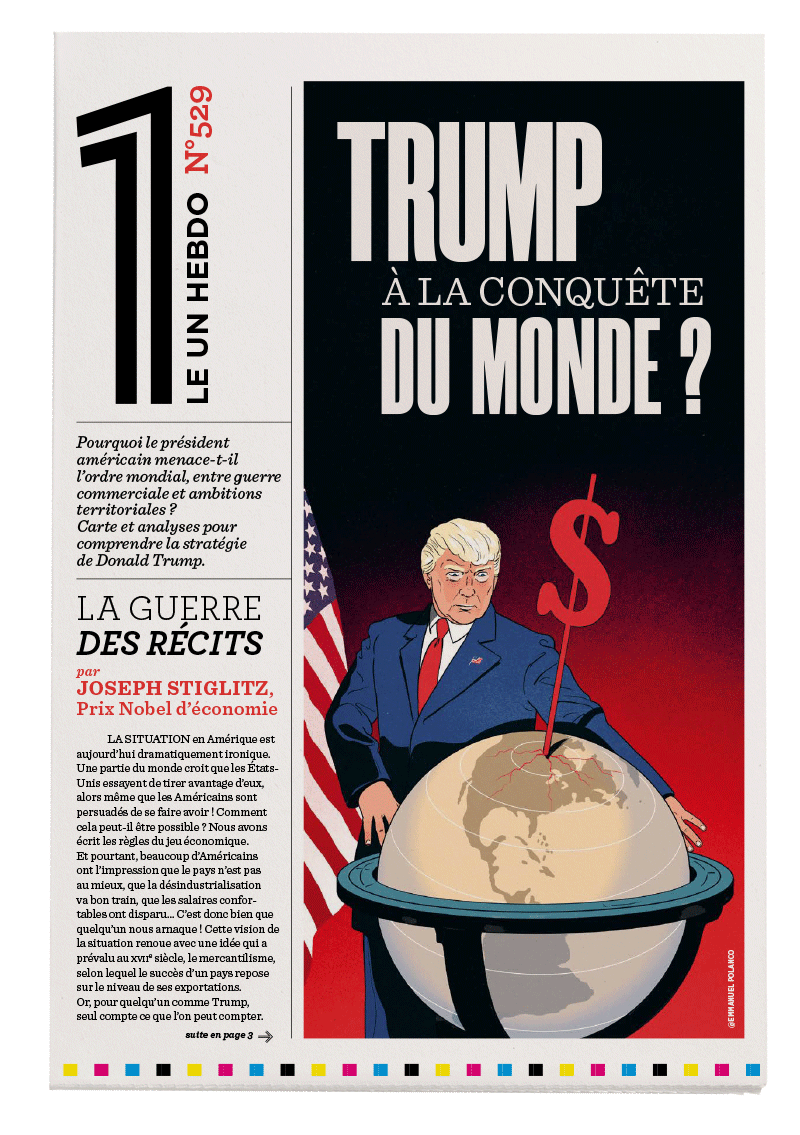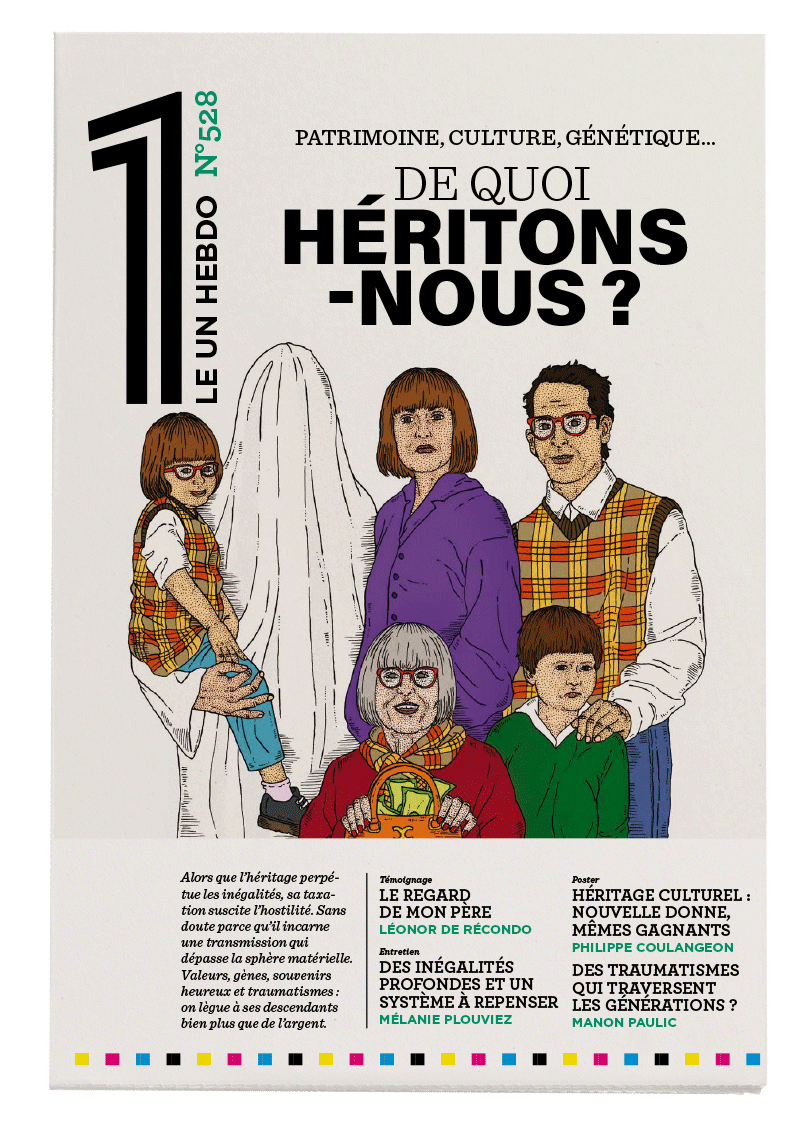Généalogie de la société civile
Temps de lecture : 10 minutes
Devant les candidats de son mouvement politique La République en marche ! (REM), Emmanuel Macron n’y est pas allé par quatre chemins : « Le renouvellement que vous représentez devant moi n’a jamais été réalisé avant, sous la Ve République. » Premiers visés, dans l’esprit du nouveau président de la République : les représentants de la « société civile » dont on évalue le nombre à 52 % des candidats estampillés REM. Quelques jours plus tard, le chef de l’État annonçait la composition du premier gouvernement de son quinquennat, en présentant dix des vingt-deux ministres comme issus de la « société civile ».
La notion de « société civile » est loin d’être nouvelle ; en revanche, la place qu’elle occupe aujourd’hui dans la tentative de renouvellement politique est massive et sans précédent. Si la greffe prend, à la suite des prochaines élections législatives, la représentativité des élus aura gagné sur la représentation nationale classique. La démocratie représentative, en pleine crise, tirera son épingle du jeu.
Le terme de « société civile » est aussi vieux que la démocratie. Dès le Ve siècle avant notre ère, Aristote, dans Les Politiques, en parle déjà comme d’une société organisée par des liens juridiques, qui s’oppose à la famille. C’est l’humanisme du XVIe siècle qui transmet l’expression que nous connaissons aujourd’hui, traduite du grec puis du latin. Le XVIIIe siècle la décrit d’abord comme une « société civilisée ».
Tout s’accélère au XIXe siècle, lorsque Hegel insiste sur les liens qu’elle entretient avec l’économie. Pour son bon fonctionnement, la société civile a aussi besoin de l’État, et des normes juridiques qu’il produit. On mesure alors le rapport de force – on peut dire la conflictualité – entre la société civile, largement en phase avec les problématiques économiques et sociales, et l’État. La jeune IIIe République ne se résout pas à laisser cette force vive à l’extérieur du modèle que les nouveaux hussards du régime sont en train de bâtir. C’est Pierre Waldeck-Rousseau, « le Périclès de la République », qui va pousser à la reconnaissance politique de cette société civile à laquelle il souhaite donner un statut. En 1884, ministre de l’Intérieur, il y parvient en introduisant une dérogation en faveur des groupements constitués sur le fondement des intérêts professionnels : c’est l’autorisation de former des syndicats. Puis en 1901, président du Conseil, il laisse son nom à la loi sur les associations, en étendant cette reconnaissance à tous les groupements – à l’exception des congrégations. Il fait ainsi de la liberté de s’associer un droit commun.
Chemin faisant, au fil du XXe siècle, la société civile a perdu de sa dimension polémique. Elle agit, en quelque sorte, comme un « groupe de pression ». La plus longue des Républiques ne lui fait d’ailleurs qu’une très maigre place, au sein de ses gouvernements de « concentration ». Il faut attendre les lendemains de la Première Guerre mondiale pour compter les maroquins offerts « aux intérêts et aux professions », selon l’expression en vigueur, avec la création des ministères techniques : les Pensions, l’Air, la Santé, les Régions libérées. Et avec eux l’arrivée au gouvernement de l’agronome Joseph-Honoré Ricard, de l’administrateur Émile Ogier, de l’ingénieur polytechnicien Louis Loucheur, de l’ancien combattant Georges Rivollet ou du chef d’état-major général de l’armée de l’air, Victor Denain. Le Front populaire apporte son lot de nominations en la matière, avec l’institutrice Suzanne Lacore, la savante Irène Joliot-Curie ou la militante féministe Cécile Brunschvicg, toutes trois sous-secrétaires d’État. On retiendra leur promotion d’abord comme une ouverture en direction des femmes, alors encore privées du droit de vote.
Aidée par la critique du totalitarisme et par la vigueur de la pensée libérale, la société civile devient la vedette des gouvernements d’ouverture dans les années 1970, à la suite de l’arrivée de Valéry Giscard d’Estaing à l’Élysée. Le nouveau président de la République a devancé Emmanuel Macron de quarante ans en proposant à des personnalités – souvent féminines – de la société civile d’entrer dans ses équipes, à des postes d’envergure : la journaliste Françoise Giroud à la Condition féminine, puis à la Culture ; la secrétaire générale du Conseil supérieur de la magistrature, Simone Veil, à la Santé ; l’ancienne doyenne de faculté, puis rectrice, Alice Saunier-Seïté aux Universités ; ou l’économiste Raymond Barre au Commerce extérieur, puis à Matignon.
On retient habituellement les années 1980 comme l’acmé de cette tendance, et singulièrement le gouvernement de Michel Rocard. Encouragée par l’agonie du communisme à l’Est, ou par l’essor du courant autogestionnaire portant critique de la démocratie représentative, la société civile décolle politiquement.
En trois ans, de 1988 à 1991, la « France unie », selon le vœu ancien de Michel Rocard, doit « s’ouvrir à la société civile ». Il signera, en ce sens, la circulaire du 25 mai 1988, et réitérera l’engagement dans son discours de politique générale du 29 juin suivant : « Je souhaite réconcilier l’action politique et la vie quotidienne, l’État et la société civile ». L’étiquette « société civile » est alors porteuse. Si ses mots sont loin de faire l’unanimité, il contribue au changement. Pierre Arpaillange devient garde des Sceaux ; Roger Fauroux est à l’Industrie, Jacques Chérèque à l’Aménagement du territoire et aux Reconversions, Brice Lalonde à l’Environnement, Roger Bambuck aux Sports.
Bernard Tapie bénéficie de cette tendance forte de la vie politique française : il devient ministre de la Ville en 1992. Les présidents de la République successifs reprendront l’idée, peu coûteuse mais populaire, en faisant venir près d’eux des ministres médiatisés. Nicolas Sarkozy, notamment, parvient à convaincre Bernard Kouchner (Quai d’Orsay), Fadela Amara (Banlieues), Martin Hirsch (Solidarités actives, puis Jeunesse) ou Jean-Pierre Jouyet (Affaires européennes) de le rejoindre.
Le remède a guéri la fièvre à plusieurs reprises, pas le mal profond qui tenaille la démocratie depuis des décennies. La société civile siégeant au gouvernement a su apporter ses prescriptions ; elles n’ont pas toutes été acceptées et suivies par une société politique aux codes bien ancrés. Avec la présentation du gouvernement d’Édouard Philippe, Emmanuel Macron innove plus profondément encore en nommant des ministres techniciens à des postes clés : une ancienne DRH au Travail ; un ancien recteur à l’Éducation nationale ; une championne d’escrime aux Sports ; une présidente d’université à l’Enseignement supérieur. C’est un pari risqué mais qui peut réussir. L’histoire a néanmoins retenu qu’un bon avocat ou un bon médecin ne faisait pas forcément un garde des Sceaux de qualité ou un ministre de la Santé habile.
En tout état de cause, élargir ainsi le gouvernement est une condition essentielle à la réussite du changement ; mais elle est loin d’être suffisante. Ce renouvellement devra trouver un écho au sein de l’Assemblée nationale. Son succès plein et entier, ou même relatif, dépendra de l’installation réelle et durable de la société civile au Parlement, et d’abord à l’Assemblée nationale. Ce furent les conditions de la réussite des précurseurs des actuels ministres d’ouverture.
Les années 1920 accompagnèrent la création et le succès des ministères techniques par la présence, dans les débats parlementaires, de la corporation des députés ingénieurs ou médecins, souvent rapporteurs de textes majeurs, à l’image d’un Édouard Grinda, spécialiste des assurances sociales. La reconstruction économique et sociale de la France leur doit beaucoup. La création des groupes parlementaires tels que le Comité républicain du Commerce et de l’Industrie, repris en mains par Alfred Mascuraud, a œuvré dans le même sens : faire entrer au Parlement un plus grand nombre d’industriels et de commerçants. Simultanément, la volonté de créer, à côté d’un Parlement politique, une assemblée composée de représentants des milieux professionnels, devenait réalité, avec la naissance, par le décret du 16 janvier 1925, du Conseil national économique. Sans empiéter sur les prérogatives du Parlement, sa seule existence et ses travaux transforment la conception et la pratique des rapports entre la politique et la société.
De nos jours, le travail parlementaire se nourrit d’ailleurs régulièrement des informations des représentants de la société civile, des auditions en commission jusqu’aux questions écrites et orales, des missions d’information aux commissions d’enquête. Les groupes d’études illustrent parfaitement ce souci du Parlement d’assurer une veille juridique et technique sur des questions trop spécialisées pour faire l’objet d’un examen approfondi par les commissions permanentes. Plus de cent groupes d’études ont été créés depuis les débuts de la législature qui s’achève. Ils ont œuvré, dans tous les domaines, à la participation de la société civile aux délibérations. De nombreuses rencontres ont été organisées : auditions de responsables de l’administration, de personnalités du secteur d’études concerné – des dirigeants d’entreprises aux acteurs du monde syndical –, voire visites de sites industriels ou d’entreprises.
Il reste donc à savoir si, dans la future majorité parlementaire, les élus de La République en marche ! venant de la société civile seront nombreux et en mesure de se former rapidement à la culture parlementaire, dans une Assemblée qui sera la plus fortement renouvelée depuis 1958. Ces deux conditions aidant, ils seront à même d’enrichir la qualité de la loi et de faciliter son application. Ils ne devront pas oublier entre-temps la troisième qualité qui a fait défaut à leurs prédécesseurs, « experts » comme eux : la capacité de s’imposer face à leurs collègues, professionnels de la politique. Pour essayer de préserver leur spécificité et donc leur qualité, il faudra qu’ils soient entendus de celui qui les a fait naître : Emmanuel Macron lui-même. Alors, et seulement alors, la société civile aura gagné.
Le modèle français
Pierre Rosanvallon
À l’aube du XXIe siècle, la démocratie est à la fois triomphante et incertaine. L’évidence désormais universellement revendiquée de ses principes s’accompagne en effet d’une perplexité croissante sur s…
[Instructions]
Robert Solé
Madame, Monsieur
Issu(e) de la société civile, vous venez d’être nommé(e) ministre. Félicitations. Veuillez cependant bien noter ceci : 1) Le fauteuil rehaussé de dorures qui vous a été livré appartient au Mobilier n…
Est-ce un fromage ?
Philippe Meyer
La société civile est semblable au camembert. Ce n’est qu’une appellation. De probes artisans peuvent s’en réclamer. Des arrivistes cupides peuvent profiter de sa réputation. La qualification « société civile » plac…