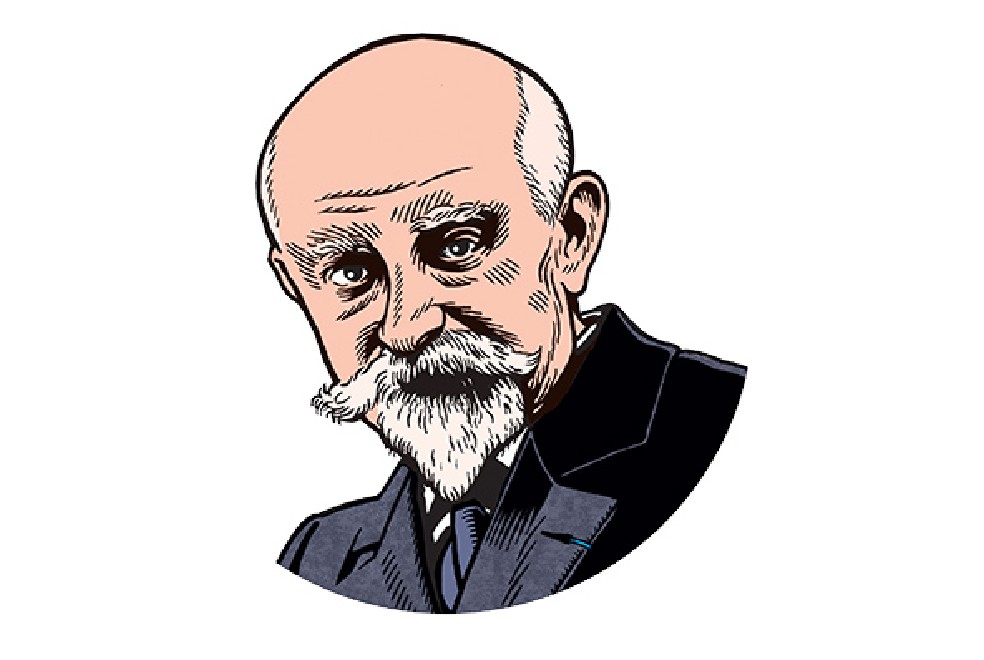Déclaré gâteux
Temps de lecture : 5 minutes
Bougran rentra dans sa pièce et s’affaissa, anéanti, sur une chaise. Puis il eut l’impression d’un homme qu’on étrangle ; il mit son chapeau et sortit pour respirer un peu d’air. Il marchait dans les rues, et, sans même savoir où il était, il finit par échouer sur un banc, dans un square.
Ainsi, c’était vrai ; il était mis à la retraite à cinquante ans ! lui qui s’était dévoué jusqu’à sacrifier ses dimanches, ses jours de fête pour que le travail dont il était chargé ne se ralentît point. Et voilà la reconnaissance qu’on avait de son zèle ! Il eut un moment de colère, rêva d’intenter un recours devant le Conseil d’État, puis, dégrisé, se dit : je perdrai ma cause et cela me coûtera cher.
Oui, le législateur de 1853 a partout ouvert dans un texte indulgent des chausse-trapes ; il a tout prévu, conclut-il ; le cas de la suppression d’emploi qui est un des plus usités pour se débarrasser des gens ; on supprime l’emploi du titulaire, puis on rétablit l’emploi quelques jours après, sous un autre nom, et le tour est joué. Il y a encore les infirmités physiques contractées dans l’exercice des fonctions et vérifiées par la complaisance pressée des médecins ; il y a, enfin – le mode le plus simple, en somme – la soi-disant invalidité morale, pour laquelle il n’est besoin de recourir à aucun praticien, puisqu’un simple rapport, signé par votre directeur et approuvé par la direction du personnel, suffit.
– C’est le système le plus humiliant. Être déclaré gâteux ! c’est un peu fort, gémissait M. Bougran.
Comment se distraire d’un métier qui vous prenait aux moelles, vous possédait, tout entier, à fond ?
Mentalement, il supputait la retraite proportionnelle à laquelle il aurait droit : dix-huit cents francs au plus ; avec les petites rentes qu’il tenait de son père, c’était tout juste de quoi vivre. Il est vrai, se dit-il, que ma vieille bonne Eulalie et moi, nous vivons de rien.
Mais, bien plus que la question des ressources personnelles, la question du temps à tuer l’inquiéta. Comment rompre, du jour au lendemain, avec cette habitude d’un bureau vous enfermant dans une pièce toujours la même, pendant d’identiques heures, avec cette coutume d’une conversation échangée, chaque matin, entre collègues. Sans doute, ces entretiens étaient peu variés ; ils roulaient tous sur le plus ou moins d’avancement qu’on pouvait attendre à la fin de l’année, supputaient de probables retraites, escomptaient même de possibles morts, supposaient d’illusoires gratifications, ne déviaient de ces sujets passionnants que pour s’étendre en d’interminables réflexions sur les événements relatés par le journal. Mais ce manque même d’imprévu était en si parfait accord avec la monotonie des visages, la platitude des plaisanteries, l’uniformité même des pièces !
Puis n’y avait-il pas d’intéressantes discussions dans le bureau du chef ou du sous-chef, sur la marche à imprimer à telle affaire ; par quoi remplacer désormais ces joutes juridiques, ces apparents litiges, ces gais accords, ces heureuses noises ; comment se distraire d’un métier qui vous prenait aux moelles, vous possédait, tout entier, à fond ?
Et M. Bougran secouait désespérément la tête, se disant : je suis seul, célibataire, sans parents, sans amis, sans camarades ; je n’ai aucune aptitude pour entreprendre des besognes autres que celles qui, pendant vingt ans, me tinrent. Je suis trop vieux pour recommencer une nouvelle vie. Cette constatation le terrifia.
Comme aucun [de ses collègues] n’était menacé par son âge d’un semblable sort, ils exhibaient une résignation de bon aloi
– Voyons, reprit-il, en se levant, il faut pourtant que je retourne à mon bureau ! – ses jambes vacillaient. Je ne me sens pas bien, si j’allais me coucher. Il se força à marcher, résolu à mourir, s’il le fallait, sur la brèche. Il rejoignit le ministère et rentra dans sa pièce.
Là, il faillit s’évanouir et pour tout de bon. Il regardait, ahuri, les larmes aux yeux, cette coque qui l’avait, pendant tant d’années, couvert ; – quand, doucement, ses collègues, à la queue leu leu, entrèrent.
Ils avaient guetté la rentrée et les condoléances variaient avec les têtes. Le commis d’ordre, un grand sécot, à tête de marabout, peluchée de quelques poils incolores sur l’occiput, lui secoua vivement les mains, sans dire mot ; il se comportait envers lui comme envers la famille d’un défunt, à la sortie de l’église, devant le corps, après l’absoute. Les expéditionnaires hochaient la tête, témoignaient de leur douleur officielle, en s’inclinant.
Les rédacteurs, ses collègues, plus intimes avec lui, esquissèrent quelques propos de réconfort.
– Voyons, il faut se faire une raison – et puis, mon cher, songez qu’en somme, vous n’avez ni femme, ni enfants, que vous pourriez être mis à la retraite dans des conditions infiniment plus dures, en ayant, comme moi, par exemple, une fille à marier. Estimez-vous donc aussi heureux qu’on peut être en pareil cas.
– Il convient aussi d’envisager dans toute affaire le côté agréable qu’elle peut présenter, fit un autre. Vous allez être libre de vous promener, vous pourrez manger au soleil vos petites rentes.
– Et aller vivre à la campagne où vous serez comme un coq en pâte, ajouta un troisième.
Bougran fit doucement observer qu’il était originaire de Paris, qu’il ne connaissait personne en province, qu’il ne se sentait pas le courage de s’exiler, sous prétexte d’économies à réaliser, dans un trou ; tous n’en persistèrent pas moins à lui démontrer qu’en fin de compte, il n’était pas bien à plaindre.
Et comme aucun d’eux n’était menacé par son âge d’un semblable sort, ils exhibaient une résignation de bon aloi, s’indignaient presque de la tristesse de M. Bougran.
Extrait abrégé de La Retraite de Monsieur Bougran, nouvelle de 1888
« Se concentrer sur l’âge, et non sur l’emploi, est un désastre »
Anne-Marie Guillemard
Spécialiste du vieillissement et de la protection sociale, la sociologue Anne-Marie Guillemard décrypte les véritables enjeux d’une réforme globale des politiques publiques relative aux seniors.
[À tout prendre]
Robert Solé
Doit-on dire « Je partirai à la retraite » ou « Je partirai en retraite » ? Le point avec l'écrivain et journaliste Robert Solé.
« J’ai réalisé mon petit rêve… J’ai arrêté de travailler à 45 ans »
Arthur Frayer-Laleix
Enquête du reporter Arthur Frayer-Laleix sur les retraités atypiques, qu’ils soient jeunes et frugalistes ou, au contraire, refusent de cesser leur activité professionnelle, quitte à ne pas être payés.