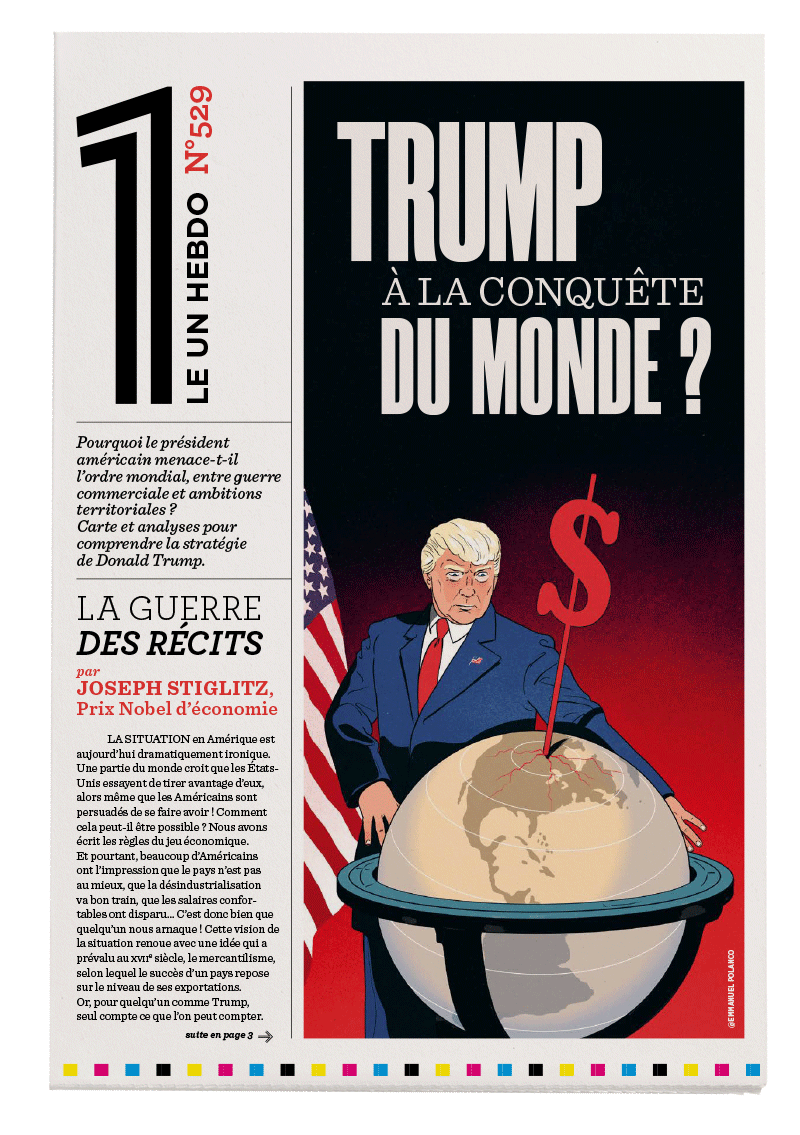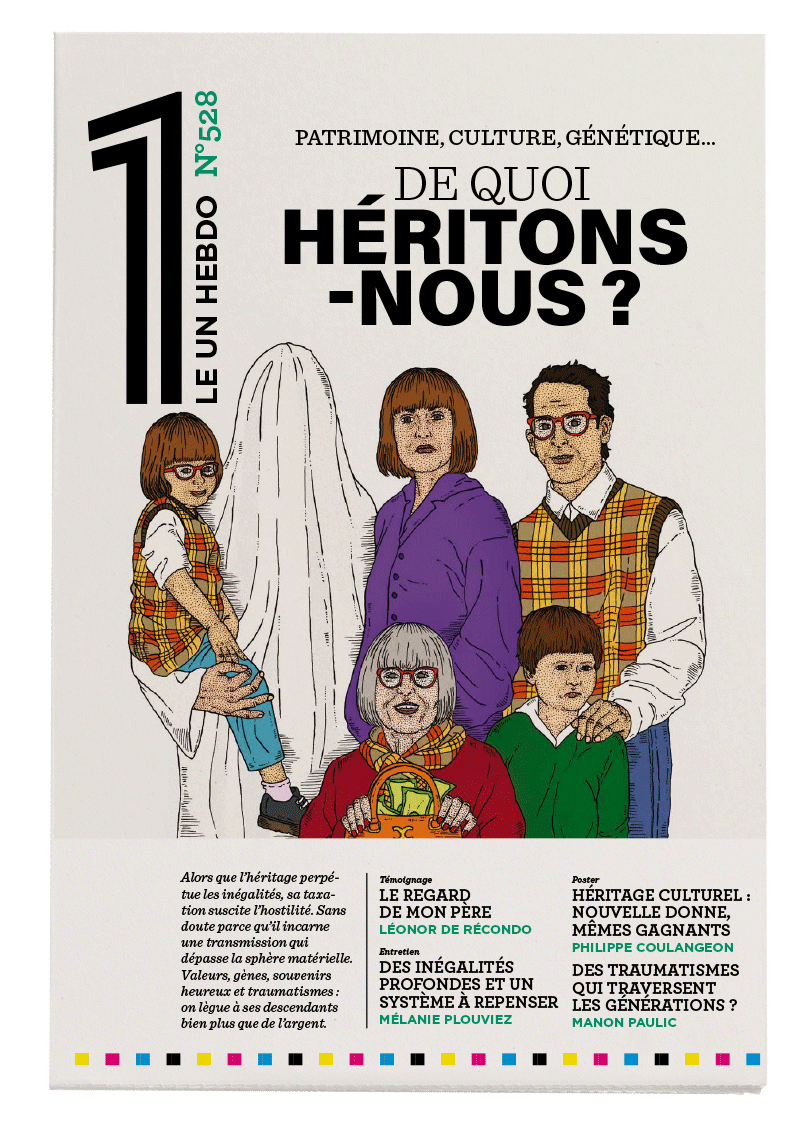Poutine vu par Obama : « Une carrure de lutteur »
Temps de lecture : 5 minutes
Ma première rencontre avec Vladimir Poutine s’est tenue le lendemain matin, dans sa datcha en banlieue de Moscou. J’étais accompagné par Jim Jones* ainsi que par nos spécialistes de la Russie, Mike McFaul et Bill Burns. Ayant eu par le passé quelques contacts avec Poutine, Burns m’a conseillé d’éviter un trop long exposé initial. « Il est très sensible à tout ce qu’il perçoit comme un affront, m’a-t-il expliqué. Et, dans son esprit, c’est lui le dirigeant le plus expérimenté. Le mieux serait peut-être de commencer en lui demandant ce qu’il pense de l’état des relations entre les États-Unis et la Russie, histoire de lui permettre de vider son sac. »
Après avoir franchi un imposant portail et remonté une longue allée, nous sommes arrivés devant un véritable château au pied duquel Poutine nous attendait pour l’indispensable séance photo. Physiquement, il n’avait rien de remarquable : petit et trapu – une carrure de lutteur –, une fine chevelure blond-roux, un nez saillant, des yeux clairs et vigilants. Tandis que nous échangions quelques civilités, j’ai remarqué chez lui une certaine désinvolture, une indifférence exercée dans la voix, indiquant qu’il avait l’habitude d’être entouré de subordonnés et de solliciteurs. C’était un homme accoutumé au pouvoir.
Même si sa diatribe était de toute évidence préparée, sa vexation était réelle
Accompagné par Sergueï Lavrov, le discret ministre des Affaires étrangères et ancien représentant de la Russie à l’ONU, Poutine nous a conduits jusqu’à une spacieuse terrasse où un véritable festin nous attendait : des œufs, du caviar, un grand choix de pains et de thés, tout cela servi par un personnel en tenue traditionnelle de paysan et bottes de cuir. Après avoir remercié Poutine pour son hospitalité et relevé les progrès accomplis par nos deux pays grâce aux accords de la veille, je lui ai demandé ce qu’il pensait des relations entre Moscou et Washington durant sa présidence.
Burns ne plaisantait pas en disant qu’il en avait gros sur le cœur. À peine avais-je terminé ma question qu’il s’est lancé dans un monologue animé et intarissable, énumérant par le menu les injustices, trahisons et affronts que les Américains lui avaient fait subir ainsi qu’au peuple russe. Sur le plan personnel, il appréciait le président Bush, à qui il avait offert son aide après le 11-Septembre, lui témoignant sa solidarité et proposant un partage d’informations dans la lutte contre l’ennemi commun. Il avait aidé les États-Unis à sécuriser des bases aériennes au Kirghizistan et en Ouzbékistan pendant la campagne d’Afghanistan. Il avait même offert son appui face à Saddam Hussein.
Et tout ça pour quoi ? Sans tenir compte de ses avertissements, Bush avait envahi l’Irak et déstabilisé tout le Moyen-Orient. Sept ans plus tard, les États-Unis décidaient de se retirer du traité sur les systèmes antimissiles balistiques et projetaient d’installer des batteries antimissiles le long des frontières russes, ce qui demeurait une source d’instabilité stratégique. L’entrée dans l’Otan des pays de l’ancien pacte de Varsovie sous Clinton puis sous Bush avait progressivement rogné la « sphère d’influence » de la Russie, tandis que le soutien de Washington aux « révolutions de couleur » en Géorgie, en Ukraine et au Kirghizistan – sous l’estampille douteuse de « promotion de la démocratie » – avait transformé des voisins naguère amicaux en ennemis de la Russie. Aux yeux de Poutine, les Américains s’étaient montrés arrogants et méprisants en refusant de traiter Moscou sur un pied d’égalité et en essayant sans relâche de dicter leurs conditions au reste du monde. Pour toutes ces raisons, il se disait peu optimiste quant au futur des relations entre nos deux pays.
Trente minutes après le début de cette rencontre censée durer une heure, mes assistants ont commencé à jeter des coups d’œil discrets à leur montre. J’ai cependant décidé de ne pas interrompre Poutine. Même si sa diatribe était de toute évidence préparée, sa vexation était réelle. Je savais également que la poursuite des avancées avec Medvedev reposerait sur l’apaisement de son Premier ministre. Au bout de trois quarts d’heure environ, Poutine a enfin été à court de reproches et, plutôt que de tenter de recoller à l’ordre du jour, j’ai commencé à lui répondre point par point. Je lui ai rappelé que je m’étais personnellement opposé à l’invasion de l’Irak, mais que je condamnais de la même façon l’action de la Russie en Géorgie, en vertu du droit de chaque nation à choisir ses alliés et ses partenaires économiques sans ingérence extérieure. J’ai contesté l’idée selon laquelle un système de défense restreint, conçu pour nous protéger d’un tir de missile iranien, aurait une quelconque incidence sur le puissant arsenal nucléaire russe, mais j’ai évoqué mon intention de commander une étude avant d’aller plus loin dans la défense antimissiles en Europe. Quant au « redémarrage » que nous avions proposé, j’ai expliqué que son but n’était pas d’éliminer toutes les divergences entre nos pays, mais de dépasser les habitudes héritées de la guerre froide pour créer une relation mature et pragmatique, susceptible de prendre en compte ces différences tout en servant nos intérêts communs.
Par moments, la conversation devenait houleuse, surtout quand il était question de l’Iran. Poutine dédaignait mes inquiétudes au sujet du programme nucléaire iranien et s’est agacé lorsque j’ai suggéré qu’il suspende la vente du puissant système sol-air S-300 à Téhéran. Il a répondu que ces missiles étaient purement défensifs et a ajouté que, en revenant sur un contrat à 800 millions de dollars, il mettrait en danger à la fois les finances et la réputation des fabricants d’armes russes. Mais, dans l’ensemble, il m’a écouté avec attention et, au terme de ce qui s’était transformé en un marathon de deux heures, il a exprimé, sinon de l’enthousiasme, du moins une certaine ouverture à l’idée d’un « redémarrage ».
« Bien entendu, vous devrez voir tout cela avec Dmitri, a conclu Poutine en me raccompagnant. C’est lui qui décide. » Nos regards se sont croisés lorsque nous nous sommes serré la main. Nous étions tous deux conscients que cette affirmation était sujette à caution, mais, pour le moment du moins, j’avais son soutien, ou en tout cas ce qui s’en approchait le plus.
* Conseiller à la sécurité nationale.
Une terre promise © Librairie Arthème Fayard, 2020, pour la traduction française de Pierre Demarty, Charles Recoursé et Nicolas Richard
« Poutine a toutes les cartes en main »
Michel Foucher
Le géographe et ancien diplomate Michel Foucher revient sur les origines de la crise ukrainienne et ses possibles développements.
[Poutinerie]
Robert Solé
La poutine se compose de frites molles, noyées de sauce brune et recouvertes d’un fromage en grains qui doit, paraît-il, faire « couic couic » sous la dent.
Les dix commandements de Poutine
Michel Eltchaninoff
Le philosophe et écrivain Michel Eltchanioff décrypte les principaux objectifs de Poutine, de l’obsession de maintenir les ex-pays soviétiques sous son emprise à la défense des valeurs traditionnelles face à une Europe jugée décadente.