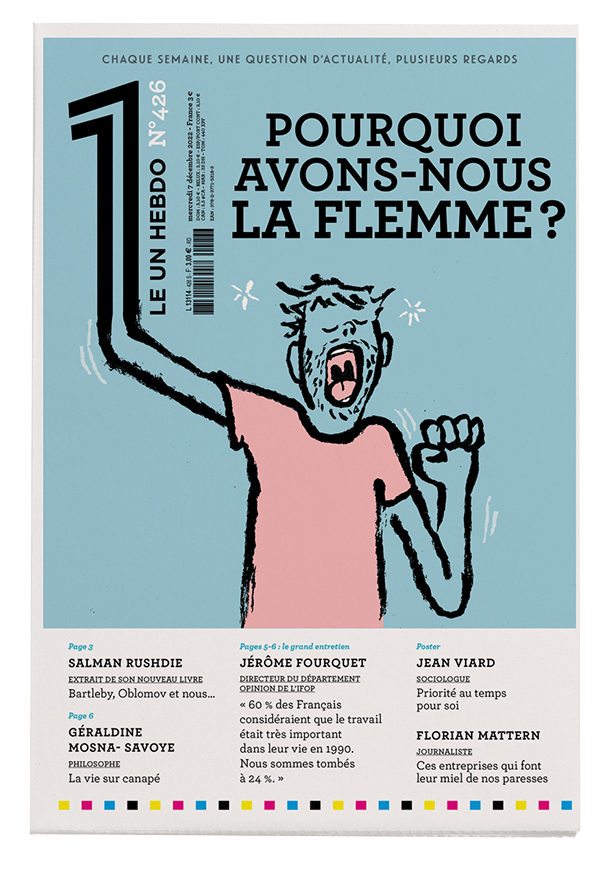« Un tiers de la population est moins motivée qu’auparavant »
Temps de lecture : 8 minutes
Vous discernez avec Jérémie Peltier une grosse fatigue et une épidémie de flemme dans notre société. Dans quelle proportion les Français seraient-ils flemmards ?
30 à 45 % des personnes sondées indiquent être moins motivées qu’auparavant. Cela joue dans tous les compartiments de leur vie, qu’il s’agisse du travail ou de la vie personnelle. Les items sont de natures très différentes et se recoupent : les Français nous disent avoir la flemme de sortir le soir, être plus fatigués qu’avant quand ils fournissent un effort physique, ressentir une baisse de moral. Un tiers de la population ne représente pas toute la société, mais ce n’est pas négligeable. L’ampleur de ce phénomène a été une surprise.
Est-ce un phénomène récent ?
Nous formulons l’hypothèse qu’il s’agit d’un processus ancien qui s’est accentué au cours des dernières années. Les enquêtes de l’Ifop ont montré que durant la période 2015-2017, marquée par des attentats, plus de 50 % de la population était très inquiète face à la menace terroriste. Il y a eu ensuite la crise des Gilets jaunes, moment de forte crispation sociale, puis la pandémie de Covid et désormais la guerre en Ukraine avec le spectre de l’arme nucléaire. Contrairement à ce qui a pu être proclamé sur le caractère très résilient de la société française à l’occasion de ces événements hors norme, un pan non négligeable a été fragilisé. Ces personnes portent aujourd’hui les stigmates physiques et psychologiques de cette succession de chocs.
Observe-t-on des disparités générationnelles, de genre et régionales ?
Le phénomène est assez général, mais les 18-35 ans sont les plus concernés. Les femmes ont d’autre part été plus touchées que les hommes. Prenez la flemme de sortir de chez soi : les hommes répondent positivement à 41 %, les femmes à 49 %. À la question : « Avez-vous la solidité mentale pour supporter les aléas de la vie quotidienne ? », 24 % des hommes répondent non, contre 37 % des femmes.
Enfin, les réponses des habitants de la région parisienne sont plus marquées. C’est la disparité régionale la plus forte qui s’explique en raison de confinements plus difficiles, d’une menace terroriste plus palpable, de grèves des transports plus lourdes.

Prenons le domaine du travail, qui a longtemps été central dans nos vies, qu’en est-il aujourd’hui ?
Typiquement, sur ce sujet, l’analyse doit se déployer sur le temps long. En 1990, 60 % des Français considéraient que le travail était très important dans leur vie. Nous sommes tombés à 24 % aujourd’hui. Les chiffres sont saisissants. Dans le même temps, les loisirs sont passés de 25 % à 41 % dans la préoccupation des sondés, devenant plus importants que le travail. En pleine ère sarkozyste, en 2008, 60 % des salariés déclaraient qu’ils préféraient à tout prendre avoir moins de temps libre et plus d’argent. En 2022, le résultat est inverse : 60 % des sondés indiquent préférer avoir plus de temps et gagner moins.
Plusieurs facteurs d’explication se conjuguent pour comprendre ce basculement. Objectivement, les Français passent moins de temps à travailler, les lois sur la réduction du temps de travail sont passées par là ; les jeunes générations, qui ont grandi dans une société hédoniste, n’entretiennent pas le même rapport au monde du travail ; l’industrie du loisir est devenue économiquement majeure dans nos sociétés.
« En 1990, 60 % des Français considéraient que le travail était très important dans leur vie. Nous sommes tombés à 24 % aujourd’hui »
On peut aussi observer que les jeunes ont pu voir leurs parents se faire licencier alors qu’ils s’investissaient beaucoup dans leur travail. On paye trente ans de plans sociaux, de fermeture d’entreprises, de chômage des seniors. Sans compter la perte de sens de nombreux postes. On peut rappeler le désarroi des personnels soignants expliquant dans des entretiens : « Nous nous sommes engagés dans cette profession pour soigner des malades et nous nous retrouvons à remplir des tableaux Excel. Ils ont dénaturé notre travail. » Une partie des salariés se sont en conséquence détournés de leur travail. Ce dernier convient moins, épanouit moins ; une distance s’est créée.
La pandémie de Covid a-t-elle joué un rôle ?
Elle a eu un rôle d’accélérateur. 11 millions d’actifs se sont retrouvés au chômage partiel. Manifestement, ces personnes en ont profité pour faire le point sur leur existence : 10 % des personnes interrogées disent alors vouloir « changer de vie » et 25 % vouloir « changer beaucoup de choses ». Cette période d’introspection générale a participé à la remise en cause de la centralité du travail. Puis est arrivée la question du télétravail, pour 25 % de l’ensemble des salariés.
Quel est votre diagnostic sur ce point ?
Pour les salariés concernés, la perte de centralité du travail s’accélère. Ils ne sont plus reliés à leur entreprise, deux jours par semaine au minimum, que sur un mode numérique. Cela change beaucoup de choses même si le télétravail est plébiscité par 85 % de ceux qui en bénéficient. Ces données sont à mettre en regard de celles dont on dispose au sujet des employés de la restauration et de l’hôtellerie. Au terme de leur introspection, beaucoup de ceux-ci ont manifesté qu’ils ne voulaient pas retourner au boulot. Ils ont pris conscience durant le confinement qu’ils ne souhaitaient plus continuer un travail qui les privait de leur famille le week-end, par exemple. Avec le recul, on peut observer les effets profonds de ce moment.
S’agit-il d’une prise de distance ou d’une épidémie de flemme ?
Les deux. Une partie des sondés nous disent être moins motivés au boulot, mais c’est sans doute que c’est moins central pour eux. À la question : « Avez-vous le sentiment d’être plus motivé qu’avant dans votre travail ? », 12 % répondent davantage, 51 % ni l’un ni l’autre, 37 % moins motivés.
Vous étudiez aussi ce qu’on appelle le « business de la flemme », notamment les livraisons à domicile. Peut-on dire que les technologies ont créé ce marché ?
Le système a su fournir aux consommateurs ce dont ils ont envie ou besoin. Il surfe sur toutes les demandes et un entrepreneur comme Jeff Bezos, à la tête d’Amazon, s’adresse aux profondeurs de nos cerveaux reptiliens en proposant tout, à tout le monde, n’importe quand et partout. Il a développé d’énormes outils logistiques pour le permettre. Et derrière Amazon, beaucoup d’autres acteurs économiques se sont engouffrés dans ce créneau de la flemme. C’est fascinant à quel point le caractère très plastique du marché capitaliste s’adapte à beaucoup de conjonctures, profitant de toutes les opportunités.
Pouvez-vous brosser le panorama de cette économie ? Que peut-on faire qu’on ne faisait pas autrefois ?
À peu près tout : se faire livrer des repas ou ses courses, accéder à des catalogues de films et de séries pléthoriques… Ces entreprises développent en parallèle un discours visant à déculpabiliser moralement le consommateur. « Vous avez la flemme, nous avons la flamme », assure Charal, l’un des leaders de la viande surgelée. Le capitalisme rentre chez les individus comme jamais il n’était entré.
« Derrière Amazon, beaucoup d’acteurs économiques se sont engouffrés dans le créneau de la flemme »
On peut noter qu’en 1981, lorsque la gauche au pouvoir vote le passage aux 39 heures de travail hebdomadaire et la cinquième semaine de congés payés, il y a encore une volonté d’accompagner ce changement. La création d’un ministère du Temps libre est là pour proposer à la population des options culturelles ou de loisirs pour occuper ce temps disponible. En 1998, les lois Aubry et le passage aux 35 heures ne sont accompagnés d’aucun dispositif public. La puissance publique abandonne au marché ce temps libéré. Et le marché, en s’appuyant sur l’émergence d’Internet, s’en est très bien occupé avec Airbnb, lastminute.com, etc. Ce temps libéré n’est pas perdu pour tout le monde !
Comment se caractérise le repli sur le cocon domestique ?
L’un des meilleurs exemples est celui du vendredi soir. À la question : « Quelle est votre soirée idéale ? », les sondés répondent majoritairement : « Regarder une série sur écran plat, dans son canapé, avec un plateau-repas livré à domicile. » On peut partager cette soirée avec des amis, mais cela se fera chez soi, ce qui caractérise la flemme de sortir. Il existe bien sûr une autre dimension qui se greffe sur ce « cocooning » : celle du coût d’une soirée dehors. Aller boire un verre en terrasse, dîner au restaurant ou s’offrir une place de cinéma représente un vrai budget à un moment où il y a une tension sur le pouvoir d’achat. Il reste que 45 % des sondés déclarent avoir la flemme de sortir de chez soi ; on atteint 51 % en région parisienne, contre 40 % dans les communes rurales.
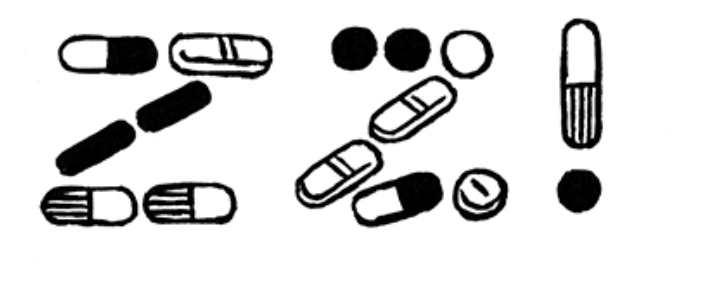
En partant du constat de cette grosse fatigue et de cette flemme, diriez-vous que le pays est déprimé, voire dépressif ?
Plutôt qu’une grosse déprime collective, je pointerais un effet de traîne du Covid, une sorte de Covid long qui touche une minorité importante de la population. Toutes les épreuves encaissées, sans oublier les mouvements sociaux, les tensions interindividuelles, la délinquance, ont laissé des traces qui font privilégier aujourd’hui le chez soi, le calme, l’aspiration au canapé. C’est la suite probable d’une séquence, qui va de mars 2020 à mars 2021, au cours de laquelle les Français ont été placés face à une perspective angoissante : un risque viral mortel pour eux ou pour leurs proches. Les « Gaulois réfractaires » sont restés sagement à la maison quand on leur a dit de se confiner. Beaucoup ont su tourner la page après l’épidémie, pas tous.
Plus profondément, il existe un vrai spleen national, une interrogation collective sur notre destin : on parle beaucoup de vivre-ensemble… c’est bien que cela ne va pas de soi ! La question de notre rapport au monde, sujet résolu chez nos principaux voisins, est problématique.
Les Français s’interrogent-ils sur la place de la France ?
Ils ont reçu une vraie blessure d’orgueil en constatant qu’ils n’avaient pas su inventer un vaccin contre le Covid, ou qu’ils étaient dans l’incapacité de produire sur-le-champ du Doliprane. De même qu’ils ont découvert que leur système de santé n’est pas, ou n’est plus, le meilleur du monde. D’où l’interrogation : où en sommes-nous ? Et la réponse : on est tombés en deuxième division. Comment le supporter quand aucune pédagogie n’a été déployée pour l’expliquer ?
Tout cela joue sur le moral collectif. Le décalage entre un discours de grandeur et une réalité moins flamboyante fait mal. Devant l’exigence et les difficultés de rester en première division, une fraction non négligeable des Français, notamment dans les classes populaires, suggèrent de mettre les pouces, de poser le sac. Ils congédient l’ambition nationale sur le mode « Vivement le grand soir, qu’on se couche ! ». En conclusion, la flemme individuelle peut aussi prendre la forme, à l’échelle collective, d’une flemme de grandeur.
Propos recueillis par LAURENT GREILSAMER
« Un tiers de la population est moins motivée qu’auparavant »
Jérôme Fourquet
Jérôme Fourquet nous livre son analyse des résultats de l’étude « Les Français, l’effort et la fatigue », menée par son institut, l'Ifop, pour la Fondation Jean-Jaurès et publiée le mois dernier.
[Relax]
Robert Solé
Le verbe « chiller » (de l’anglais to chill : prendre du bon temps à ne rien faire, ou de chill out : se relaxer, décompresser) fait son entrée dans l’édition 2023 du Petit Robert.
Cultivez votre flemme, on s’occupe de tout
Florian Mattern
Si le secteur du quick commerce n’a cessé de se développer, il ne garantit pour l’instant ni une véritable rentabilité à ses entreprises, ni des conditions de travail décentes.