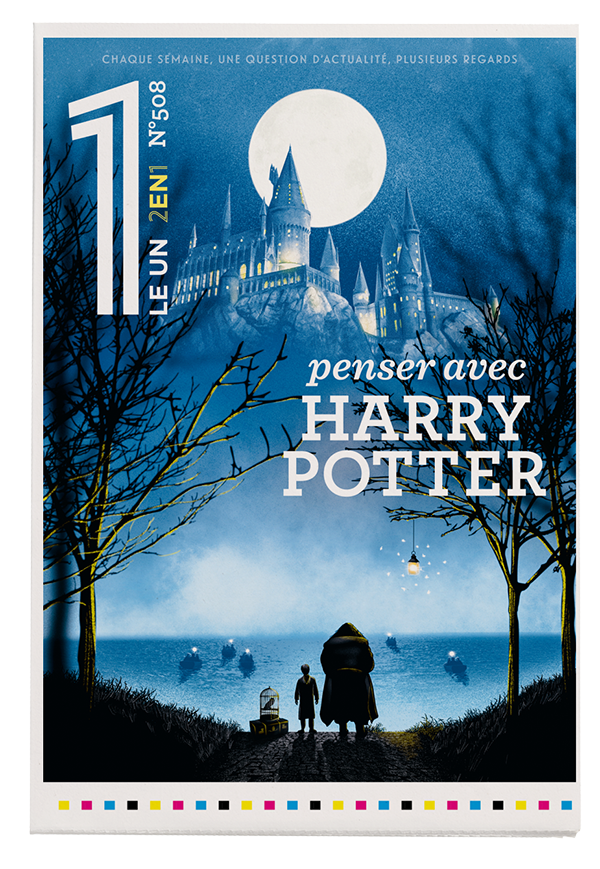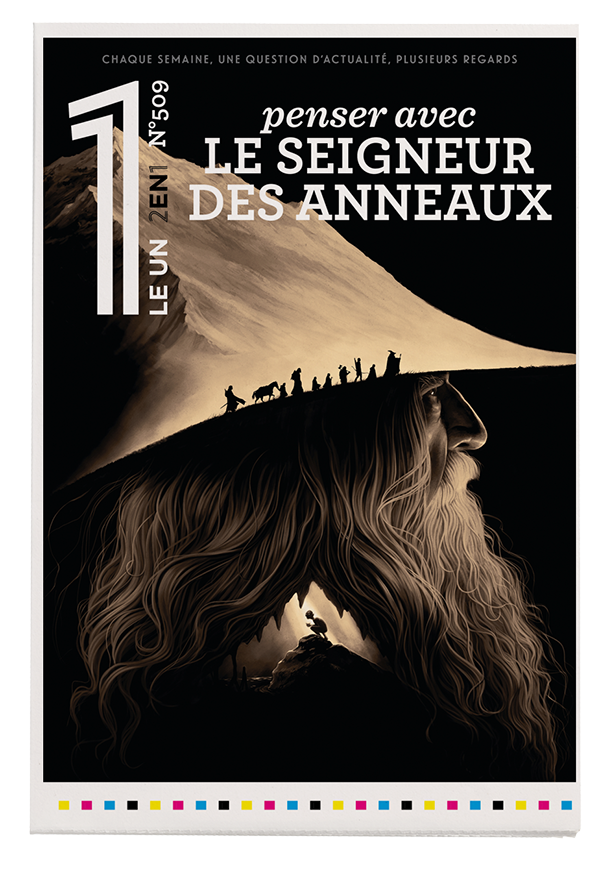Leçons de philosophie
Temps de lecture : 7 minutes
Platon et la possibilité de la vertu
En rentrant à Poudlard, comme jeune sorcier ou comme lecteur, on croit suivre des cours de défense contre les forces du mal, de potions ou de sortilèges, mais on suit en réalité des leçons de philosophie. Et la première d’entre elles tient à une certaine vision platonicienne du monde. Harry reçoit en effet en cadeau une cape d’invisibilité, dont le pouvoir est similaire à celui de l’anneau que découvrit Gygès, dont le mythe est raconté par Platon dans La République. Or Gygès se servit de cet anneau pour séduire une reine, tuer le roi et s’emparer du pouvoir. Est-on condamné à faire le mal si l’on est sûr de ne pas être découvert ?
À cette question, J.K. Rowling répond à la suite de Platon qu’une conduite morale est possible, et qu’Harry, fort de sa cape, la met au service de la justice et non de son propre intérêt. Mais à quoi peuvent servir ces bonnes actions ? L’homme vertueux est-il forcément heureux ? Dans le Gorgias, Socrate soutient contre Polos que « celui qui commet l’injustice est toujours plus malheureux que celui qui la subit ». Là encore, J.K. Rowling est de son côté, comme en témoigne l’altération physique de Voldemort : le jeune et beau Tom Jedusor va peu à peu se métamorphoser, à force de crimes, en un être laid et repoussant. « Tuer déchire l’âme », affirme le professeur Slughorn au sujet de la création des Horcruxes, et on voit là la sanction immédiate, dans sa chair, d’un acte immoral. Lors de la bataille finale, Harry enjoint à Voldemort de se repentir, car il pense – là encore selon la vision platonicienne – qu’il est possible de purifier son âme, séparée de son corps. Ce que Voldemort refuse, précipitant sa chute.
Les stoïciens et la quête du bonheur
En voulant se protéger de l’influence de Voldemort, Harry suit des cours d’occlumancie avec Rogue, pour discipliner son esprit. Ceux-ci ne sont pas sans rappeler les exercices stoïciens. Ce n’est, à vrai dire, pas le domaine où le héros excelle le plus ! En revanche, il est bien meilleur élève dans la discipline de Lupin, qui lui aussi enseigne en stoïcien, en soutenant qu’une part de notre malheur tient aux représentations erronées que nous nous faisons de notre monde. C’est ainsi que l’épouvantard, qui prend la forme de notre plus grande peur, est utilisé pour mettre à distance les images que nous formons dans notre esprit et qui nourrissent notre angoisse. De même, le conseil de Dumbledore est de nommer Voldemort par son nom plutôt que de l’appeler « Vous-Savez-Qui », car « la peur d’un nom ne fait qu’accroître la peur de la chose elle-même ». Marc-Aurèle ne disait pas autre chose quand il affirmait qu’il fallait voir les choses en elles-mêmes, telles qu’elles sont « dans leur essence ». Harry, lui, se perd dès lors qu’il fait confiance aux seules représentations, comme lorsqu’il se précipite pour aider un Sirius torturé, alors que ce ne sont que des images projetées par Voldemort. A contrario, Ron profite de la représentation qu’il se fait de Felix Felicis, la potion de chance liquide qu’il croit avoir bue, pour exceller au Quidditch.
Face à ces pièges de la représentation et des illusions, il faut donc apprendre à discipliner son esprit, en s’accrochant à des souvenirs heureux – c’est le sens du Patronus –, mais aussi à discipliner son désir. Nul objet ne symbolise mieux cette ambition que le Miroir du Riséd, qui montre notre désir le plus cher. Harry se perd dans la contemplation de ses parents morts, et il faut que Dumbledore intervienne pour l’en détacher. Il rappelle ainsi, après Épictète, qu’il ne faut désirer que ce qui dépend de nous, prélude indispensable au bonheur.
Sartre et l’exigence de liberté
L’univers d’Harry Potter est marqué par la place qu’y tiennent les prophéties. Mais celles-ci sont livrées par un personnage, la professeure Trelawney, dont la saga se moque volontiers, à l’image des remarques acerbes de la professeure McGonagall, dont le prénom, Minerva, renvoie au nom de la déesse romaine de la sagesse, Minerve. Est-ce que cela signifie qu’Harry Potter évite tout déterminisme ? La cérémonie du Choixpeau magique, qui envoie les élèves dans telle ou telle maison, pourrait laisser penser l’inverse, mais en réalité celui-ci s’appuie sur la volonté des élèves. Et la meilleure leçon de liberté, c’est celle qu’offre Sirius à Harry devant l’arbre généalogique des Black : effrayé de partager les mêmes traits familiaux que Voldemort, Harry s’entend répondre par son parrain que l’important n’est pas notre passé, pas plus que nos aptitudes, mais ce que l’on choisit d’en faire.
Dans Le Prisonnier d’Azkaban apparaît le personnage de Peter Pettigrow – en anglais, « grandir mesquin » – qui justifie sa trahison des parents d’Harry en plaidant le manque de courage et la situation de terreur imposée par Voldemort. C’est le type même du « salaud » proposé par Sartre, celui qui, plutôt que d’assumer son acte, se trouve des excuses. Harry, lui, ne va pas chercher à fuir, là où il aurait pu mille fois revêtir la cape d’invisibilité et quitter le pays. Non, il va choisir d’affronter Voldemort, non parce que la prophétie l’a annoncé, mais parce qu’il fait le choix d’endosser la responsabilité de cette lutte. Voldemort, lui, fait celui de croire à la prophétie qui lui annonce la naissance d’un enfant qui sera son ennemi, et ce faisant, il crée les conditions qui vont provoquer le transfert de ses pouvoirs à Harry bébé ! Il fait l’erreur de croire au destin plutôt qu’au libre arbitre. Finalement, il ne se choisit vraiment que lorsqu’il décide de se rebaptiser. Lui qui a pour deuxième prénom en anglais Riddle, l’« énigme », réagence les lettres de son nom pour devenir Voldemort, incarnant bien ce trait de la philosophie sartrienne selon lequel nous ne sommes rien sinon ce que nous choisissons d’être.
Nietzsche et la véritable force
Voldemort pourrait à tort faire songer à l’« homme fort » imaginé par Nietzsche, un être supérieur capable d’agir par-delà les valeurs morales. Mais la saga nous montre que la véritable puissance est ailleurs. Quand il l’affronte au ministère de la Magie, le Seigneur des Ténèbres hurle à Harry qu’il est faible, en lui rappelant ses blessures. Mais celles-ci ne sont que l’envers de ses joies, qui offrent à Harry les armes pour lutter. En réalité, nous ne sommes forts que de nos faiblesses, et l’amour reste cette arme ultime annoncée par la prophétie dont Voldemort, qui ne croit qu’à la force, est dépourvu. Éperdument amoureux de Lily Potter, Rogue trouve par exemple dans sa perte non un argument pour sombrer dans le mal, mais au contraire une source de salut.
La saga met ainsi en avant l’empathie comme valeur cardinale, non seulement dans une pure dimension morale, mais aussi comme moteur de l’action, de la désobéissance voire de la résistance. Hermione se lance dans la défense des elfes de maison, en pointant leur condition d’esclaves. Harry se fait le protecteur de Luna Lovegood ou de Neville Londubat. Et c’est par leur empathie, aussi, que les personnages parviennent à reconnaître le retour du Mal et osent s’élever contre un pouvoir oppresseur. En cela, Harry Potter est aussi une œuvre profondément politique. À la fin de La Coupe de feu, Dumbledore dit à Harry que viennent des temps difficiles où ils auront « tous à choisir entre le bien et la facilité ». Dans une époque comme la nôtre, je pense que de nombreux lecteurs de la saga peuvent y puiser espoir ainsi qu’élan et courage pour résister.
Apprendre à mourir
La question de la mort, et notamment de son expérience précoce, est essentielle dans Harry Potter. Le tout premier chapitre de la saga s’intitule « Le survivant », et chaque tome se conclura par une mort violente. Des personnages comme Mimi Geignarde ou Cedric Diggory vont être victimes de ces morts précoces. D’autres vont, eux, essayer de la repousser en refusant la finitude : les fantômes de Poudlard restent attachés au monde des vivants, Nicolas Flamel met au point la pierre philosophale qui permet d’étendre la vie, et même Dumbledore, le plus grand des sorciers, succombe pour avoir voulu revoir sa sœur Ariana en enfilant la bague des Gaunt qui contient la Pierre de Résurrection. Pourtant, Dumbledore lui-même était prévenu contre cette tentation : dans ses commentaires aux Contes de Beedle le Barde, il affirme que la quête d’invulnérabilité est propre aux hommes comme aux sorciers, mais qu’il faut accepter la douleur et la perte pour ne pas perdre son humanité.
C’est ce rapport à la mort qui, plus que tout, oppose
Voldemort et Harry. Voldemort ne cherche pas tant le pouvoir, dont il ne semble jamais vraiment se satisfaire, que la quête de l’immortalité. C’est pour cela qu’il crée ses Horcruxes, qui abritent des parties de son âme, et c’est ce qu’il affirme même aux Mangemorts quand il leur rappelle qu’il est allé « plus loin que quiconque sur le chemin de l’immortalité ». Harry, lui, au contraire va réussir à le vaincre parce qu’il aura accepté la perspective de mourir. « Tu es le vrai maître de la mort parce que, la mort, le vrai maître ne cherche pas à la fuir », lui dit Dumbledore. Le symbole du phénix est parlant de ce point de vue : il est moins synonyme d’éternité que du besoin qu’un cycle s’achève pour qu’un autre recommence. Si « philosopher, c’est apprendre à mourir », comme l’affirme Montaigne, alors Harry Potter apprend décidément à philosopher.
Conversation avec JULIEN BISSON
« En grandissant, le livre change avec le lecteur »
Corentin Faniel
Le coanimateur du site La Gazette des sorciers Corentin Faniel revient sur la naissance de l’œuvre, le développement de son univers, évoque ses thématiques et son impact sur ses lecteurs et au-delà.
Folklore et magie
Clémentine Beauvais
Le regard de Clémentine Beauvais, écrivaine et traductrice de L’Ickabog de Rowling, sur l’ancrage britannique de la saga et les défis liés à sa traduction.
Comment guérir de ses blessures d’enfance ?
Sophie Galabru
La philosophe Sophie Galabru se penche sur les différents modèles parentaux que proposent les romans et sur la façon dont l’œuvre de Rowling peut aider chacun à devenir un adulte plus heureux.