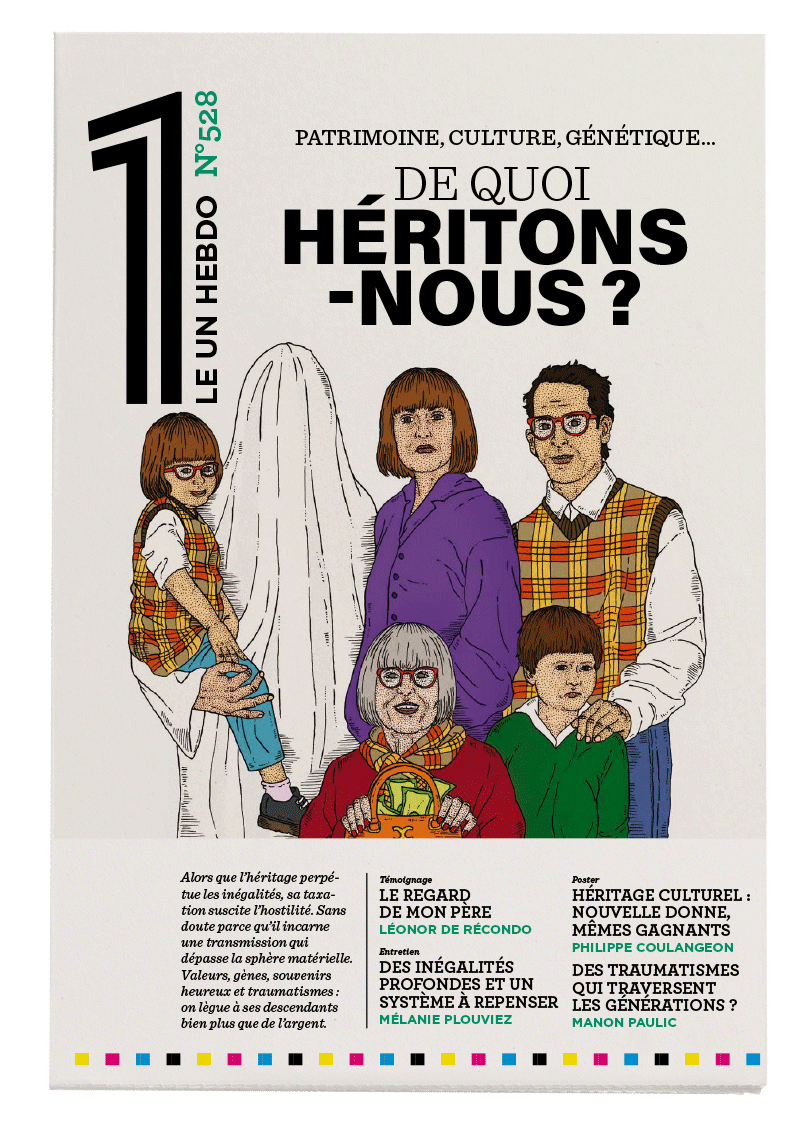Des partages sexistes ?
Temps de lecture : 4 minutes
Depuis plus de deux siècles en France, la succession est formellement égalitaire. À la mort d’un parent, chaque enfant est supposé recevoir une part égale de l’héritage : la réserve héréditaire. En théorie, tout du moins. Dans les faits, le partage des biens désavantage souvent les femmes.
J’ai mené des enquêtes de terrain dans des familles de viticulteurs de la région de Cognac. Dans toutes les familles qui disposaient d’un domaine, celui-ci était transmis dans son intégralité au fils, qui reprenait l’exploitation, tandis que les filles recevaient une somme d’argent équivalente. Les raisons déclarées de cette répartition ? « Ça ne les intéresse pas », « Elles n’ont pas les compétences »… On pourrait croire que cet exemple est isolé, spécifique à une profession conservatrice. Mais, au moment où je menais cette étude, ma collègue Sybille Gollac mettait en lumière des mécanismes similaires dans d’autres milieux sociaux et géographiques, et avec d’autres types de biens. Dans des familles urbaines et salariées, c’est par exemple le fils qui hérite le plus souvent du patrimoine immobilier, avec des justifications similaires – par exemple, les filles ne sauront pas gérer l’entretien. Même cas de figure pour les familles d’entrepreneurs, où le fils hérite de façon privilégiée de la firme ou des actions. Au travers de ces exemples, mais également en analysant les données de l’enquête Patrimoine de l’Insee, nous avons donc pu conclure que les « biens structurants », c’est-à-dire les biens qui constituent le cœur de l’héritage familial – entreprises, terres, immobilier, actions… – allaient le plus souvent aux fils, tandis que les filles étaient plus nombreuses à recevoir leur héritage uniquement en argent.
« Face à la nécessité pratique de transmettre le bien structurant, les familles n’hésitent pas à faire tout un tas d’arrangements de comptabilité »
Certes, on peut se demander en quoi le fait d’hériter de l’argent plutôt que des biens immobiliers ou professionnels serait désavantageux pour les femmes, si la valeur est supposée la même. C’est là que le bât blesse. Car, face à la nécessité pratique de transmettre le bien structurant, les familles n’hésitent pas à faire tout un tas d’arrangements de comptabilité, assistées en cela par des professionnels du droit. Les notaires, qui ont à cœur de garantir la « paix des familles » et de préserver l’intégrité du patrimoine, recourent le plus souvent à une forme de « comptabilité inversée » : au lieu d’inventorier le montant des biens et des finances du défunt puis de les diviser entre les enfants, ils partent du bien structurant, puis attribuent une somme équivalente aux autres enfants. Sauf que, dans un souci de baisser le montant de l’impôt et des droits de succession, ces biens sont souvent sous-évalués. Résultat : les compensations financières attribuées aux autres enfants, et en particulier aux filles, sont plus basses qu’elles ne devraient l’être. Mais, contester le partage de l’héritage, réclamer plus, s’opposer à ses frères et sœurs et contrevenir aux volontés d’un parent défunt étant extrêmement difficile, beaucoup acceptent la situation, « pour le bien de la famille ».
D’autres éléments entrent également en jeu : le fait, par exemple, que le bien structurant – l’entreprise, la maison de famille… – parvient souvent à l’héritier sous forme de donation, tandis que celles et ceux qui reçoivent l’héritage sous forme de compensation financière le perçoivent à la mort du parent, et en jouissent donc beaucoup plus tard dans leur vie.
Un autre facteur à prendre en compte est celui de l’inégalité salariale femmes-hommes. Les femmes ont souvent nettement moins d’argent que leur conjoint et ont plus de mal à racheter à leurs frères et sœurs les parts qui leur permettraient de récupérer la maison de famille ou des actifs. Leur conjoint, au contraire, peut prendre l’ascendant patrimonial dans le couple. Ainsi les inégalités économiques conjugales renforcent les inégalités en matière d’héritage et vice versa. Autant de facteurs qui contribuent à renforcer les inégalités économiques de genre sur le long terme, malgré un droit et une culture de la succession qui se veulent parfaitement égalitaires.
Conversation avec L.H.
« L’héritage familial ne va pas de soi »
Mélanie Plouviez
La philosophe Mélanie Plouviez plaide pour une grande remise à plat de notre système de transmission patrimonial. Revenant à ses origines révolutionnaires, elle montre comment les intentions égalitaires qui ont présidé à sa …
[Mystique]
Robert Solé
Le cinéma est friand de conflits successoraux qui donnent lieu à des empoignades homériques et finissent souvent dans le sang. Que de films nous auront montré des héritiers interloqués après l’ouverture d’un testament chez le notaire !
Que devons-nous à nos gènes ?
Ariane Giacobino
La scientifique Ariane Giacobino revient sur ce que les deux dernières décennies de recherches en génétique et en épigénétique nous ont appris sur la transmission héréditaire, tout en insistant sur le rôle primordial de l’en…