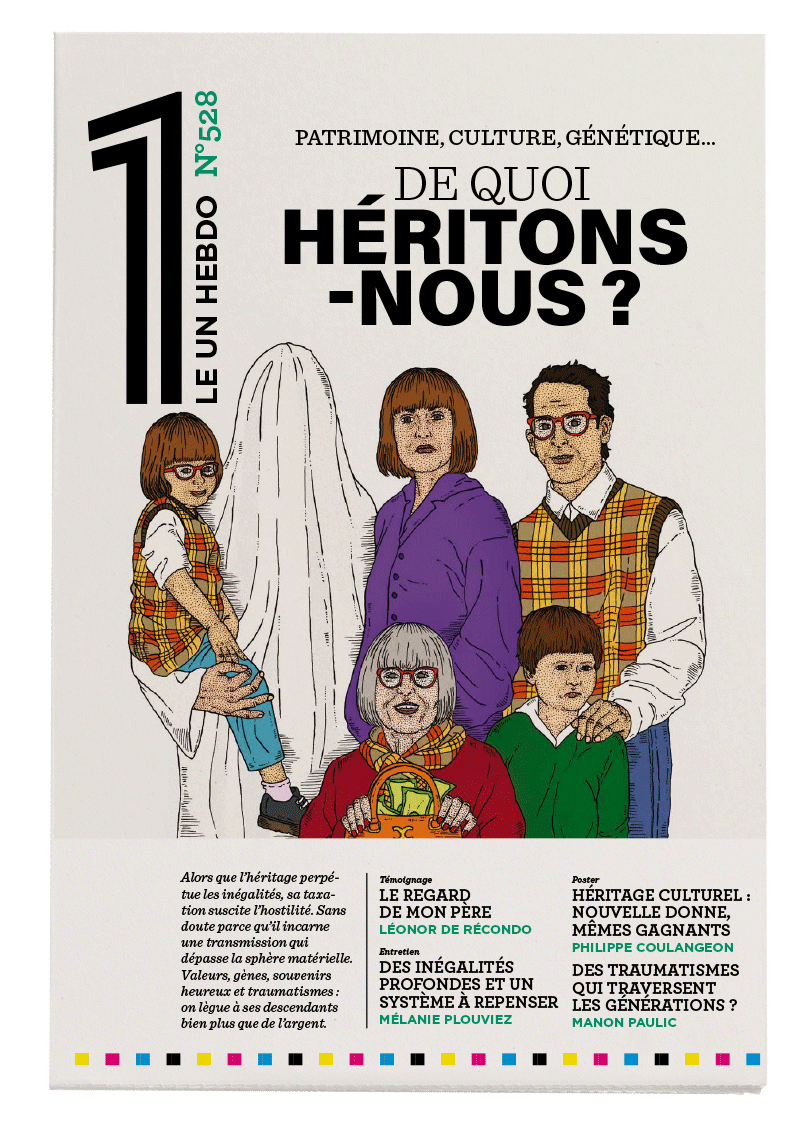« L’héritage familial ne va pas de soi »
Temps de lecture : 9 minutes
Depuis quand hérite-t-on ?
La question s’est toujours posée de savoir ce qui devait advenir des biens des individus à leur mort. Mais les destinataires de l’héritage, comme les formes de la transmission, ont beaucoup varié dans le temps et dans l’espace. Quant à la question de savoir de quand date, en France, notre manière contemporaine de transmettre, il est possible d’y répondre précisément : de la Révolution française, et plus particulièrement de la loi du 6 janvier 1794, dite loi de nivôse. Elle instaure un système successoral bien spécifique. Première caractéristique : l’essentiel du patrimoine parental est « réservé » à leurs enfants (c’est ce que l’on appelle la réserve héréditaire) et partagé à égalité entre eux (ce que l’on appelle le partage égal). Les parents français ne peuvent pas déshériter leurs enfants. Ils ne peuvent pas non plus donner la totalité de leur patrimoine à l’un d’eux au détriment des autres. Seconde caractéristique : les parents ne peuvent décider librement par testament du devenir de leur bien (ce que l’on nomme la liberté testamentaire) que pour une portion restreinte de leur patrimoine déterminée par la loi (part appelée « quotité disponible »). Tous les systèmes successoraux ne sont pas régis par de tels principes. Par exemple, aux États-Unis, les parents peuvent déshériter leurs enfants. Ils peuvent favoriser l’un au détriment des autres. Ils peuvent léguer par testament la quasi-totalité de leur patrimoine à un tiers, à une association caritative ou même à leur animal domestique.
Pourquoi l’instauration d’un droit de succession était-elle un enjeu pour les révolutionnaires ?
Avant la Révolution française, les manières de transmettre étaient très variables à l’échelle du royaume de France. D’abord, en fonction du statut des personnes et des biens. On ne transmettait pas de la même manière selon que l’on était noble ou roturier. Ainsi, la transmission des biens au fils aîné au détriment des cadets et des sœurs concernait surtout les successions nobles. La primogéniture masculine était un instrument permettant la concentration et le renforcement différentiel des richesses de la noblesse. Ensuite, en fonction de la localité. Comme le dénoncent les législateurs révolutionnaires, il y avait sous l’Ancien Régime autant de pratiques successorales que de localités. C’est à une telle bigarrure que les législateurs révolutionnaires mettent fin en proposant, avec la loi de nivôse, une seule et même loi successorale pour tout le territoire français.
« "Être citoyens d’un même pays, c’est être tous identiquement soumis à une même loi" »
Les législateurs révolutionnaires ne cessent en effet de le marteler : être citoyens d’un même pays, c’est être tous identiquement soumis à une même loi, que l’on soit d’une famille d’ancienne noblesse ou paysanne, que l’on soit riche ou pauvre. Il n’est sans doute pas inutile de rappeler ce premier enjeu à l’heure où, par exemple, la loi fiscale prévoit des exonérations pour la transmission de types de biens détenus par les franges les plus aisées de la population, comme les œuvres d’art, les monuments historiques ou les sociétés collectives immobilières.
Et sur le plan social ?
Avec la loi de nivôse, les législateurs révolutionnaires construisent un nouveau modèle familial qu’ils opposent à la famille d’Ancien Régime. La famille d’Ancien Régime, celle qu’Alexis de Tocqueville appelle la famille aristocratique, était hiérarchique et inégalitaire, structurée autour de la puissance maritale de l’époux sur l’épouse et de la puissance paternelle du père sur ses enfants. Le pouvoir que le père avait de disposer librement par testament de ses biens, en favorisant l’un ou en déshéritant l’autre, était un instrument de cette puissance parentale. En imposant par la loi le partage égal, en réduisant à la portion congrue la liberté testamentaire, les législateurs révolutionnaires restreignent le pouvoir des pères et confèrent des droits égaux aux enfants nés de mêmes parents. Tocqueville qualifiera, à juste titre, ce nouveau modèle familial de famille démocratique.
Mais il y a aussi un enjeu social que nous avons plus de mal à cerner aujourd’hui. Avec la loi de nivôse, les législateurs révolutionnaires entendent travailler à une société plus juste au sein de laquelle les écarts de fortune se trouveraient réduits. Ils estiment que l’instauration de l’égalité successorale au sein de la famille devrait permettre de réduire les inégalités entre les familles. Un raisonnement assez contre-intuitif aujourd’hui, tant le droit successoral nous semble plutôt renforcer les inégalités sociales.
Que reste-t-il de ce système ?
Nous avons conservé, dans ses grandes lignes, l’architecture successorale mise en place par la Révolution française. Notre conception de l’égalité successorale est cependant bien moins exigeante que celle des révolutionnaires. D’une part, la quotité disponible a été progressivement étendue : en 1794, les parents ne pouvaient disposer librement par testament que d’un neuvième de leur patrimoine ; aujourd’hui, ils disposent de la moitié dans le cas d’une succession avec un enfant, et du tiers lorsqu’il y a deux enfants. D’autre part, la loi de nivôse interdisait que cette quotité disponible puisse aller à l’un des enfants. Aujourd’hui, un héritier peut aussi être le destinataire du testament parental. On s’est éloigné de l’égalité parfaite défendue par les législateurs révolutionnaires, ce qui n’est pas sans effets, en particulier sur la distribution genrée du patrimoine.
On parle aujourd’hui d’un « retour à l’héritage ». Que faut-il entendre par là ?
C’est l’économiste Thomas Piketty qui a façonné cette expression. Dans Le Capital au xxie siècle, paru en 2013, il a montré que le fait d’hériter retrouvait aujourd’hui un poids comparable à celui qu’il avait au xixe siècle. Qu’est-ce que cela veut dire concrètement ? Il y a deux manières de se constituer un patrimoine : soit vous travaillez et vous épargnez progressivement une partie des revenus de votre travail, soit vous héritez. Dans la société française du xixe siècle, qu’illustrent magistralement les romans de Balzac, les plus hautes positions patrimoniales étaient inatteignables par le seul travail. Pour s’y élever, mieux valait hériter que travailler. Pour les générations nées au xxe siècle, dans l’entre-deux-guerres, le travail et l’épargne ont permis au contraire de cumuler un capital important. Notre société contemporaine ressemble plus à la société du xixe siècle qu’à celle des années 1950-1970 en ce qu’il est de plus en plus difficile de se constituer un patrimoine par les seuls revenus du travail.
« L’enjeu de l’héritage retrouve aujourd’hui un poids comparable à celui qu’il avait au xixe siècle »
Cela pose un problème de justice sociale. Est-il juste que la distribution des richesses se fasse selon le critère arbitraire de la famille dans laquelle on naît ? L’échelle des salaires reflète, de manière certes bien imparfaite, celle des mérites et des efforts personnels : niveau de diplôme, qualités individuelles, engagement dans le travail, etc. Mais quel mérite propre fonde le fait d’être né dans une famille qui a du patrimoine à transmettre ? Ce sont ces inégalités sans fondement personnel qui sont reparties à la hausse depuis les années 1970.
Mais la nature du patrimoine transmis n’a-t-elle pas changé ?
Si, bien sûr. Le capital, qui était essentiellement terrien au xixe siècle, s’est financiarisé et mondialisé. Il est d’ailleurs primordial de s’intéresser à la composition du capital et à ses transformations. Quand on en reste à un niveau aggloméré, le diagnostic est celui d’une baisse globale des inégalités patrimoniales. En 1910, les 10 % les plus riches détenaient 90 % du patrimoine total ; les 1 % les plus riches, 60 % du patrimoine total. En 2010, les 10 % les plus riches ne détenaient « plus que » 62 % du patrimoine total ; les 1 % n’en possédaient « plus que » 25 %. Mais, quand on resserre la focale sur certains types d’actifs, on retrouve des niveaux d’inégalités comparables à ceux du xixe siècle. Ainsi, en 2010, les 10 % les plus riches détenaient 70 à 80 % des actifs financiers (actions, obligations, assurances-vie) et des actifs professionnels (entreprises).
Quel impact aura le vieillissement de la population ?
Il a déjà transformé l’héritage en profondeur. Dans les années 1820, on héritait en moyenne à 25 ans. Aujourd’hui, on hérite en pleine propriété (c’est-à-dire à la mort des deux parents) vers 60 ans. Pour le dire simplement, les héritages vont aujourd’hui de personnes très âgées vers des personnes âgées. Or on n’utilise pas à 60 ans le capital de la même manière qu’à 25 ans. L’économiste André Masson parle à ce sujet d’une « crispation patrimoniale » : les seniors sont riches d’une épargne privée qui « dort » dans des investissements peu risqués et de court terme, au détriment des besoins économiques des jeunes générations et des générations à venir. Là encore, cela pose un problème de justice sociale, cette fois-ci intergénérationnelle.
Malgré les inégalités engendrées par l’héritage, les Français sont majoritairement défavorables à l’impôt sur les successions. Comment l’expliquer ?
C’est en effet l’impôt le plus détesté par les Français. C’est aussi le plus méconnu. Il est d’ailleurs systématiquement surévalué. Il faut savoir que ce que paient effectivement les Français comme taux d’imposition successorale est en moyenne de moins de 5 % – et même de moins de 2 % quand on ne prend en compte que les successions en ligne directe. On est très loin du taux souvent fantasmé de 45 % !
« On présente souvent cette aversion fiscale des classes populaires comme une énigme »
Encore plus étonnant : plusieurs études sociologiques ont montré que l’aversion à l’égard de la fiscalité successorale est forte parmi les franges les moins favorisées de la population. En d’autres termes, ceux-là mêmes qui ont peu à transmettre, qui n’ont donc pas à payer d’impôt successoral en raison de l’abattement sur les 100 000 premiers euros transmis et qui pourraient au contraire bénéficier des effets redistributifs d’une fiscalité successorale fortement progressive y sont hostiles. On présente souvent cette aversion fiscale des classes populaires comme une énigme. J’y vois la manifestation de nos essentialisations en matière d’héritage. Quand bien même nous y aurions intérêt, nous ne parvenons pas à interroger et à critiquer la transmission du patrimoine. L’héritage familial va pour nous de soi.
Comment faire pour lever ce tabou ?
Il n’est jamais évident de suspendre nos évidences, mais l’histoire des idées peut nous y aider. C’est l’exercice auquel je me suis livrée dans L’Injustice en héritage, en confrontant nos manières de penser ou de ne pas penser l’héritage aux nombreuses et riches théories formulées au xixe siècle. L’un des traits les plus surprenants de ce corpus réside dans l’élargissement des destinataires possibles de l’héritage. Certains auteurs, comme les législateurs révolutionnaires, élargissent le cercle des parents. D’autres suggèrent de manière provocatrice que les héritages soient tirés au sort. D’autres encore proposent qu’ils soient redistribués de manière égalitaire sous la forme d’une dotation en capital égale pour tout jeune adulte. On trouve même des projets qui visent à faire de l’État, des communes, d’une banque publique d’investissement ou encore des syndicats le cohéritier partiel ou l’héritier unique des biens du défunt. Ces différentes propositions ont une force déstabilisatrice. Les réticences qu’elles rencontrent sont en tout cas le signe qu’elles interrogent une idée admise comme évidente en matière successorale : à savoir que l’héritage doit nécessairement aller à la famille.
Conversation avec LOU HÉLIOT
« L’héritage familial ne va pas de soi »
Mélanie Plouviez
La philosophe Mélanie Plouviez plaide pour une grande remise à plat de notre système de transmission patrimonial. Revenant à ses origines révolutionnaires, elle montre comment les intentions égalitaires qui ont présidé à sa …
[Mystique]
Robert Solé
Le cinéma est friand de conflits successoraux qui donnent lieu à des empoignades homériques et finissent souvent dans le sang. Que de films nous auront montré des héritiers interloqués après l’ouverture d’un testament chez le notaire !
Que devons-nous à nos gènes ?
Ariane Giacobino
La scientifique Ariane Giacobino revient sur ce que les deux dernières décennies de recherches en génétique et en épigénétique nous ont appris sur la transmission héréditaire, tout en insistant sur le rôle primordial de l’en…