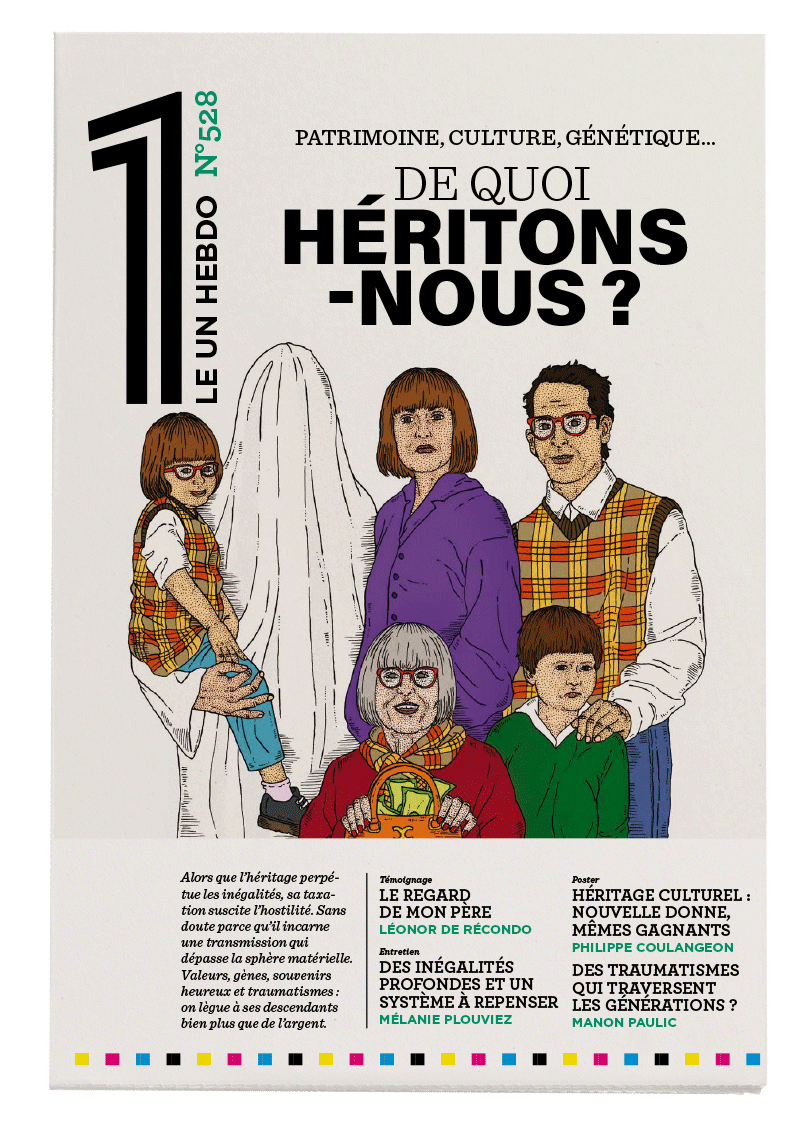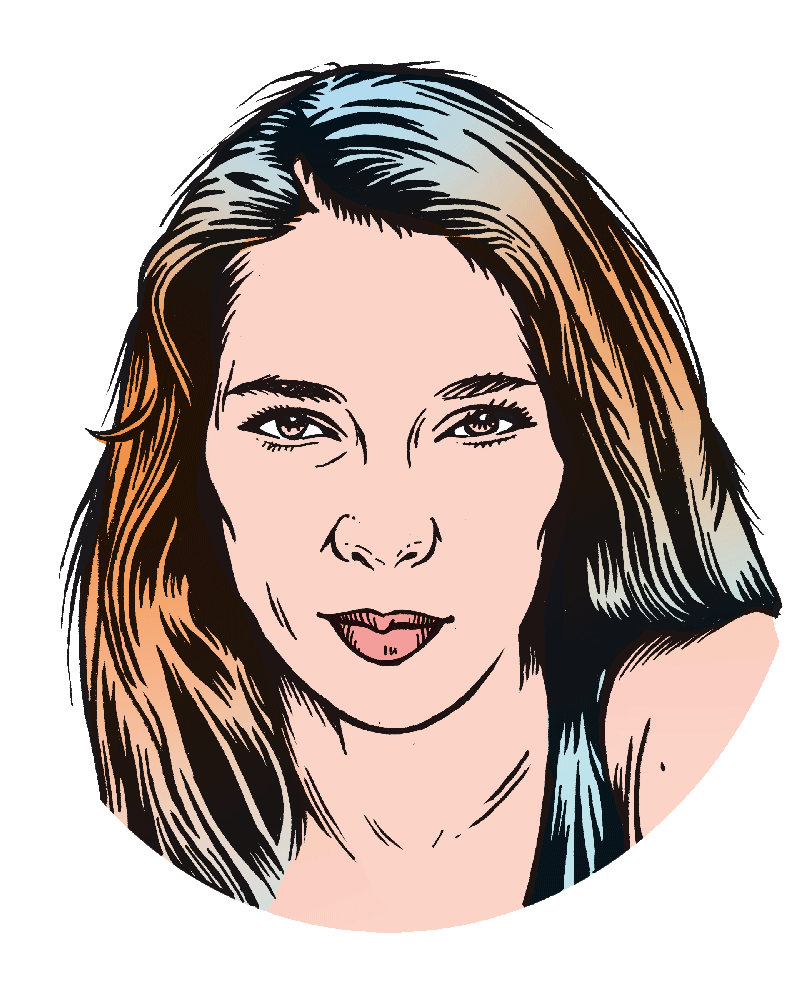Œil pour œil
Temps de lecture : 4 minutes
L’histoire de l’œil commence dans un cinéma, du moins c’est le souvenir que j’en ai. Une séance pendant les années quatre-vingt au Champollion, à Paris. Une rétrospective des films de Buster Keaton. Il y aura plusieurs séances similaires, plusieurs de ces grands moments de joie. Nous y allons en famille. J’ai quatre ou cinq ans. Je suis à côté de mon père, parfois debout tant je suis excitée et hilare de ce que je visionne. Mon père aussi. Nous partageons ce rire fou, ce regard vers l’écran, l’euphorie commune, toute la rangée rigole. Les fauteuils sont secoués. La musique du film est couverte par les grincements des sièges et par les rires qui fusent, communicatifs. Je me souviens que ce qui me rendait si heureuse, c’était évidemment de regarder ce film, mais surtout la complicité que je nouais avec mon père dans ce rire commun. Les générations s’effaçaient, son âge et le mien, nous riions de la même manière, comme deux gamins. Lui revenait à l’insouciance de sa jeunesse grâce au génie de Keaton et moi je gloussais de le voir soudain si jeune.
L’histoire de l’œil a continué.
Quand on est peintre, le regard est un outil crucial. Je voyais mon père reculer, avancer devant ses toiles, plisser les yeux, vérifier sur son esquisse si le trait définitif était juste, la bonne place, la bonne proportion. Je voulais faire comme lui. Dans l’atelier, j’avais une petite table qu’il m’avait fabriquée à ma hauteur avec trois planches, une horizontale et deux verticales. Il allait chercher un catalogue d’exposition dans la bibliothèque, plutôt des dessins anciens que de l’art abstrait, et il en choisissait un. Page ouverte devant moi. Il s’accroupissait et nous regardions ensemble.
Exerce ton œil en recopiant, me disait-il.
J’avais un crayon et une gomme, comme lui. Deux outils simples. Je pouvais me tromper et recommencer. Il me faisait observer les proportions, les lignes qui pouvaient découper un visage ou un paysage, le même quadrillage qu’il utilisait. La première leçon de dessin, c’est d’apprendre à regarder.
Je le regardais regarder, il me regardait regarder
J’ai compris en grandissant que dessiner ne m’intéressait pas vraiment, peut-être parce que c’était son espace à lui, qu’il fallait que j’aie le mien. Par contre, ce qu’il me transmettait et qui m’a aidée à grandir, à m’élever, c’était l’apprentissage du regard. Nous sommes très souvent allés au musée ensemble. C’était pour lui une source d’inspiration et il considérait, à juste titre, que nous devions partager la beauté. L’observer, en parler, voir comment elle nous traversait. Ce qui pouvait nous émouvoir ou pas.
J’ai le souvenir d’avoir de nombreuses fois arpenté les salles du musée du Louvre avec lui. Quelques stations de métro et nous y étions. Il s’émerveillait chaque fois de cette proximité avec autant de chefs-d’œuvre. Et nous observions, nous examinions, nous prenions le temps d’admirer une perspective, une carnation, un plissé. Je me souviens que nos yeux dirigés dans la même direction, avec une unité de lieu et de temps, nous réunissaient dans un sentiment partagé à la fois chaleureux et singulier. Je le regardais regarder, il me regardait regarder. J’apprenais de lui, et il s’attendrissait de mes commentaires ingénus.
Tout est voué à disparaître, les êtres et leurs souvenirs.
Aujourd’hui, c’est ce qui me manque le plus. Son regard sur la vie, les choses, les œuvres, son appétit pour la beauté, sa capacité à continuer de s’émerveiller. Je pourrais écrire, dix ans après sa mort, que c’est sa voix, nos échanges, sa présence, qui me manquent, mais non, plus que tout, c’est son regard. Comme il envisageait les autres, son art, la vie, les épreuves, tout ce qui l’avait traversé pendant son existence et qui donnait du poids à son jugement, à ses yeux.
Quand je suis entrée dans sa chambre d’hôpital, ils étaient déjà fermés. Je n’ai pas plongé les miens dans les siens une dernière fois. Ses paupières étaient closes. Je lui ai parlé à l’oreille et je l’ai beaucoup observé. Je savais que c’était la dernière fois et je voulais que ma mémoire reste vive. Dix ans plus tard, j’ai oublié beaucoup de détails. Je m’en veux et je sais que je n’y peux rien. Tout est voué à disparaître, les êtres et leurs souvenirs. Mais ce qui m’accompagne et ce que je peux ressentir encore, c’est sa présence lorsque je regarde un tableau. Je continue d’aller dans les musées avec lui. Nous avons quelques toiles fétiches. Et si les autres visiteurs ignorent sa présence, j’éprouve aujourd’hui encore la famille de regards que nous formions.
Très tôt, je suis allée avec mon fils voir des tableaux. Nous cheminons dans les mêmes salles de musée. Je le fais entrer dans la ronde, je lui explique comme on l’a fait pour moi. Je lui transmets ce qu’on m’a transmis. Une sensibilité à la beauté qui souvent nous sauve de l’aveuglement.
Les paupières peuvent clore une vie entière, mais les regards continuent de nous accompagner tout au long de nos existences.
« L’héritage familial ne va pas de soi »
Mélanie Plouviez
La philosophe Mélanie Plouviez plaide pour une grande remise à plat de notre système de transmission patrimonial. Revenant à ses origines révolutionnaires, elle montre comment les intentions égalitaires qui ont présidé à sa …
[Mystique]
Robert Solé
Le cinéma est friand de conflits successoraux qui donnent lieu à des empoignades homériques et finissent souvent dans le sang. Que de films nous auront montré des héritiers interloqués après l’ouverture d’un testament chez le notaire !
Que devons-nous à nos gènes ?
Ariane Giacobino
La scientifique Ariane Giacobino revient sur ce que les deux dernières décennies de recherches en génétique et en épigénétique nous ont appris sur la transmission héréditaire, tout en insistant sur le rôle primordial de l’en…