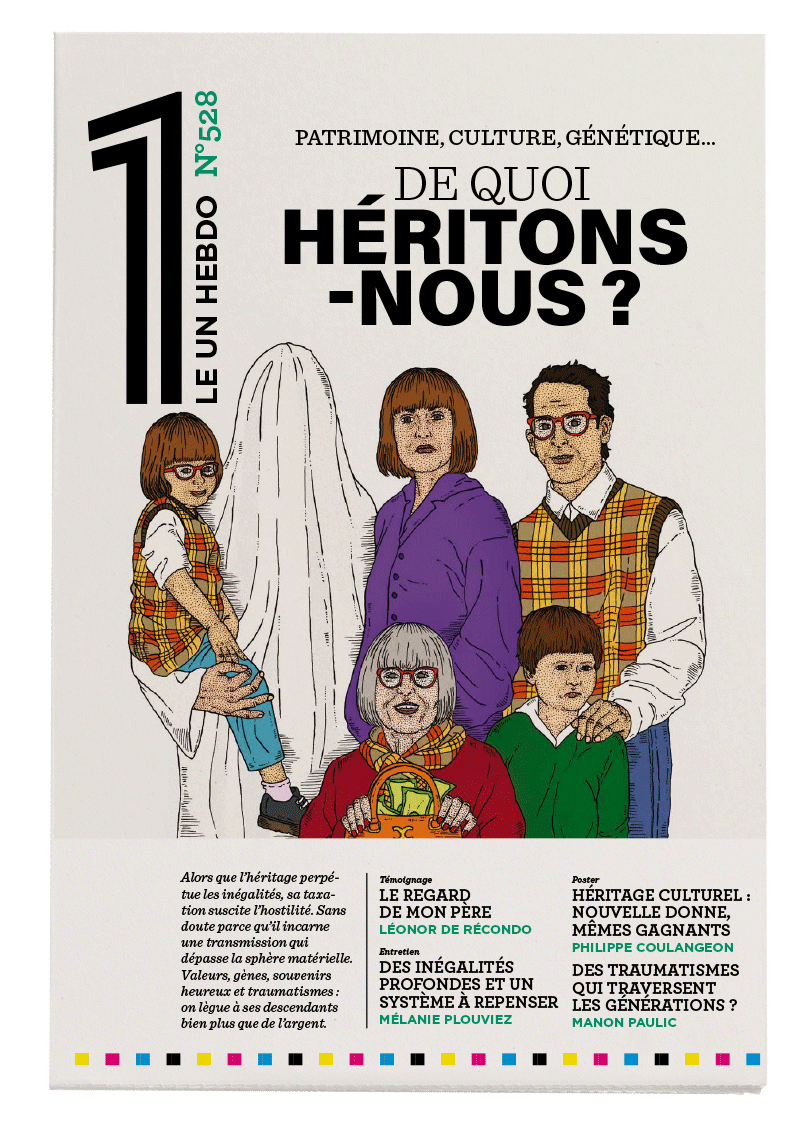Que devons-nous à nos gènes ?
Temps de lecture : 7 minutes
De quoi hérite-t-on génétiquement ?
Nous héritons d’un demi-patrimoine génétique paternel et d’un demi-patrimoine génétique maternel, c’est-à-dire de deux fois 22 000 gènes (l’être humain contient environ 22 000 gènes) sans compter les mitochondries (un petit génome de 37 gènes provenant du côté maternel, qui fonctionne comme un lieu de respiration cellulaire). Ce patrimoine génétique constitue ainsi le substrat de l’hérédité, qui donne ensuite toutes les informations pour le développement embryonnaire, la formation des organes, le fonctionnement courant de l’organisme. Cela signifie, en somme, que l’on hérite d’un processus de fabrication, d’une partition de musique, avec ses imperfections.
Les gènes hérités de nos parents sont-ils à l’origine de nos comportements et de nos traits de caractère ?
Pas vraiment, non. Lorsque l’on dit par exemple : « Tu es colérique, tu tiens ça de ton père », ce n’est pas complètement vrai. Les traits de caractère peuvent être légèrement liés à la neurotransmission, mais ils sont en grande partie liés à l’environnement dans lequel évolue l’individu, à son éducation, à ce à quoi il est exposé… Des études sur les jumeaux monozygotes, autrement dit des jumeaux qui proviennent de la division d’un œuf fécondé unique, ont démontré que si l’un des deux enfants est élevé dans un autre milieu familial, la concordance de leurs traits de caractère est très faible. Nous savons aussi que les maladies psychiatriques, comme la schizophrénie, ou bien certains troubles du neurodéveloppement, comme l’autisme, sont pour une part liés à de multiples variations génétiques, mais ils sont d’autre part grandement influencés par l’environnement.
« On ne naît pas sportif d’élite ou Prix Nobel, on le devient ! »
Au-delà du comportement, nos facultés cognitives et physiques sont-elles liées à la génétique ?
Les capacités physiques proviennent dans une certaine mesure de nos gènes, mais tout autant de l’entraînement, de l’exercice. Les compétences cognitives aussi résultent en partie de nos gènes, mais bien plus encore de l’environnement dans lequel on s’est développé, avec entre autres les apprentissages, la mémorisation. On ne naît pas sportif d’élite ou Prix Nobel, on le devient !
Qu’en est-il des maladies génétiques ?
Ce sont des pathologies dues à des anomalies des gènes ou des chromosomes. Elles sont transmises de diverses manières : elles sont soit dominantes, soit récessives. Pour la transmission dominante, il faut recevoir d’un de ses parents une mutation pour avoir la maladie – celle de Huntington, par exemple. On parle de transmission récessive notamment dans le cas où, si deux parents porteurs sains font des enfants, chacun d’entre eux aura une chance sur quatre de développer la maladie. Aujourd’hui, on dénombre environ 6 000 maladies génétiques, mais on n’en connaît bien que 5 000. Ces pathologies, appelées « monogéniques », résultent de la présence d’une mutation dans un seul gène. C’est notamment le cas de la mucoviscidose ou de la polykystose rénale.
Les maladies qui nous touchent sont-elles systématiquement héritées ?
Non, elles sont parfois associées à des facteurs environnementaux. Les pathologies génétiques les plus fréquentes et celles qui sont les plus coûteuses sont les maladies polygéniques, c’est-à-dire favorisées par de très nombreuses variations communes à certains gènes, en association avec des facteurs environnementaux. On peut penser à l’hypertension, au diabète, à l’obésité, à la plupart des cancers… Le premier séquençage du génome humain, réalisé en 2003, a permis de déterminer la séquence nucléotidique de l’ADN, c’est-à-dire les différents maillons de l’ADN présent dans chaque cellule d’un organisme donné. Mais cela n’a pas diamétralement changé le traitement par la médecine des maladies courantes. Depuis, de nombreuses études en épigénétique ont démontré l’importance de certains facteurs environnementaux dans la construction génétique des individus.
« On n’est pas "héritier d’un traumatisme" : on hérite d’une marque chimique sur un gène »
Qu’est-ce que l’épigénétique ?
C’est la modification chimique réversible du génome lié à l’environnement. Ces modifications peuvent apparaître et disparaître, mais des expériences sur la souris puis des analyses chez l’être humain ont montré qu’elles pouvaient, exceptionnellement, se transmettre à d’autres générations. L’épigénome est en principe nettoyé entre les générations, mais ce n’est pas toujours le cas.
C’est-à-dire ?
Certaines marques liées à des traumatismes semblent justement échapper à ce nettoyage, à cette reprogrammation entre les générations : la génération suivante hériterait donc d’une vulnérabilité plus grande. Mais on n’est pas « héritier d’un traumatisme » : on hérite d’une marque chimique sur un gène, une fragilité qui, selon de nouveaux facteurs, apparaîtra plus ou moins. Un individu ayant subi un traumatisme pourra en conserver des traces épigénétiques dont la manifestation sera, par exemple, un seuil plus faible de vulnérabilité au stress ou des symptômes d’anxiété.
Le stress modifierait donc l’expression de nos gènes ?
Par la machinerie cellulaire, le stress peut venir ajouter des groupements chimiques méthyles (CH3) sur un gène ou en enlever. Le gène fabriquera alors plus ou moins de protéine. Des recherches, auxquelles j’ai participé, ont démontré que le stress pouvait modifier la méthylation du gène du récepteur des glucocorticoïdes, une protéine et, par conséquent, la voie de signalisation du cortisol, l’hormone du stress.
Quelles ont été les études déterminantes en épigénétique ? Qu’ont-elles prouvé ?
La plupart d’entre elles sont récentes : ces recherches ont débuté dans les années 2000 et se sont développées plus largement au cours de la dernière décennie. J’ai notamment fait des études sur des patients souffrant de troubles psychiatriques, qui avaient tous subi des maltraitances et des abus sexuels enfants, et sur des individus n’en ayant pas vécu. Les analyses qui consistaient à rechercher des marques chimiques épigénétiques chez ces individus se sont avérées très intéressantes : on trouvait des marques sur ceux qui avaient été victimes de maltraitance et pas chez les autres, et l’intensité de ces marques était plus importante chez les individus ayant été durablement maltraités. C’était l’une des premières fois où l’on prouvait scientifiquement qu’un événement traumatique vécu trois décennies plus tôt pouvait affecter le fonctionnement d’un ou de plusieurs gènes, y laissant une trace biologique. Mais, attention, il ne s’agit pas d’un déterminisme absolu : parmi les individus maltraités, certains ne présentaient pas de marque épigénétique.
« Toutes les modifications épigénétiques ne doivent pas être considérées comme néfastes : elles permettent aussi à l’individu de s’adapter à l’environnement. »
Comment ces marques disparaissent-elles ?
Des études sur les personnes déployées sur des fronts de guerre ayant manifesté des symptômes de stress post-traumatiques liés à l’exposition à un conflit armé, ont montré que la psychothérapie avait permis de faire disparaître des marques épigénétiques – ce qui est mystérieux du point de vue chimique – dans des gènes liés à la neurotransmission, au fonctionnement cérébral, au stress… D’autres études ont démontré qu’une souris ayant été mal maternée par sa mère et ayant de ce fait développé une hyperréactivité au stress, va voir ces marques épigénétiques liées au stress disparaître si on la fait adopter assez tôt par une mère maternante. Attention, toutefois, toutes les modifications épigénétiques ne doivent pas être considérées comme néfastes : elles permettent aussi à l’individu de s’adapter à l’environnement. Par exemple, des modifications épigénétiques induites par la pratique intensive du sport peuvent permettre au muscle de s’habituer à l’effort auquel le corps est soumis et de mieux y réagir.
Qu’est-ce que la mémoire cellulaire, cette théorie selon laquelle les souvenirs et les goûts pourraient être stockés dans toutes les cellules de notre corps ? Qu’en penser ?
Si la mémoire cellulaire fait allusion au fait de « revivre » un événement traumatique, ce n’est pas correct, me semble-t-il. En épigénétique, ce ne sont pas des souvenirs qui sont transmis génétiquement, mais des ambiances chimiques, des modifications de la neurotransmission… Cela n’a rien à voir avec un événement que l’on pourrait revivre par l’imagination. Il n’est pas possible qu’un gène contienne autre chose que sa chimie pour exister et voyager à travers les générations. L’épigénétique, elle, modifie la quantité de protéine, mais pas des choses oniriques. Sans oublier qu’entre les générations, il y a une reprogrammation et un effacement de la majorité des marques épigénétiques. Il n’est pas possible d’hériter de toutes les marques épigénétiques de nos ancêtres, nos gènes seraient alors complètement déterminés dans leur fonctionnement.
Qu’attend-on des dernières recherches en génétique et en épigénétique ?
Le développement des thérapies géniques, la possibilité de guérir ces 6 000 maladies génétiques dont je parlais. L’utilisation, aussi, des recherches en épigénétique à des fins de santé publique : des millions de personnes dans le monde sont exposées à des événements traumatiques et peuvent donc développer des modifications épigénétiques. Nous nous devons de ne pas fabriquer des générations de personnes ultra-vulnérables.
Propos recueillis par EMMA FLACARD
« L’héritage familial ne va pas de soi »
Mélanie Plouviez
La philosophe Mélanie Plouviez plaide pour une grande remise à plat de notre système de transmission patrimonial. Revenant à ses origines révolutionnaires, elle montre comment les intentions égalitaires qui ont présidé à sa …
[Mystique]
Robert Solé
Le cinéma est friand de conflits successoraux qui donnent lieu à des empoignades homériques et finissent souvent dans le sang. Que de films nous auront montré des héritiers interloqués après l’ouverture d’un testament chez le notaire !
Que devons-nous à nos gènes ?
Ariane Giacobino
La scientifique Ariane Giacobino revient sur ce que les deux dernières décennies de recherches en génétique et en épigénétique nous ont appris sur la transmission héréditaire, tout en insistant sur le rôle primordial de l’en…