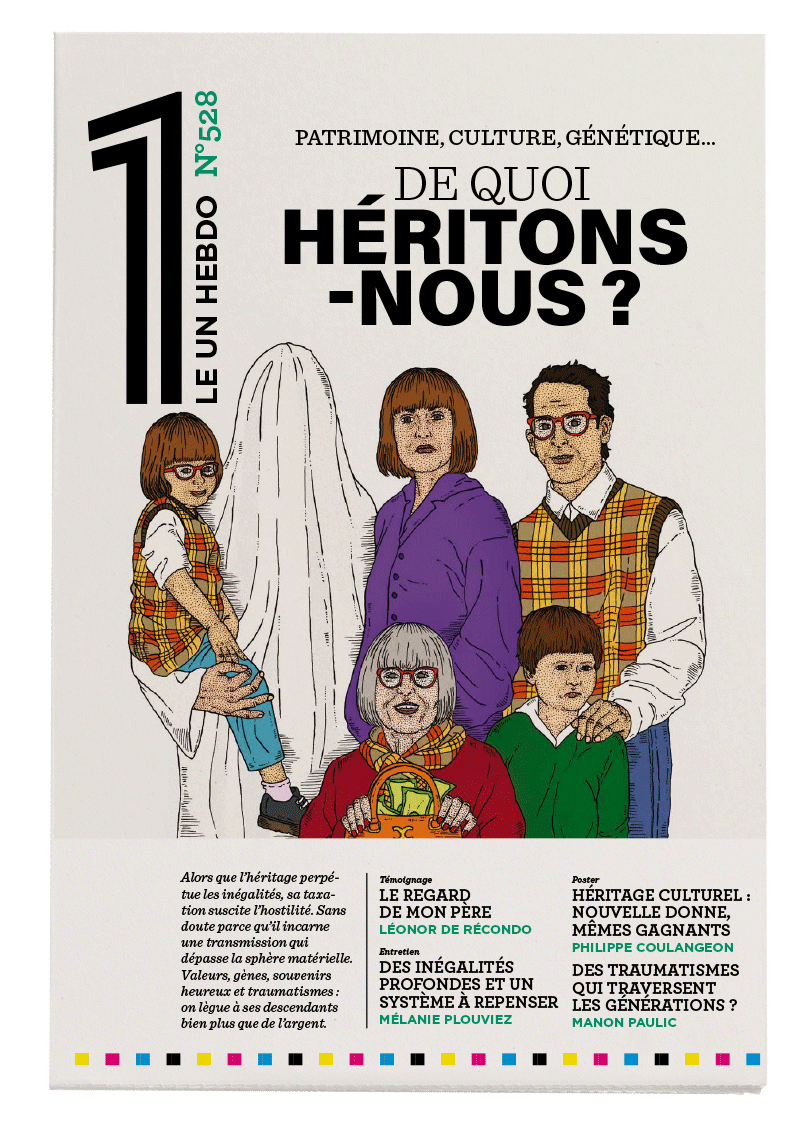Des traumatismes ancestraux ?
Temps de lecture : 9 minutes
Secrets de famille, incestes, suicides, abandons d’enfant… Les traumatismes de nos ancêtres peuvent-ils laisser une trace en nous et, le cas échéant, influencer nos vies ? Depuis la parution du best-seller Aïe, mes aïeux (Desclée de Brouwer, 1993), écrit par la psychogénéalogiste Anne Ancelin Schützenberger, l’idée s’est imposée dans les cercles de thérapie alternative. En 2019, 38 % des Français croyaient en la transmission des traumatismes d’une génération à l’autre. D’aucuns se sont mis à attribuer une peur bleue de l’océan au traumatisme d’un ancêtre ayant échappé à la noyade, ou bien une douleur chronique à l’épaule à celui d’un arrière-grand-parent touché d’une balle pendant la Seconde Guerre mondiale. Bien que la recherche scientifique des dernières décennies – notamment en épigénétique – tende à confirmer que certains traumatismes peuvent se transmettre d’une génération à l’autre, la communauté scientifique reste très prudente sur les modalités de cette transmission. Elle précise qu’à ce stade les hypothèses sont plus nombreuses que les certitudes.
Serge Tisseron, pionnier dans l’analyse de l’impact des secrets de famille, distingue deux types de transmission : l’intergénérationnelle – à savoir entre deux générations en contact l’une avec l’autre – et la transgénérationnelle – d’un individu à un descendant qu’il n’a pas connu. « La première est une certitude, de nombreux travaux le démontrent, mais la seconde, plus difficile à prouver scientifiquement, reste une hypothèse », explique le psychiatre, qui dénonce le manque de sérieux de la psychogénéalogie, discipline qui, plutôt que de partir des expériences personnelles d’un individu pour expliquer ses angoisses, cherche directement dans la généalogie, remontant à l’infini dans l’arbre familial.
Une transmission directe avérée
La transmission intergénérationnelle, selon Serge Tisseron, repose sur trois critères : l’imitation motrice, l’imitation émotionnelle et l’attention conjointe. Par exemple, « une mère en train de langer son bébé voit passer un avion par la fenêtre. Celui-ci lui rappelle la perte de son frère dans un crash des années plus tôt. Très traumatisée, elle n’en a jamais parlé. Le bébé, qui observe tout, voit sa mère s’attrister et imite sa mimique (imitation motrice). Il se met alors à ressentir, par cette mimique, sa tristesse (imitation émotionnelle). Et si l’expérience se répète, l’enfant associe l’avion au sentiment de tristesse, bien qu’il n’ait aucune raison de le faire (attention conjointe). » À partir de là, il peut développer une phobie des avions, mais aussi tenter de justifier sa tristesse à voir un avion en s’inventant des raisons. Alors, ce sont ces histoires qui vont organiser plus ou moins sa vie.
Des études ont montré que l’empreinte est d’autant plus forte lorsqu’elle a lieu entre 0 et 5 ans. À ces âges, les enfants sont comme des « petits radars qui cherchent à identifier les dangers potentiels présents dans leur environnement », précise Daniel Schechter, neuroscientifique et psychanalyste qui s’intéresse de près à l’impact intergénérationnel de la violence intrafamiliale. Il a notamment étudié les effets du stress post-traumatique maternel sur la santé des bébés in utero. « En temps normal, le fœtus est protégé du stress maternel par un mécanisme assez sophistiqué, une sorte de portail qui transforme le cortisol en cortisone, une molécule incapable d’atteindre le fœtus », dit-il. Mais lorsque le taux de cortisol est trop haut, comme dans le cas de violences domestiques répétées, le portail cède. « On pense que ce phénomène peut contribuer à l’apparition d’un trouble du stress post-traumatique ou d’autres psychopathologies chez le fœtus », explique le chercheur.
Un traumatisme peut-il pour autant sauter une génération ? Prenons le cas d’une grand-mère qui, dans son enfance, a subi un viol. Protégée par une amnésie traumatique, elle n’en a jamais parlé à sa fille. Vers l’âge de 60 ans, le souvenir remonte alors qu’elle garde sa petite-fille de manière quotidienne. Le traumatisme peut-il passer de la grand-mère à la petite-fille en épargnant la mère ?
« Lorsqu’un parent ne peut parler d’un traumatisme, les enfants ont toujours tendance à imaginer le pire »
« Le traumatisme a certainement affecté la mère, affirme Daniel Schechter, toujours prudent. L’amnésie ne signifie pas nécessairement l’oubli complet, elle peut signifier la désintégration de la mémoire : des sensations fragmentées, des émotions que le psychisme ne reconnaît pas jusqu’à ce qu’un ou plusieurs éléments entrent en résonance avec un rappel, comme la petite-fille à un certain âge. Le problème avec les traumatismes, c’est qu’ils veulent sortir, et ils le feront toujours, d’une manière ou d’une autre. La grand-mère, même dans son état fragmentaire ou dissociatif, peut avoir surprotégé sa fille, par exemple, la marquant ainsi de ses peurs liées à un traumatisme que sa fille ne pouvait pas connaître spécifiquement. C’est ce que nous constatons dans nos recherches en Suisse. »
Mais qu’en est-il en cas d’absence de contact ? Chez l’animal, l’épigénétique montre qu’une transmission est possible. À l’occasion d’une expérience, des rats ont été conditionnés pour associer une odeur à un choc électrique. Ces rats se sont ensuite accouplés avec des rates, puis ont été écartés. Sans connaître leur géniteur, les ratons ont hérité de leur aversion pour cette odeur particulière. « Le résultat est très clair pour un animal en laboratoire, mais chez les humains, il est impossible de déterminer clairement la part épigénétique de la part d’apprentissage social », relativise Serge Tisseron. Lorsqu’on lui pose la question de la transmission du traumatisme de la mère naturelle à son enfant alors que celui-ci, dans le cadre d’une adoption, a été élevé par d’autres parents, le psychiatre préfère l’expliquer avant tout par l’impact environnemental. « Souvent, l’adoption est marquée par un moment difficile, comme un rejet ou un décès, dit-il. Cet environnement précoce, traumatique, pourra le rendre par la suite plus sensible au stress. »
Des travaux en neurobiologie ont démontré, grâce au concept de plasticité neuronale, que les traumatismes vécus laissaient une trace dans le cerveau. « Ces traces, pour autant, ne condamnent pas la vie d’un individu », rappelle François Ansermet, psychanalyste et pédopsychiatre, notamment auteur de L’Origine à venir (Odile Jacob, 2023). La plasticité va dans les deux sens.
Au-delà du déterminisme
Comment dépasser ses traumatismes et éviter ainsi de les transmettre à ses enfants ? « Trouver une figure d’attachement », répond Daniel Schechter, c’est-à-dire quelqu’un capable de se mettre à la place de l’autre, de réguler ses émotions quand l’autre disrégule et de l’aider à donner du sens à sa vie, comme un thérapeute. Le chercheur explique que, dans certaines cultures où consulter n’est pas une option, des mécanismes psychologiques de survie se mettent parfois en place. C’est le cas du « syndrôme portoricain », une sorte de crise d’hystérie en public pouvant aller jusqu’à l’évanouissement – un phénomène qu’il a observé et étudié dans la population latino de New York. « C’est une manière d’appeler à l’aide en créant un groupe de soutien psychologique autour de soi. »
« Plusieurs témoins ont senti le besoin de nous préciser spontanément que leurs parents ne les avaient pas aimés »
Cette notion d’attachement est fondamentale, confirme Francis Eustache. En 2024, le neuropsychologue a recueilli les témoignages d’une soixantaine de témoins des bombardements de Normandie de 1944. L’objectif de l’étude : comprendre l’impact d’un tel traumatisme sur le chemin de vie d’un individu. « Très tôt au cours des entretiens, plusieurs témoins ont senti le besoin de nous préciser spontanément que leurs parents ne les avaient pas aimés », rapporte le chercheur, qui rappelle que la manière dont un enfant est considéré par sa famille et ses proches va jouer sur la manière dont un traumatisme va s’imprimer ou non en lui. « S’il se sent protégé et aimé, le traumatisme sera beaucoup moins présent. »
Francis Eustache insiste aussi sur l’importance des mémoires « alignées » : pour réussir à digérer un traumatisme, la mémoire personnelle doit être en concordance avec les mémoires politique, historique, sociétale de l’événement traumatique, d’où l’importance des mouvements de libération de la parole. Après la guerre, l’accent a été mis sur l’hommage aux héros libérateurs pour des raisons évidentes, occultant les destructions causées par l’avancement des troupes alliées qui, elles, n’ont pas échappé aux Normands. C’est en partie pour cette raison, explique le chercheur, que certains témoins de 1944 ont exprimé leur traumatisme pour la première fois quatre-vingts ans après les faits : la dissonance entre les souvenirs personnels et les souvenirs officiels a bloqué le processus de sortie du traumatisme. « C’est pourquoi, lors des commémorations du 13 Novembre, les officiels ne se rendent pas uniquement au Bataclan mais aussi devant les terrasses des cafés : pour sortir du traumatisme, aucune victime ne doit se sentir oubliée », poursuit le scientifique qui s’apprête à lancer une nouvelle étude baptisée Care, en vue de comprendre comment les attentats de 2015 ont impacté la mémoire et la santé des enfants des victimes.
Mais que faire quand les informations manquent, comme dans le cas d’un secret de famille ? « Lorsqu’un parent ne peut parler d’un événement traumatique, les enfants ont toujours tendance à imaginer le pire », explique Serge Tisseron, qui prend l’exemple des enfants de victimes de la Shoah. Parce que ce qu’ils ont vécu était trop abominable, de nombreux déportés n’ont pas pu partager leur expérience. Certains enfants ont alors imaginé que leurs parents avaient survécu en volant le pain des autres ou en dénonçant leurs camarades. « En thérapie, ce que l’on veut, c’est comprendre comment l’idée que la personne a de ce qui s’est passé organise sa réalité à elle, son quotidien, ses choix sexuels, amoureux, professionnels, dit le psychiatre. Quand la personne a compris cela, elle prend de la hauteur. Il arrive qu’on ne puisse jamais savoir si sa vision de la réalité est la bonne, mais la vérité n’est pas le plus important pour aller mieux. C’est la communication dans la famille qu’il faut rétablir. »
Pour éviter de transmettre le poids d’un secret de famille à son enfant, Serge Tisseron insiste sur l’importance de lui en parler, avec les mots adéquats. Il propose de lui dire que des « événements compliqués ont eu lieu dans la famille, l’on ne sait pas trop quoi, mais voici l’idée que l’on s’en est fait. »
« La sortie du traumatisme se rapporte, pour chacun d’entre nous, à un acte de transformation créative »
Pour surmonter un traumatisme, « il n’existe pas de solution universelle », conclut François Ansermet, qui souligne qu’il est indispensable de prendre en compte la singularité de chaque individu, que le traumatisme soit hérité ou non. Deux personnes présentes au Bataclan ne seront pas marquées de la même manière selon qu’elles soient venues en couple en période passionnelle ou, au contraire, avec la perspective de se séparer prochainement de leur conjoint, ou selon qu’elles aient acheté elles-mêmes leurs billets ou les aient reçus d’un ami malade ce jour-là. Il en sera de même pour les enfants de ces victimes, s’ils héritent du trouble de stress post-traumatique de leurs parents.
Selon François Ansermet, la sortie du traumatisme se rapporte, pour chacun d’entre nous, à un acte de transformation créative. « C’est le propre de l’art, rappelle-t-il. Mais qu’est-ce qui fait que les œuvres de Marina Abramović et de Niki de Saint Phalle, deux êtres traumatisés, seront si différentes ? Leur subjectivité. » C’est cette réponse possible au traumatisme, fondamentalement subjective, que François Ansermet souhaite remettre au cœur de l’approche clinique, trop focalisée sur le traumatisme en lui-même et pas assez sur l’idée de son dépassement. Le risque, pour le psychanalyste, est de devenir le spécialiste de la prédiction du passé, dit-il, contribuant ainsi à river l’individu à une identité de victime, une étape « certainement nécessaire mais pas suffisante ». Peut-être faut-il prendre le traumatisme par son envers, conclut-il : comment on en sort, plutôt que comment on y entre.
« L’héritage familial ne va pas de soi »
Mélanie Plouviez
La philosophe Mélanie Plouviez plaide pour une grande remise à plat de notre système de transmission patrimonial. Revenant à ses origines révolutionnaires, elle montre comment les intentions égalitaires qui ont présidé à sa …
[Mystique]
Robert Solé
Le cinéma est friand de conflits successoraux qui donnent lieu à des empoignades homériques et finissent souvent dans le sang. Que de films nous auront montré des héritiers interloqués après l’ouverture d’un testament chez le notaire !
Que devons-nous à nos gènes ?
Ariane Giacobino
La scientifique Ariane Giacobino revient sur ce que les deux dernières décennies de recherches en génétique et en épigénétique nous ont appris sur la transmission héréditaire, tout en insistant sur le rôle primordial de l’en…