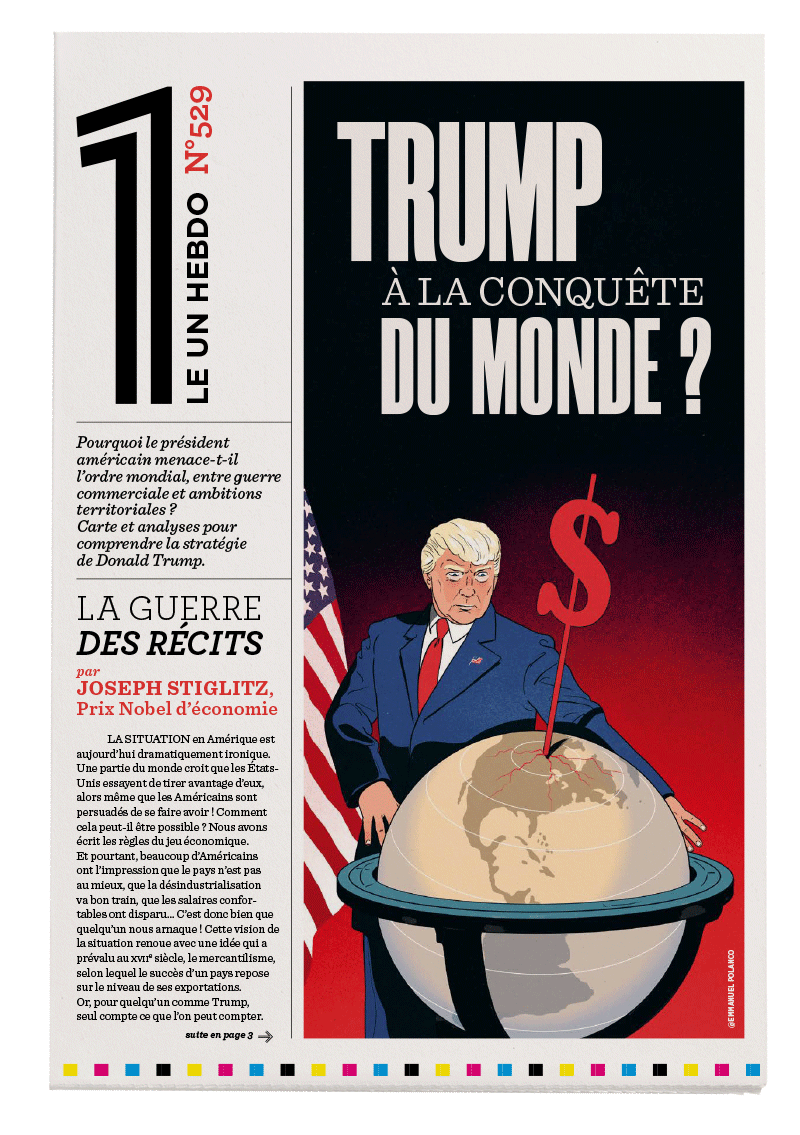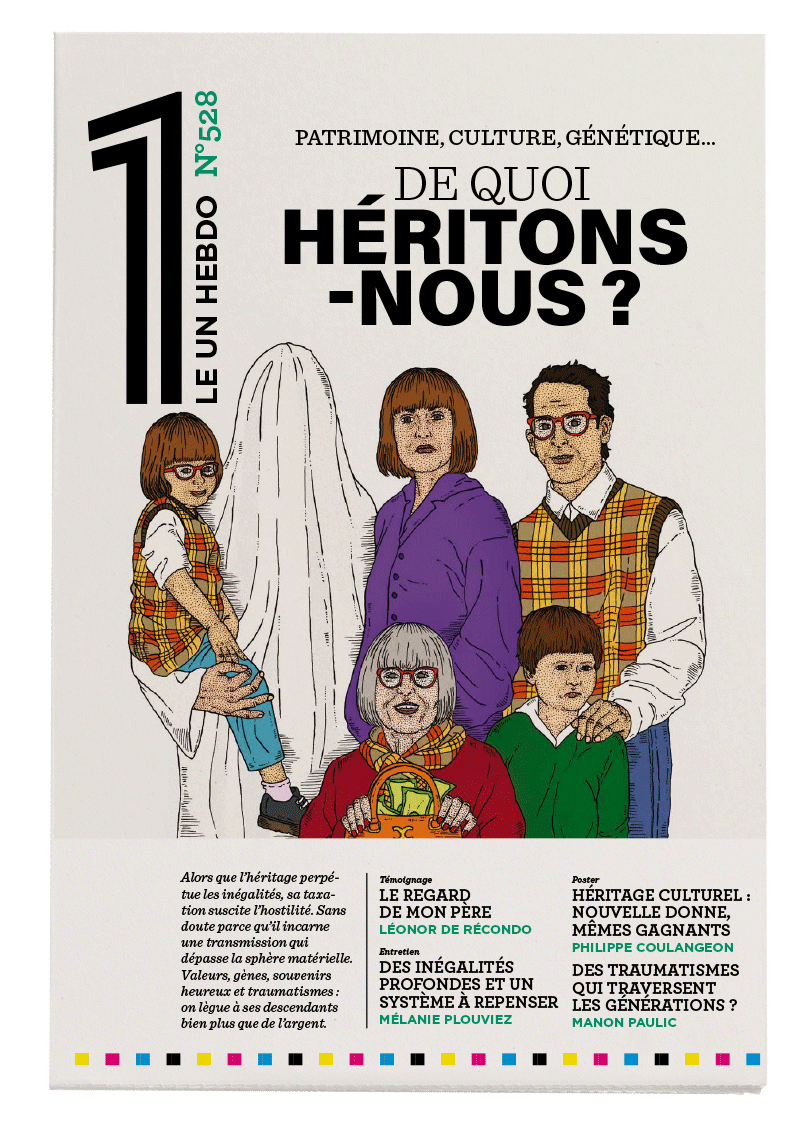« La mondialisation est en réalité une maritimisation du monde »
Temps de lecture : 9 minutes
Pourquoi les océans sont-ils aujourd’hui au cœur des défis stratégiques mondiaux ?
C’est un phénomène assez récent, lié à la nature du développement de l’économie mondiale et des échanges commerciaux. La mondialisation que nous connaissons est en réalité une maritimisation du monde : 90 % des échanges en volume passent par la mer. C’est évidemment dû à l’invention des conteneurs et à l’organisation des grandes compagnies de transport autour de lignes régulières. À chaque instant, cinquante mille bateaux sillonnent les océans du globe, avec des capacités de transport qu’on a peine à imaginer. Un porte-conteneurs peut transporter aujourd’hui jusqu’à 25 000 conteneurs. Si vous deviez les transporter par camions, cela représenterait une file ininterrompue de plus de 250 kilomètres !
Le contrôle des mers représente donc un enjeu considérable.
Oui, on l’a encore vu avec la guerre en Ukraine. S’il s’agit d’un conflit tout à fait terrestre, il n’en a pas moins un impact sur les livraisons de céréales assurées par la mer, par exemple, avec des effets majeurs dans de nombreux pays africains. Nous-mêmes sommes extrêmement dépendants de nos approvisionnements énergétiques, qui viennent du golfe Arabo-Persique ou du golfe de Guinée, et devons donc être vigilants. Il y a un autre aspect essentiel, et dont on a sans doute moins conscience, qui touche au numérique : 99 % des transmissions sont réalisées grâce aux câbles sous-marins. C’est une histoire assez ancienne, puisque le premier câble transatlantique date de la reine Victoria ! À l’époque, une conversation télégraphique prenait plusieurs heures.
« La Chine construit tous les quatre ans l’équivalent de la totalité de la Marine française »
Aujourd’hui, on transporte des téraoctets par seconde grâce à la fibre optique. Jamais notre économie numérique ne serait possible sans ces infrastructures, ce qui rend leur surveillance si stratégique. Les possibilités de sabotage sous-marin sont réelles, comme on l’a vu l’an passé avec les actions contre les gazoducs Nord Stream.
Ce rôle stratégique inclut également un volet militaire ?
Naturellement, et cela est lié à la liberté de circulation qui a cours sur les océans. Une flotte appareille de San Diego ou de Vladivostok et se rend au milieu de la mer de Chine, dans l’océan Indien ou au cœur de la Méditerranée sans franchir aucune frontière, sans demander d’autorisation à qui que ce soit. Cette facilité de circulation fait que les océans sont devenus une scène de compétition entre les grandes puissances. Mais cette compétition elle-même est assez récente. Après la chute du mur de Berlin, seul l’Occident, en particulier les États-Unis, contrôlait les mers et avait la capacité de se projeter en toute sécurité au plus près des théâtres d’opérations, en Somalie, dans les Balkans, au Moyen-Orient, pour appuyer les troupes sur le terrain. Aujourd’hui, cette hégémonie totale a vécu, et la compétition est beaucoup plus vive, en particulier avec la Chine qui construit tous les quatre ans l’équivalent de la totalité de la marine française.
Les océans s’inscrivent-ils dans la stratégie chinoise des « nouvelles routes de la soie » ?
Oui, cette stratégie n’est pas seulement terrestre. On a vu apparaître dans la dernière décennie la première base militaire chinoise à l’étranger, à Djibouti, à l’entrée de la mer Rouge. Le détroit de Bab-el-Mandeb est un verrou maritime si stratégique qu’on trouve au même endroit des bases de différents pays – la France, les États-Unis ou encore le Japon ! La Chine voulait elle aussi pouvoir contrôler ce point de passage entre l’Asie et l’Europe. On peut aussi évoquer les investissements chinois dans des ports européens, en Grèce ou au Portugal, ou dans des ports africains. Ce sont des infrastructures stratégiques, qui n’incluent pas pour l’instant de dimension militaire. Pour la Chine, cette présence maritime est vitale. La croissance sidérante de son économie est intimement liée à la sécurité des échanges maritimes, à la fois pour importer les ressources énergétiques dont elle manque, pour faire tourner ses usines et pour exporter sa production afin de faire entrer des devises. Elle est donc vulnérable sur tous les points de passages clés de ces échanges, comme les détroits de Malacca, d’Ormuz ou de Bab-el-Mandeb.
Comment a évolué le droit des océans ?
Historiquement, deux grandes écoles se font face depuis le XVIIe siècle. Il y a, d’un côté, ceux qui postulent que la mer appartient à tout le monde, que ses ressources sont infinies et qu’il n’est donc pas nécessaire d’y tracer des frontières – c’est la théorie de la « mer ouverte », formulée par les Hollandais notamment. De l’autre, on trouve les tenants des « mers fermées », qui jugent que les mers appartiennent à tel ou tel État. Les Vénitiens considéraient ainsi que l’Adriatique était à eux ; les Portugais, après le traité de Tordesillas de 1494, revendiquèrent un contrôle exclusif de l’océan Indien, tout bateau étranger étant vu par eux comme pirate et traité comme tel. Après de très nombreuses controverses et négociations, un point d’équilibre a été trouvé en 1982, avec la signature à Montego Bay de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, laquelle a mis d’accord les pays puissants, désormais partisans des mers ouvertes et de la libre circulation, et les pays en développement, qui voulaient, eux, protéger leurs zones côtières pour ne pas voir leurs ressources pillées.
Que dit cette convention ?
Elle divise les océans en trois types de zones : les eaux territoriales – en gros la distance qu’on parcourt en naviguant une heure cap au large – sur lesquelles s’appliquent à peu près les mêmes règles que sur le territoire national ; la zone économique exclusive – un jour de navigation cap au large – où tout le monde peut circuler, y compris des vaisseaux militaires, mais où l’État côtier conserve la souveraineté économique, relative aux droits de pêche ou à l’exploitation des fonds marins notamment ; et, au-delà, les eaux internationales, qui n’appartiennent à personne et où le seul droit qui s’exerce est celui du pays dont le bateau arbore le pavillon.
« Pendant longtemps, les rivalités étaient à ce niveau quasi inexistantes, tout simplement parce qu’il était peu rentable d’aller aussi loin en haute mer pour prélever des ressources »
Seules quelques règles sectorielles y subsistent – comme celles qui concernent la pêche à la baleine, la pêche au thon dans le Pacifique, ou les normes de construction des pétroliers –, mais cela reste très limité au regard des enjeux.
Cette situation favorise-t-elle la compétition pour s’arroger les ressources océaniques ?
Pendant longtemps, les rivalités étaient à ce niveau quasi inexistantes, tout simplement parce qu’il était peu rentable d’aller aussi loin en haute mer pour prélever des ressources. Mais depuis quelques années, on voit apparaître des expéditions capables d’aller pêcher très loin, comme ces flottilles chinoises de cargos et de bateaux-usines qui vont faire des razzias sur le calmar en mer d’Arabie ou dans les Galapagos. Rien ne les en empêche aujourd’hui, mais on a du mal à croire que ces campagnes massives seront sans impact sur des stocks dans lesquels on puise jour et nuit.
Qu’en est-il de l’exploitation minière des fonds marins ?
Elle est envisagée dans certaines zones, notamment dans les grandes plaines abyssales du Pacifique, où l’on trouve ce qu’on appelle des nodules polymétalliques – des sortes de galets, au volume comparable à celui d’une boule de pétanque, très riches en métaux rares ou qui pourraient devenir rares sur Terre. Il y a aussi les encroûtements cobaltifères – des dépôts d’une vingtaine de centimètres au sommet des monts marins –, qu’on trouve notamment en Polynésie française. Enfin, on lorgne les amas sulfurés – d’anciennes cheminées de sources thermales où sont présents de nombreux métaux comme le fer, le cuivre ou le plomb. Jusqu’à présent, on pensait l’exploitation de ces ressources hors de prix, mais le progrès technique rend cette perspective plus réaliste. L’Autorité internationale des fonds marins a délivré jusqu’ici des permis d’exploration, à des organismes ou à des entreprises soutenues par des États, mais la question se pose désormais de passer aux permis d’exploitation. Or, au-delà des questions techniques et financières, il y a des risques environnementaux majeurs, d’autant qu’on sait finalement très peu de choses sur ces zones ! On ne connaît que 10 à 15 % de la topographie du fond des mers, et on ignore quasiment tout de leur biodiversité. Certaines espèces n’ont été observées qu’une seule fois, en un seul endroit ! On prend donc un risque considérable à perturber cet écosystème unique, forgé par des millions d’années d’évolution. Sommes-nous prêts à nous priver de ce trésor encore inconnu ?
On pensait les ressources des océans infinies. Sont-elles désormais en péril ?
On sait que la ressource halieutique peut disparaître. On a l’exemple de la morue à Terre-Neuve, qui pendant des siècles a été l’or blanc des Portugais, des Basques et des Normands, et qui a disparu presque du jour au lendemain. Idem pour la sardine au large de San Francisco. Si un stock de poissons passe sous un certain seuil, il disparaît. Et il est très difficile de le reconstituer, même artificiellement : les œufs de tous les poissons, même les plus gros, font à peu près la même taille, autour de 1 millimètre de diamètre ; ce sont donc tous des proies faciles pour les crevettes ou certains petits poissons. C’est comme si, dans la savane, les girafes mangeaient les lionceaux !
« Notre économie bleue est aujourd’hui orientée vers le transport et le tourisme »
Il faut donc organiser les conditions d’une pêche durable, avec une surveillance scientifique, des politiques de quotas et des règlements plus stricts si nécessaires. Cela se met en place en Europe, avec des résultats positifs, même si tout n’est pas encore parfait – en Méditerranée, notamment. C’est plus difficile dans d’autres zones du monde, comme en Afrique de l’Ouest, où les réserves sont moins surveillées et volontiers pillées. Or, si ces ressources halieutiques venaient à se tarir, les conséquences seraient sans doute très graves pour les populations côtières.
La France possède le deuxième domaine maritime au monde, vaste de plus de 10 millions de kilomètres carrés. Quels sont les enjeux qui en découlent ?
Ce domaine se situe principalement outre-mer. Grâce à lui, la France est un pays riverain de tous les océans du monde et prend ainsi part aux échanges économiques et diplomatiques de chacune de ces régions du globe. Cela nous oblige à être particulièrement attentifs à l’évolution du droit maritime international, car nous sommes concernés au premier chef par sa contestation ou son évolution. L’exploitation économique de ce domaine reste aujourd’hui modérée. Il y a notamment des interrogations sur le potentiel énergétique de l’économie bleue, des éoliennes à l’énergie houlomotrice (celle des vagues). Il n’y a pas d’exploitation des fonds marins, pas de zone pétrolière. Quant à la pêche, la zone la plus riche dont nous disposons se situe près des îles Kerguelen, au sud de l’océan Indien. Notre économie bleue est aujourd’hui orientée vers le transport et le tourisme. Mais cela signifie que ce vaste domaine maritime présente un potentiel de développement considérable, qui suscite la convoitise et exige donc de la vigilance. En mer, ce qui n’est pas contrôlé est pillé, et ce qui est pillé est contesté.
Propos recueillis par JULIEN BISSON
« La mondialisation est en réalité une maritimisation du monde »
Christophe Prazuck
Le directeur de l’Institut de l’Océan de l’Alliance Sorbonne Université et ancien amiral Christophe Prazuck fait le point sur les questions stratégiques, économiques et environnementales liées aux espaces maritimes, en soulignant ce qui les rend de plus en plus incontournables.
[Peur bleue]
Robert Solé
Monsieur le rédacteur en chef,
Vous me dites que les océans sont menacés par la surpêche, le réchauffement climatique, l’acidification, le manque d’oxygène… Mais, moi, je les vois terriblement menaçants.
Protéger la biodiversité marine : « On brûle le livre du vivant sans même l’avoir lu »
Hélène Seingier
Une grande enquête de notre journaliste Hélène Seingier sur ce combat pour la vie sous-marine mené par des scientifiques, des activistes et certaines communautés côtières.