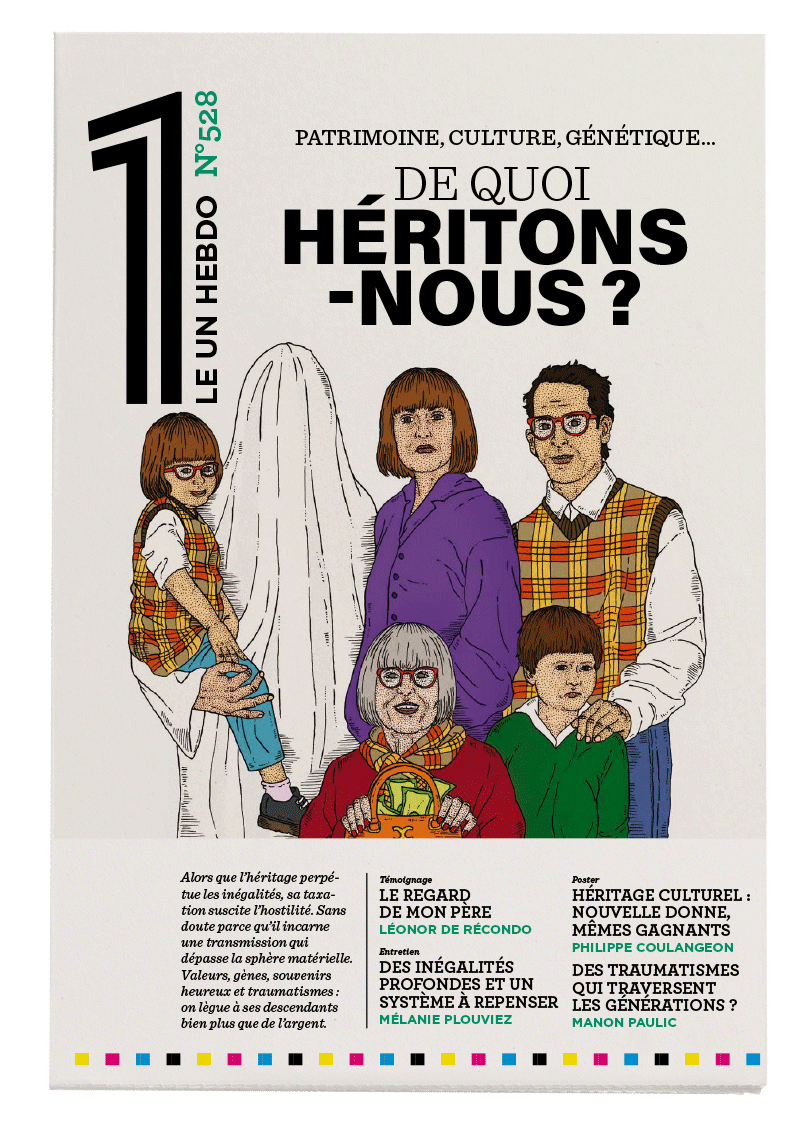Erdoğan, le sultan anti-Kurdes
Temps de lecture : 5 minutes
Entouré lors des cérémonies de gardes en tenue ancestrale portant casque et hallebarde, il ne déteste pas qu’on le surnomme « le sultan ». Autocrate, doté d’une Constitution sur mesure qui lui confère quasiment les pleins pouvoirs, Recep Tayyip Erdoğan aime évoquer la grandeur de la nation turque. Comme l’un de ses modèles, le sultan Mehmet II, qui prit Constantinople aux Byzantins en 1453, le président turc rêve d’étendre son fief, mais en sens inverse, vers l’Orient, depuis les rives du Bosphore où il a lancé sa conquête du pouvoir dans les années 1990. L’offensive lancée contre les Kurdes en Syrie obéit certes à une logique de puissance qui entend gagner du terrain sur ses marches, mais, soutenue par une grande partie de la population turque, elle correspond aussi et surtout à une stratégie d’ostracisme soigneusement mise en scène par le chef de l’État.
Islamo-conservateur et tribun hors pair, Erdoğan avait tendu la main voici quelques années aux Kurdes de Turquie. Depuis, il tient une partie de la communauté pour responsable des attaques menées par le PKK, le mouvement indépendantiste kurde, considéré comme un groupe terroriste et qui ferraille depuis 1983 dans les montagnes de l’Est. En gros, tout ce qui ne répond pas à l’idéal de la nation turque est condamné au silence. La minorité kurde (15 à 20 millions d’âmes sur une population totale de 80 millions) doit ainsi d’abord se définir comme turque. Dans de violentes diatribes, Erdoğan n’a eu de cesse de fustiger l’Europe, trop encline à ses yeux à soutenir les Kurdes de Syrie.
C’est là où le bât blesse. L’homme fort de la Turquie ne peut supporter cette épine dans le pied aux marches de son territoire. Car les combattants du Rojava, le Kurdistan syrien qui inquiète tant Ankara, sont assimilés à leurs frères d’armes de l’autre côté de la frontière, ceux du PKK. Le message martial est destiné à tout bastion kurde dans la région, sommé de se mettre au pas et de répondre aux injonctions turques – comme le démontrent les menaces à l’encontre du gouvernement régional du Kurdistan d’Irak, pressé d’évincer les bases arrière du PKK de ses montagnes. L’offensive d’octobre était ainsi planifiée de longue date – annoncée haut et fort même ! – et permet au reis, « le guide » en turc, de rassembler autour de lui, après le coup de semonce des élections municipales de cette année et la perte d’Istanbul. Or « qui tient Istanbul tient la Turquie » aime à rappeler Erdoğan lui-même, originaire de Kasimpasa dans la vieille ville.
Avec le vaste assaut contre la forteresse des Kurdes syriens, le numéro un turc, au pouvoir depuis 2003, fédère autour de lui non seulement l’armée, déjà sérieusement mise au pas après la tentative de coup d’État en 2016, mais aussi toute une frange de l’opposition. L’un de ses principaux rivaux, le nouveau maire d’Istanbul Ekrem Imamoglu, ne s’est pas longtemps fait prier pour soutenir l’invasion du Rojava, le Kurdistan syrien. Une seconde trahison pour les Kurdes, puisqu’une partie des leurs, en Turquie, ont soutenu cet opposant et sa formation le CHP, héritière du kémalisme et de la pensée jacobine de Kemal Atatürk, le fondateur de la Turquie moderne en 1923.
Le rejet sanglant d’une entité kurde, fût-elle au-delà des frontières de la Turquie, suffit à revigorer le tropisme oriental d’Erdoğan. Dangereuse à terme en raison d’un aventurisme militaire hasardeux, la stratégie paie pour l’heure. Le discours haineux d’Erdoğan, au comportement erratique et aux dérives autoritaires, tranche en cela avec les autres chefs d’État ou de gouvernement turcs, qui ont rarement été aussi loin. « Le pays tout entier est dans un état alarmant, en proie au nationalisme, à l’étatisme, au militarisme et à la haine anti-Kurdes », souligne l’ancien correspondant en Turquie de Libération Ragip Duran dans les colonnes d’Arti Gercek, un site d’information lancé en 2017 par des journalistes exilés en Allemagne.Si le maître d’Ankara, en jouant sur la fibre du sentiment national, instrumentalise autant l’ancestrale confrontation avec les Kurdes, au sein et hors de ses frontières, c’est aussi pour mieux incarner le renouveau de la puissance turque, dans une nouvelle fuite en avant aux accents fortement patriotiques. Installé dans un palais démesuré de 1 150 pièces à la lisière de la capitale, Erdoğan, en proie à la folie des grandeurs, s’affirme de plus en plus comme le dépositaire des mânes de l’Empire ottoman.
Les trois desseins du souverain dans sa bataille contre les Kurdes, militaire, politique et post-impérial, renouvellent le rêve d’un néo-ottomanisme. Au Parlement, des élus évoquent la splendeur de la « nation éternelle » qui se doit de renforcer sa zone d’influence. Et dans le grand jeu qui se dessine au Moyen-Orient, l’hyper-président turc entend normaliser les relations avec l’Iran et la Russie. Une alliance sur le dos des Kurdes, éternels trahis de l’histoire, même s’ils n’ont pas dit leur dernier mot. Reste que le terrain demeure glissant pour Erdoğan, empêtré dans sa double posture de Monsieur Bulldozer et de joueur d’échecs. Dans la redistribution des cartes des nouveaux empires, il n’est pas certain que le sultan d’Ankara sorte gagnant.
« Chez les Kurdes, l’imaginaire commun est très puissant »
Hamit Bozarslan
Quels étaient les objectifs du président turc en faisant entrer son armée au nord-ouest de la Syrie ?
En finir avec la présence kurde à sa frontière. Pour Recep Tayyip Erdoğan, la « turcité »,…
[Amour]
Robert Solé
Dès que ce pauvre Donald Trump ouvre la bouche, tout le monde lui tombe dessus. Ce qu’il a dit à propos du lâchage des Kurdes par les États-Unis était pourtant frappé au coin du bon sens : « Ils ne nous ont pas aidés pendant la…
Un pour tous
Philippe Meyer
Que sommes-nous devenus pour que le sort des Kurdes ne nous affecte pas davantage ? Que nous le traitions comme une de ces péripéties qui se déroulent à nos portes mais ne nous concernent que de loin ? Que ne comprenons-nous pas pour que les Kurdes n&rsq…