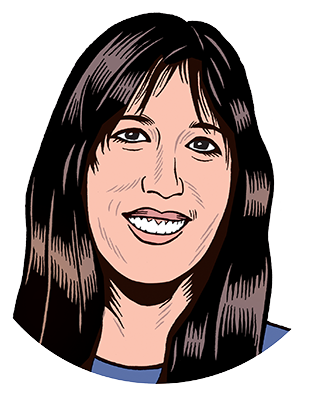Curriculum vitæ selon les guerres
Temps de lecture : 5 minutes
Un pour cent de la population juive qui vivait là à cette époque a perdu la vie durant cette guerre, dont un jeune homme originaire de Budapest qui, après avoir survécu à la Shoah, avait réussi à immigrer en Israël où il avait intégré un kibboutz, était tombé amoureux d’une fille et l’avait épousée – ma future mère. Des années plus tard, la jeune veuve rencontrerait un autre homme, se marierait et mettrait au monde deux enfants, moi puis mon frère. Mais elle ne cesserait de se languir de son premier mari. Sa profonde nostalgie a accompagné toute mon enfance, ainsi que la conscience que je devais mon existence à la mort de cet homme. Que s’il n’avait pas été tué au cours de cette guerre-là, je ne serais pas née.
Les guerres, comme les amours, ne viennent jamais au moment où l’on s’y attend, a écrit Léa Goldberg, merveilleuse poétesse du début du XXe siècle. En 1967 pourtant, la guerre a éclaté au terme d’une attente qui avait mis les nerfs du pays à rude épreuve. Je me souviens de l’inquiétude de mes parents, collés à la radio, en train d’écouter les annonces belliqueuses de l’Égypte et de la Syrie qui promettaient une attaque imminente et prédisaient l’occupation d’Israël. La nuit, j’avais du mal à m’endormir tant j’avais peur. Je n’avais que huit ans, mais je savais déjà que nos ennemis n’avaient pas plus de pitié envers les enfants qu’envers les adultes.
La sensation pesante d’une catastrophe
Je me souviens que ma mère est venue nous chercher à l’école, mon frère et moi, en pleine classe, comme des centaines d’autres parents affolés. La guerre a éclaté ! Elle nous a directement conduits à l’abri antiaérien du quartier et nous y sommes restés six jours, entourés de tous les habitants de notre petite localité, serrés les uns contre les autres. Je me souviens de l’angoisse, de la sensation d’étouffement et de cette jeune voisine, assise en face de moi, qui allaitait sa petite fille, un bébé de deux jours, sous le bruit des bombes. Et aussi du triste poème que j’ai écrit alors que je les contemplais.
La guerre de 1973 a éclaté un samedi après-midi. Nous étions chez de la famille, à Jérusalem. Les mains tremblantes, ma tante a aussitôt repassé l’uniforme militaire de sa fille qui venait d’être rappelée à la base. Mon frère et moi avons peint les phares de la voiture en bleu avant de reprendre la route pour rentrer chez nous, en cas d’attaque aérienne. La surprise était totale. La sensation pesante d’une catastrophe. Je me souviens du trajet de retour à vitesse réduite et de mes parents qui parlaient d’un danger existentiel. Les Égyptiens attaquaient au sud, les Syriens entraient par le nord. Qu’allions-nous devenir ? « Nous roulions lentement, avec des phares bleu foncé, comme si nous avions commis une lourde faute » – voilà ce que j’ai écrit dans mon cahier de poèmes une fois arrivée à la maison.
- – Quand la première guerre du Liban éclate, je suis déjà étudiante à l’université de Jérusalem. Dès les premiers jours, une de mes amies perd son mari au combat. Je me vois chez ses parents, l’endroit même où ils s’étaient mariés à peine deux mois auparavant, avec elle qui sanglote dans mes bras. Plus tard, elle se remarierait, aurait un fils et une fille, mais ne cesserait de se languir de son premier mari.
Au début de 1988, j’accouche de ma fille aînée. Les journaux qui annoncent le début de la première intifada sont éparpillés sur mon lit d’hôpital. Inquiète, c’est en l’allaitant que j’en parcours les gros titres. Tout est deux fois plus menaçant depuis que je suis mère. J’intitule mon premier recueil de poésie, publié à la fin de cette année-là : Cible facile pour snipers.
Au début de 2004, j’accompagne tous les matins mon fils de huit ans à l’école. Quand il est né, en 1995, on sentait encore dans l’air un espoir de paix. Comme toute mère israélienne qui accouche d’un fils, j’ai alors prié pour que d’ici à ce qu’il atteigne ses dix-huit ans, il n’y ait plus de guerres.
Tout est deux fois plus menaçant depuis que je suis mère
Seulement voilà, la deuxième intifada a éclaté en l’an 2000. Bientôt éclaterait aussi la deuxième guerre du Liban, puis les épisodes de guerre à Gaza se succéderaient avec une récurrence désespérante.
Ce matin-là, en rentrant à la maison après avoir accompagné mon fils, au moment où je passe sur le trottoir exactement sous les fenêtres de l’appartement de mes parents, un autobus explose à ma hauteur. Propulsée par le souffle, je fais un vol plané et je retombe très violemment sur l’asphalte. Ma mère, qui me voit de chez elle – je gis, blessée, sur le trottoir – ne peut pas descendre jusqu’à moi parce que sa cage d’escalier est couverte de lambeaux de chair humaine et de morceaux métalliques. Plus tard, dans l’ambulance, me revient une scène de mon premier roman, un texte surréaliste : l’héroïne, dont la fille a été kidnappée, creuse sa propre tombe sous la maison de ses parents.
Les choses continueront à s’enchevêtrer ainsi pour moi. Certains fantasmes deviendront réalité, des guerres serviront de métaphores, des attentats déclencheront des histoires d’amour. Parce que, dans cet enchaînement dont on ne voit toujours pas la fin, je n’ai eu de cesse d’essayer de me concentrer sur l’individu, l’intime qui, bien sûr, intègre aussi les drames extérieurs. Et ce n’est pas seulement en littérature, mais dans ma vie de tous les jours, que j’essaie de me concentrer sur l’être humain, juif ou arabe, chrétien ou musulman, à condition qu’il soit prêt à faire des concessions. C’est de là que viendra l’espoir, même en ces temps bien sombres. Du dialogue individuel, à hauteur d’homme, avec ceux dont l’image des guerres reflète l’image des miennes.
Traduit de l’hébreu par Laurence Sendrowicz
« La solution pourrait être de disjoindre l’État et le territoire »
Vincent Lemire
« On observe partout un aggiornamento des schémas d’avant le 7 octobre, qui apparaissent désormais dépassés. Il faut souhaiter qu’on ne laisse pas passer cette occasion historique. » L’historien Vincent Lemire, s’élevant contre l’idée reçue d’un conflit insoluble, met en avant une soluti…
[Nobélisés]
Robert Solé
Le conflit entre l’État hébreu et ses voisins paraît insoluble. Il a pourtant donné lieu à deux prix Nobel de la paix : le premier a été attribué conjointement à Anouar al-Sadate et Menahem Begin en 1978, avant même la conclusion du traité égypto-israélien ; le second est revenu à Yasser Arafat, …
Négociations impossibles ?
Élisabeth Marteu
La politiste Élisabeth Marteu, spécialiste du conflit proche-oriental, examine les intérêts et l’attitude des différents acteurs régionaux voisins d’Israël et de la Palestine. Son diagnostic souligne un enchevêtrement d’enje…