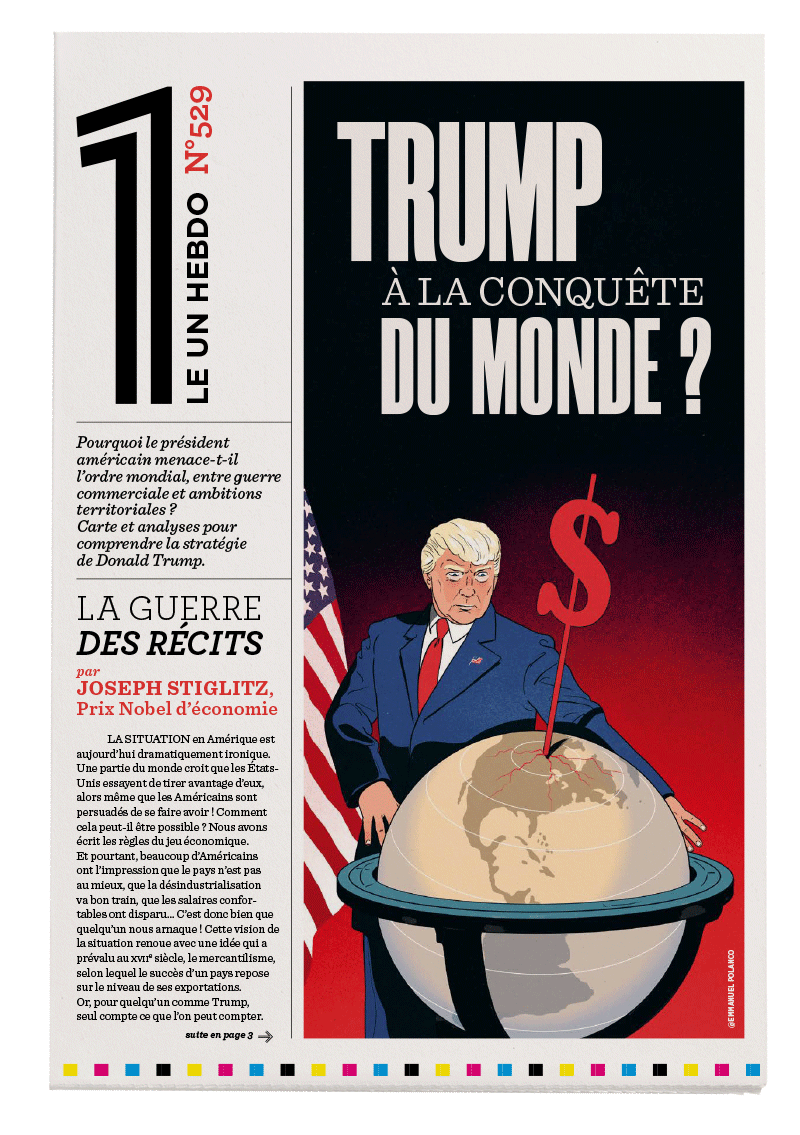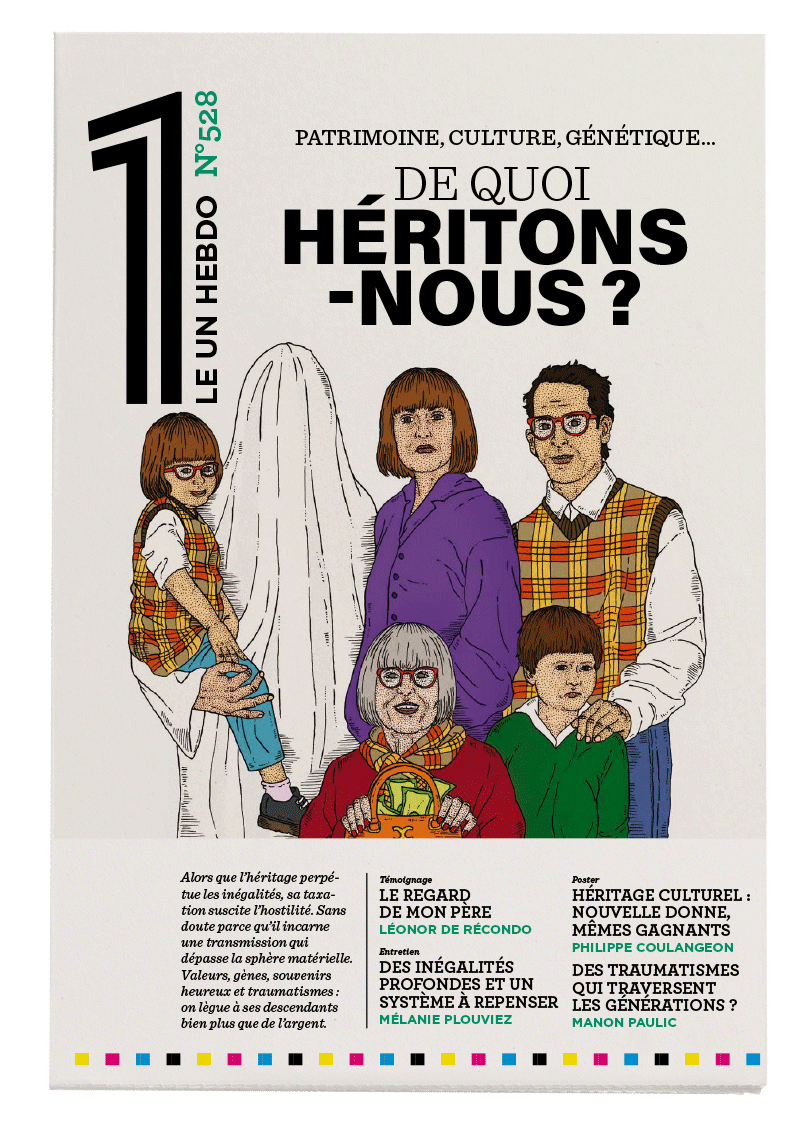« La solution pourrait être de disjoindre l’État et le territoire »
Temps de lecture : 9 minutes
Est-il absurde de parler de paix alors que la guerre fait encore rage à Gaza et menace d’embraser la région ?
Non, mais il y a deux préalables urgents avant d’imaginer l’horizon politique de la paix. Le premier, c’est de freiner la course à l’abîme qui menace le Proche-Orient d’un embrasement généralisé. C’est ce à quoi s’emploient les diplomates, avec un relatif succès depuis le 7 octobre, même si ce n’est pas ce qu’il y a de plus spectaculaire à observer. Le second, c’est d’arrêter le massacre à Gaza et de convaincre les Israéliens que l’expulsion de deux millions et demi de Palestiniens n’est pas une option. Là encore, les réactions très fortes en Europe et aux États-Unis aux ballons d’essai lancés par l’extrême droite israélienne sont un signal important. Sans ces deux préalables, on ne pourra pas envisager de solution politique. Mais cela ne doit pas nous empêcher dès aujourd’hui de nous réarmer intellectuellement, pour sortir de cette fausse évidence d’un « conflit insoluble ».
N’est-ce pas le cas ?
Absolument pas ! C’est une vision erronée sur le plan historique, car toute l’histoire de la région, telle que je l’ai par exemple racontée dans la bande dessinée Histoire de Jérusalem, démontre que les phases de confrontation les plus aiguës sont toujours suivies par des compromis et des accommodements. Et c’est un discours mortifère sur le plan politique, car il déresponsabilise la communauté internationale et empêche d’inventer des solutions créatives et de construire les mobilisations indispensables pour les atteindre.
Du côté des chancelleries, la solution à deux États reste régulièrement brandie. Est-elle encore la plus réaliste ?
Oui, à condition de préciser de quoi on parle pour que ça ne reste pas un slogan creux. Pourquoi est-il nécessaire de mettre en place un deuxième État, en plus d’Israël ? Parce qu’un État est une entité qui représente, qui protège et qui contrôle une société, et c’est ce dont manquent cruellement les Palestiniens. Ensuite, ces deux États doivent-ils être strictement articulés sur deux territoires complètement séparés ? C’était le scénario de la partition proposée par l’ONU en 1947. Et c’est celui qui a été accepté par l’OLP en 1989, puis par le Hamas en 2017, sur la base des frontières de 1967, soit 22 % du territoire de l’ancienne Palestine mandataire.
« Les deux États d’Israël et de Palestine pourraient s’articuler autour d’institutions locales, nationales et transnationales »
Sauf que cette solution impliquerait d’expulser 750 000 colons israéliens de Cisjordanie et de Jérusalem-Est. Pour rappel, lors du retrait de Gaza en 2005, Israël avait dû mobiliser 24 000 policiers et militaires pour déloger 8 000 colons. Les colons de Cisjordanie sont cent fois plus nombreux ; on voit mal comment les forcer à partir. Cette solution étroitement territorialiste interdirait aussi le retour des réfugiés palestiniens désireux de revenir habiter en Palestine ou en Israël.
Quelle serait l’alternative ?
La solution pourrait être de disjoindre en partie l’État et le territoire, c’est-à-dire de créer deux entités étatiques fortes et légitimes, soutenues et reconnues par la communauté internationale, mais représentant des populations vivant sur l’un ou l’autre des deux territoires distincts. On pourrait ainsi imaginer que l’État palestinien soit reconnu dans les frontières de 1967, mais qu’en son sein puissent demeurer les colons qui le souhaitent. Idem pour les quelque 2 millions de Palestiniens vivant en Israël et pour les réfugiés palestiniens qui bénéficieraient d’un droit au retour.
Cette solution, dite « two states, one homeland » (« deux États, une patrie »), repose sur une forme confédérale qui peut sembler un peu baroque, mais l’Europe a montré, après des tragédies terribles, qu’il était possible de la mettre en œuvre. Si vous êtes Français et que vous vivez à Berlin, vous payez vos impôts locaux et vous votez aux élections locales en Allemagne, aux élections présidentielles en France, et aux élections européennes comme tous les ressortissants de l’Union. De même, les deux États d’Israël et de Palestine pourraient s’articuler autour d’institutions locales, nationales et transnationales, avec des élections à différents niveaux et un passeport commun aux Israéliens et aux Palestiniens, comme le passeport européen. Rien ne s’y oppose concrètement, c’est la volonté politique qui manque foncièrement aujourd’hui.
Ne serait-ce pas incompatible avec le projet sioniste ?
Au contraire : ce qui menace concrètement le projet sioniste originel – un État juif et démocratique –, c’est la situation actuelle. Aujourd’hui, il y a un seul État qui va de la mer Méditerranée au Jourdain, avec une seule armée officielle, l’armée israélienne, une seule frontière internationale, la frontière israélienne, et une seule monnaie, le shekel israélien. Et c’est de facto un État binational, car au sein de cette entité unique vivent grosso modo 7 millions d’Israéliens et 7 millions de Palestiniens. Sauf que cette parité démographique ne peut recevoir aucune traduction politique tant que la population palestinienne connaît une situation d’apartheid en Cisjordanie, à Jérusalem-Est et à Gaza.
En réalité, ce qui se met en place aujourd’hui sous nos yeux, c’est un État binational qui n’est ni juif ni démocratique ! Et le projet sioniste originel, celui d’un refuge sûr pour les diasporas juives menacées par l’antisémitisme, s’est mué en un projet messianique particulièrement risqué sur le plan sécuritaire, à l’opposé des ambitions initiales.
Quels sont les dossiers les plus problématiques sur le chemin de la paix ?
On peut en distinguer trois : les frontières, les réfugiés et Jérusalem. Les deux premiers deviendraient nettement plus faciles à régler dans le cadre d’une solution confédérale : si vous autorisez les colons qui le veulent à rester en Cisjordanie, vous réglez en grande partie le problème des frontières ; idem si vous permettez aux réfugiés palestiniens qui le souhaitent de se réinstaller en Palestine ou en Israël, avec un passeport commun.
« La première erreur d’Oslo a été de faire croire à une symétrie entre les deux belligérants »
Quant à Jérusalem, elle doit être la capitale des deux États, et je n’ai jamais considéré que c’était le problème le plus difficile à résoudre. C’est avant tout un verrou symbolique, et la grande erreur du processus d’Oslo a justement été de dramatiser cet enjeu en installant l’idée d’une partition, avec l’imaginaire de barbelés et de checkpoints intra-urbains que cela a induit. Il faut remplacer cette logique par celle de partage en étendant le périmètre territorial de la municipalité plus à l’Est pour y intégrer certains faubourgs palestiniens comme Abou Dis – où se trouve toujours l’ex-futur Parlement palestinien – mais aussi en élargissant son périmètre de compétence pour qu’elle représente réellement les intérêts de ses habitants (actuellement, 60 % de Juifs israéliens, 40 % de Palestiniens).
Quel rôle peut tenir la communauté internationale dans le processus de paix ?
Je suis sur la même ligne que l’historien et ancien ambassadeur d’Israël en France Élie Barnavi, qui a encore répété il y a quelques jours qu’il fallait « imposer aux parties un cadre de règlement rigide », ou que le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell, qui a déclaré le 3 janvier : « La solution doit être imposée de l’extérieur. » La première erreur d’Oslo a été de faire croire à une symétrie entre les deux belligérants, alors que le rapport de force était clairement en faveur des Israéliens. Et aujourd’hui, le niveau de violence et le désir de vengeance sont tels qu’il est devenu encore plus impossible d’envisager une solution négociée à deux. Il faut donc un tiers médiateur.
Qui ? Les États-Unis, en premier lieu. Ils sont les seuls à avoir à la fois la confiance et les moyens de pression suffisants face à Israël. Or, Joe Biden sait qu’il a devant lui une responsabilité historique, celle de ne pas laisser ce conflit systémique entre les mains de Trump. Le calendrier électoral américain le presse donc de trouver une solution dans l’année qui vient, à la fois pour préserver ses chances d’être réélu – la base démocrate, notamment les jeunes, s’est montrée très critique par rapport à son alignement sur Israël –, mais aussi pour éviter un embrasement régional, un nouveau choc pétrolier ou un coup d’arrêt au commerce mondial, directement menacé par les extensions du conflit en mer Rouge. Les États-Unis savent aussi, alors que la guerre se poursuit en Ukraine, qu’ils ne peuvent pas continuer à rester aussi isolés à l’ONU en s’opposant à certaines résolutions, avec Israël et quelques micro-États clients, contre la quasi-unanimité des pays membres.
Sont-ils les seuls à pouvoir agir ?
Non, d’autres pays doivent être impliqués, dont la France qui a des liens historiques puissants avec Israël et la Palestine et un siège permanent au Conseil de sécurité. Quant à l’ONU, elle porte une responsabilité éminente dans ce conflit, car c’est elle qui l’a généré et paramétré en 1947. Elle doit donc être en première ligne pour sa résolution.
« La paix ne se fait jamais qu’entre ennemis, lorsque les deux camps prennent conscience qu’il est trop périlleux de continuer ainsi »
Mais je crois aussi au rôle fondamental de l’Europe, d’abord en tant que premier partenaire commercial d’Israël, ensuite grâce à l’expérience historique européenne, celle de la réconciliation après l’horreur, celle de la créativité institutionnelle pour sortir des apories trop souvent brandies comme des excuses faciles.
Cela évacue-t-il la question du leadership, en Israël comme du côté palestinien ?
Non, car une solution imposée de l’extérieur doit forcément compter sur des relais intérieurs. En l’occurrence, une solution pacifique à deux États telle qu’on l’a évoquée est inenvisageable avec Netanyahou au pouvoir, ou avec le Hamas seul aux manettes à Gaza et en Cisjordanie. Mais ce peut être une carte entre les mains d’un futur Premier ministre israélien, comme le centriste Benny Gantz, qui pourrait s’adresser à sa population comme Yitzhak Rabin a pu le faire en disant : « Le risque existentiel est trop fort, il faut changer de politique. »
Dans l’autre camp, on peut imaginer qu’un interlocuteur essentiel pourrait être Marwan Barghouti, le « Mandela palestinien », aujourd’hui emprisonné en Israël, mais qui a la légitimité d’un combattant de la seconde intifada, sans avoir à assumer la corruption du Fatah ou les crimes du Hamas… Aujourd’hui, Netanyahou est encore au pouvoir, seulement sa légitimité s’étiole. On peut également imaginer que le Hamas finisse par intégrer l’OLP, comme plusieurs dirigeants le suggèrent ouvertement aujourd’hui. En tout cas, la paix ne se fait jamais qu’entre ennemis, lorsque les deux camps prennent conscience qu’il est trop périlleux de continuer ainsi.
De ce point de vue, les attaques du 7 octobre et leurs suites ont-elles permis de faire bouger les lignes ?
Oui, ces événements exceptionnels ont créé des potentialités exceptionnelles, pour le pire, mais peut-être aussi pour le meilleur. On n’a jamais vu de mobilisation aussi forte de la diplomatie occidentale sur ce dossier que depuis le 7 octobre. Surtout, beaucoup ont compris que ce conflit ne se réglera jamais par des voies militaires et que seule une solution politique peut conduire à la paix et donc à la sécurité. Le fantasme israélien de la sécurité assurée par la technologie et les renseignements s’est effondré. Des espaces de débat se rouvrent, y compris en Israël, à gauche comme à droite. On observe partout un aggiornamento des schémas d’avant le 7 octobre, qui apparaissent désormais dépassés. Il faut souhaiter qu’on ne laisse pas passer cette occasion historique.
Propos recueillis par JULIEN BISSON
« La solution pourrait être de disjoindre l’État et le territoire »
Vincent Lemire
« On observe partout un aggiornamento des schémas d’avant le 7 octobre, qui apparaissent désormais dépassés. Il faut souhaiter qu’on ne laisse pas passer cette occasion historique. » L’historien Vincent Lemire, s’élevant contre l’idée reçue d’un conflit insoluble, met en avant une soluti…
[Nobélisés]
Robert Solé
Le conflit entre l’État hébreu et ses voisins paraît insoluble. Il a pourtant donné lieu à deux prix Nobel de la paix : le premier a été attribué conjointement à Anouar al-Sadate et Menahem Begin en 1978, avant même la conclusion du traité égypto-israélien ; le second est revenu à Yasser Arafat, …
Négociations impossibles ?
Élisabeth Marteu
La politiste Élisabeth Marteu, spécialiste du conflit proche-oriental, examine les intérêts et l’attitude des différents acteurs régionaux voisins d’Israël et de la Palestine. Son diagnostic souligne un enchevêtrement d’enje…