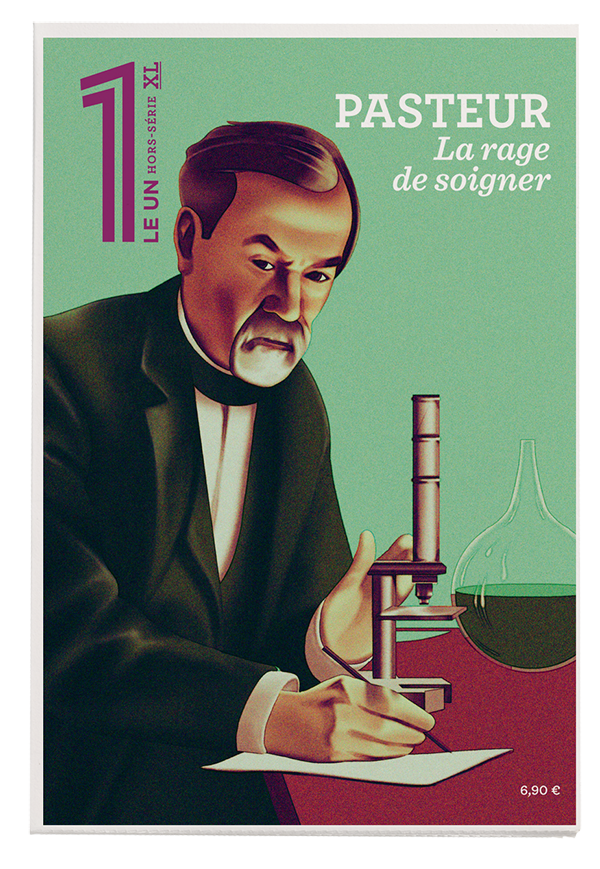Un maître de la communication
Temps de lecture : 11 minutes
Le 15 mai 1848, le jeune Louis Pasteur communique à l’Académie des sciences sa première découverte majeure : des molécules de formules chimiques identiques ont des propriétés différentes quand leurs structures divergent. Jean-Baptiste Biot, son mentor, en est le rapporteur. Antoine-Jérôme Balard, le superviseur de Pasteur à l’École normale supérieure, et Jean-Baptiste Dumas, son ancien professeur à la Sorbonne, font partie de la commission, ainsi qu’Henri Victor Regnault, le seul chimiste avec lequel Pasteur n’avait pas déjà entretenu de relations de travail. Bien que cela prenne plusieurs jours, en raison des multiples opérations nécessaires, Pasteur reproduit sous leurs yeux les diverses étapes de l’expérience.
Cette démonstration n’implique aucun scepticisme particulier des savants envers leur jeune collègue : il s’agit au contraire d’une validation par les pairs, conformément aux règles de la science moderne. Biot avait d’ailleurs indiqué à Pasteur l’utilité décisive d’une communication efficace en direction de la communauté scientifique. Ce dernier n’hésite donc pas à se montrer très explicite, par exemple lorsqu’il remet à l’Académie des sciences, en plus des échantillons des produits obtenus, des modèles en liège plus grands que nature, afin qu’ils puissent bien observer la forme de ces cristaux.
UN CHAMPION DES PROCÉDÉS ÉCLAIRANTS
Dans un monde parfait, une découverte se suffirait à elle-même. Dans le nôtre, la diffusion de l’innovation et la publicité que le chercheur organise autour d’elle s’avèrent indispensables. En l’occurrence, Pasteur ne fut pas seulement un maître de l’observation, virtuose de la manipulation des pipettes et des ballons, concepteur de dispositifs isolant les multiples paramètres, il a aussi parfaitement compris la complémentarité du faire-savoir et du savoir-faire, autrement dit la nécessité d’une mise en scène spectaculaire pour convaincre. Il se fait le champion des procédés éclairants, censés entraîner la conviction, en éliminant les éléments parasites, qui gênent la clarté de la mise en évidence.
La carrière de Pasteur n’est donc pas seulement jalonnée de découvertes majeures dans des domaines de plus en plus éloignés de ses premières amours pour la chimie, elle est aussi ponctuée de controverses retentissantes, attirant l’attention d’un public croissant. En 1862, il croise ainsi le fer avec Félix-Archimède Pouchet au sujet de l’origine des microbes, une question très controversée depuis plusieurs siècles. À partir d’une décoction de foin bouilli, Pouchet défend la génération spontanée, c’est-à-dire l’apparition de nouveaux êtres vivants microscopiques, sans parents. Pasteur ne nie pas la génération spontanée, mais réfute les preuves apportées par Pouchet en démontrant que ses échantillons sont contaminés : les microbes se sont introduits dans le ballon stérilisé à l’insu de l’expérimentateur.
La propre démonstration publique de Pasteur, qui l’entraîne des caves de l’École normale supérieure à la station du Montenvers, surplombant la mer de Glace au pied du mont Blanc, n’apparaît cependant pas entièrement concluante. Qu’importe ! Il prouve l’efficacité de la méthode de stérilisation qui porte son nom, la pasteurisation. Certaines de ses décoctions, conservées jusqu’à nos jours, restent intactes plus de cent cinquante ans après leur mise en ballon. Le chimiste bénéficie alors de l’appui des milieux conservateurs, adossés à la puissante Église catholique, qui jouit de l’alliance du sabre et du goupillon, contractée avec le gouvernement autoritaire de Napoléon III. Hommes d’Église et dirigeants politiques regardent en effet d’un mauvais œil ces partisans de la génération spontanée, une doctrine aux relents matérialistes – accusation dont cependant Pouchet se défend et qui laisse Pasteur indifférent. Le soutien des milieux influents peut se révéler crucial.
MOBILISER POUR LE BIEN COMMUN
Dès les années 1850, Pasteur répond en effet aux sollicitations du gouvernement impérial, ce qui le conduit notamment à élucider le mystère des maladies du ver à soie. Jean-Baptiste Dumas lui confie, en 1865, ce dossier en désespoir de cause et en lui fournissant un prétexte pour se défausser en cas d’échec : il ignore tout de ces insectes, de leur physiologie et de leurs maladies. Non seulement Pasteur ne se récuse pas, mais il mène ses recherches jusqu’au bout, y compris après son premier accident vasculaire cérébral, qui le handicape du bras et de la jambe, ce qui devait le pénaliser jusqu’à la fin de ses jours. Il fournit diverses preuves de l’efficacité de sa méthode de sélection des souches saines à partir des adultes reproducteurs, sur lesquels il est beaucoup plus facile d’observer une éventuelle contamination que sur leurs œufs.
À la tête d’une véritable messagerie, à laquelle contribue notamment Mme Pasteur, le maître n’hésite pas à multiplier les demandes d’information les plus diverses, qu’il envoie aux maires, membres des sociétés d’agriculture et des comices agricoles, enseignants et savants vivant dans les départements où l’on pratique l’élevage des vers à soie, de même d’ailleurs qu’il est sollicité par les éleveurs ainsi que les directeurs d’établissements pilotes. C’est un ensemble permanent de correspondances incluant conseils, prévisions et résultats d’expérience dans un sens, descriptions des chambrées, chiffres de production, œufs et papillons adultes conservés dans des cornets en papier de l’autre. À la fin de ses études sur le ver à soie, Pasteur demande d’ailleurs que ses correspondants les plus assidus, investis avec lui dans ce réseau d’information indispensable à ses recherches, soient récompensés par la Légion d’honneur.
Pasteur réussit à faire inscrire la recherche au budget de l’État français
En réclamant systématiquement des fonds, en exigeant la transformation des locaux dont il avait besoin, en utilisant le levier d’un nationalisme intransigeant, Pasteur réussit à faire inscrire la recherche au budget de l’État français, d’abord sous le Second Empire, puis de manière encore plus nette sous la IIIe République. Par ses appuis à la cour impériale, ses démonstrations faites directement devant Napoléon III et Eugénie, ainsi que ses contacts avec les services ministériels, Pasteur montre un souci constant pour la sécurité financière et matérielle des chercheurs, condition indispensable à la poursuite sereine de recherches de qualité. Le statut d’agrégé-préparateur, ses contributions à la Société des amis des sciences – qui offre de l’argent aux familles des savants pauvres après leur décès –, la création de chaires universitaires témoignent de son attachement au déploiement d’une politique scientifique digne de la longue tradition française d’encadrement public de la recherche.
UN SENS DU SPECTACULAIRE
Pasteur n’a pas toujours raison en tout point, mais il sait mettre en avant ses apports, et il le fait de manière spectaculaire. Ainsi, lorsqu’il s’oppose, en 1878-1879, à Marcelin Berthelot au sujet de la fermentation des grains de raisin, que leur ami Claude Bernard, l’immense physiologiste récemment disparu, croyait encore possible par la seule pulpe du fruit. Avec quarante flacons stérilisés, Pasteur organise une démonstration spectaculaire du fait que le ferment ne se trouve pas dans la pulpe, mais bien à la surface du raisin quand il pousse à l’air libre. Son confrère chimiste Edmond Frémy réplique néanmoins que ses expériences ne seraient pas valides, car de petites quantités seraient insuffisantes pour déclencher la fermentation. Pasteur lui apporte alors des ballons miniatures, dont il brise le col publiquement afin que chacun puisse constater la fermentation qui s’ensuit. Et quand son collègue maintient ses doutes au sujet de la conservation des aliments par la pasteurisation, Pasteur procède à une dégustation publique le 19 février 1872, après un maintien de douze jours du produit à une température comprise entre 28 et 30 degrés. Comme l’indiquent les Comptes rendus de l’Académie des sciences, Frémy « s’est trouvé dans la nécessité de déclarer qu’il n’était pas du tout altéré ».
Pasteur se distingue donc dans l’art de convaincre, grâce à un talent certain de polémiste. Il provoque ses adversaires, les contraint à se soumettre et réussit à amener les hommes et les institutions, scientifiques et politiques, à souscrire à ses vues avec une force et une détermination qui confinent souvent à l’obstination.
Pasteur recourt alors à des démonstrations publiques dont le caractère impressionnant n’échappe pas à la grande presse. Le bouillant Pasteur relève le défi qui consiste à rendre des moutons résistants à la maladie charbonneuse (anthrax) grâce à la vaccination. À Pouilly-le-Fort, non loin de Melun, il se rend ainsi, à plusieurs jours d’intervalle, dans une ferme où se précipitent une centaine de personnes, paysans, dirigeants politiques, responsables de la Société d’agriculture, journalistes et vétérinaires. « Hommes de peu de foi ! » leur lance Pasteur en jouant les prophètes, alors même qu’il connaissait les affres du doute à peine quelques heures auparavant ! Mais l’essentiel est bien que la démonstration rencontre un franc succès : aucun des animaux immunisés ne contracte le charbon bien qu’on leur ait inoculé le bacille, tandis que les bêtes non vaccinées tombent comme des mouches.
SAVOIR S’ENTOURER D’ALLIÉS
Selon Anne-Marie Moulin, le plus grand succès de Pasteur fut, en général, d’avoir su recruter ses adjoints, les premiers pastoriens. Il les a sélectionnés au mérite, y compris son neveu, Adrien Loir, et les a entraînés, tout en les laissant maîtres de conduire leurs propres lignes de recherche. À plusieurs reprises, ses élèves sont restés solidaires de Pasteur, en particulier lorsqu’il s’est retrouvé en difficulté, en raison de la maladie, des erreurs commises ou de la concurrence d’autres savants. Le grand homme n’est donc pas un individu isolé, mais plutôt celui qui parvient à entraîner les autres, et surtout les meilleurs.
Il lui faut d’ailleurs s’appuyer sur des groupes motivés, capables de produire un effet de levier au sein des milieux que ses découvertes bousculent. Tel est le cas des hygiénistes, ces adeptes de l’origine externe des maladies, qui préexistent largement à Pasteur, comme l’a montré notamment le philosophe et sociologue des sciences Bruno Latour. Adeptes de l’hygiène publique, ils luttent d’abord contre les maladies par l’assainissement du cadre de vie, en prônant, par exemple, la création d’égouts. La théorie de l’origine microbienne des maladies les séduit en grand nombre. Bien que dispersés, ces hygiénistes ont déjà réalisé des percées remarquables, comme l’utilisation systématique des antiseptiques promue par l’Écossais Joseph Lister. Mais Pasteur les unifie et leur fournit de quoi révolutionner la pratique médicale en apportant les preuves décisives en faveur de la théorie des germes et de leur contagiosité, ainsi que des statistiques suffisamment convaincantes pour dépasser l’opposition de ses adversaires. Ce n’est pas un apport secondaire ou superficiel, car, en science, la démarche de prouver se révèle souvent plus longue, plus difficile, et finalement plus importante que le fait de trouver.
Pourquoi les médecins lui restent-ils si longtemps opposés ? Leurs intérêts ne se conforment pas à ceux du savant chimiste, qui n’a aucune expérience dans le domaine de la clinique. Après 1885, les praticiens se sentent dépossédés par la vaccination, car les maladies qu’elle combat ne donnent pas lieu à des traitements qu’ils peuvent administrer. L’analyse se fait en laboratoire et le vaccin est détenu par les associés de Pasteur. Non seulement les médecins ne gagnent rien dans le cas des progrès enregistrés par Pasteur, mais ils perdent des clients. Ils insistent donc sur quelques données douteuses, certaines limites de la méthode, des erreurs qu’ils croient détecter dans des travaux qui impressionnent par la rigueur de l’argumentation et la précision chiffrée des résultats.
Pourquoi Pasteur n’a-t-il pas cherché à convaincre les médecins ? A-t-il besoin d’opposants sérieux afin de mieux mettre en avant la nouveauté de ses apports ? En fait, il a plutôt partagé les médecins en deux groupes, car certains n’hésitent pas à le suivre, tels Alfred Vulpian et Joseph Grancher, qui se chargent d’administrer la vaccination contre la rage – Pasteur s’en abstient, n’ayant pas prêté le serment d’Hippocrate. Ils sont en moyenne plus jeunes, plus ambitieux et souvent impliqués dans les comités d’hygiène. Car la profession n’est pas uniforme, loin de là. Et ce n’est donc pas une opposition franche et nette qu’affronte Pasteur, comme le montre son élection à l’Académie de médecine en 1873 : les praticiens se trouvaient déjà divisés quant à la théorie des germes et à ses applications. Il ne faut d’ailleurs pas sous-estimer les oppositions qui existent aussi chez les vétérinaires comme chez les chirurgiens, souvent réticents face à l’antisepsie et à l’asepsie. Chez les professionnels de la santé, la ligne de partage sépare donc moins ouverture d’esprit et obscurantisme qu’enjeux économiques et scientifiques.
LA BATAILLE DE L’OPINION
La presse constitue un terrain d’affrontement entre les pastoriens et leurs adversaires. Les principaux journaux profitent du parfum de scandale qui se dégage des critiques à l’encontre des travaux de Pasteur, en utilisant le surcroît de notoriété que lui a conféré la sensationnelle publicité orchestrée autour de ses « cobayes » pour la vaccination humaine, Joseph Meister et Jean-Baptiste Jupille. Afin de paraître objectifs, alors qu’ils s’en tiennent à une frileuse neutralité, des périodiques tels que Le Moniteur scientifique ou Cosmos ouvrent leurs colonnes à ses opposants qui accusent le vaccin de ne « guérir » que des victimes qui n’étaient pas contaminées, tandis qu’il aurait de terribles effets secondaires. En manipulant les chiffres, ils considèrent qu’il n’aurait pas diminué la mortalité contre la rage, ce qui conduit Pasteur à une analyse statistique serrée. Même stériles, les polémiques font vendre du papier…
Pasteur semble alors châtié par là où il a péché, ayant été le premier metteur en scène de ses idées, afin d’attirer soutiens, financements et gloire. En tout cas, ce battage médiatique s’avère finalement profitable, car le public fait confiance à ce vieux savant qui ne paie pas de mine, habillé sobrement, et qui n’hésite jamais à encourager les jeunes… sans cesser de rabrouer les autres ! Pasteur sait jouer les héros, fait vibrer la corde nationaliste, tout en activant ses réseaux à l’étranger.
Pour bousculer les lignes, le découvreur ne doit pas seulement se faire entendre, en criant à pleins poumons, il doit encore entraîner des alliés, nombreux et puissants, qui trouvent leur intérêt dans la mise en avant ou l’exploitation de la découverte. S’il y parvient, il devient alors un porte-parole et un symbole de la cause qu’il défend. Pasteur a inscrit le mythe au cœur de son action, construisant patiemment sa réalité et l’image de cette réalité.
« Le Covid résume l’apport de Pasteur : hygiène et vaccination »
Annick Perrot
« Pasteur a été précurseur de bien des façons. » La conservatrice honoraire du musée Pasteur brosse le portrait d’un homme audacieux, qui, le premier, sut s’entourer des meilleurs savants, français comme étrangers, pensa à croiser les disciplines, veilla aux retombées industrielles de ses inventi…
Derrière la légende
Jean-Marc Cavaillon
Dans la notice nécrologique du savant paru en 1895, le journal américain Science écrivait : « Pasteur est considéré comme le père de la bactériologie moderne, mais il faut se rappeler qu’il n’était pas un pionnier dans ces domaines. Il n’y avait guère de problèmes qu’il étudiait qui n’ai…
Les grandes heures de poster
Claire Martha
1. Les premiers pas
En 1848, Pasteur, étudie des molécules de tartrate présentes dans les grains de raisin et s’interroge : comment ces molécules chimiquement identiques (des atomes de carbone, d’hydrogène et d’oxygène) peuvent-elles avoir des effets différents sur la l…