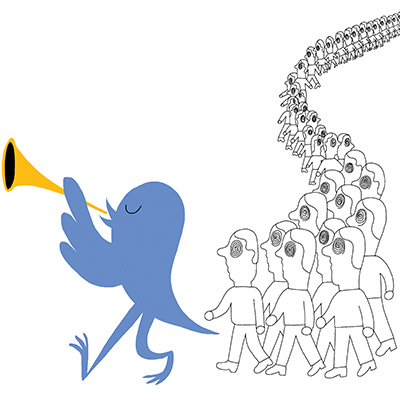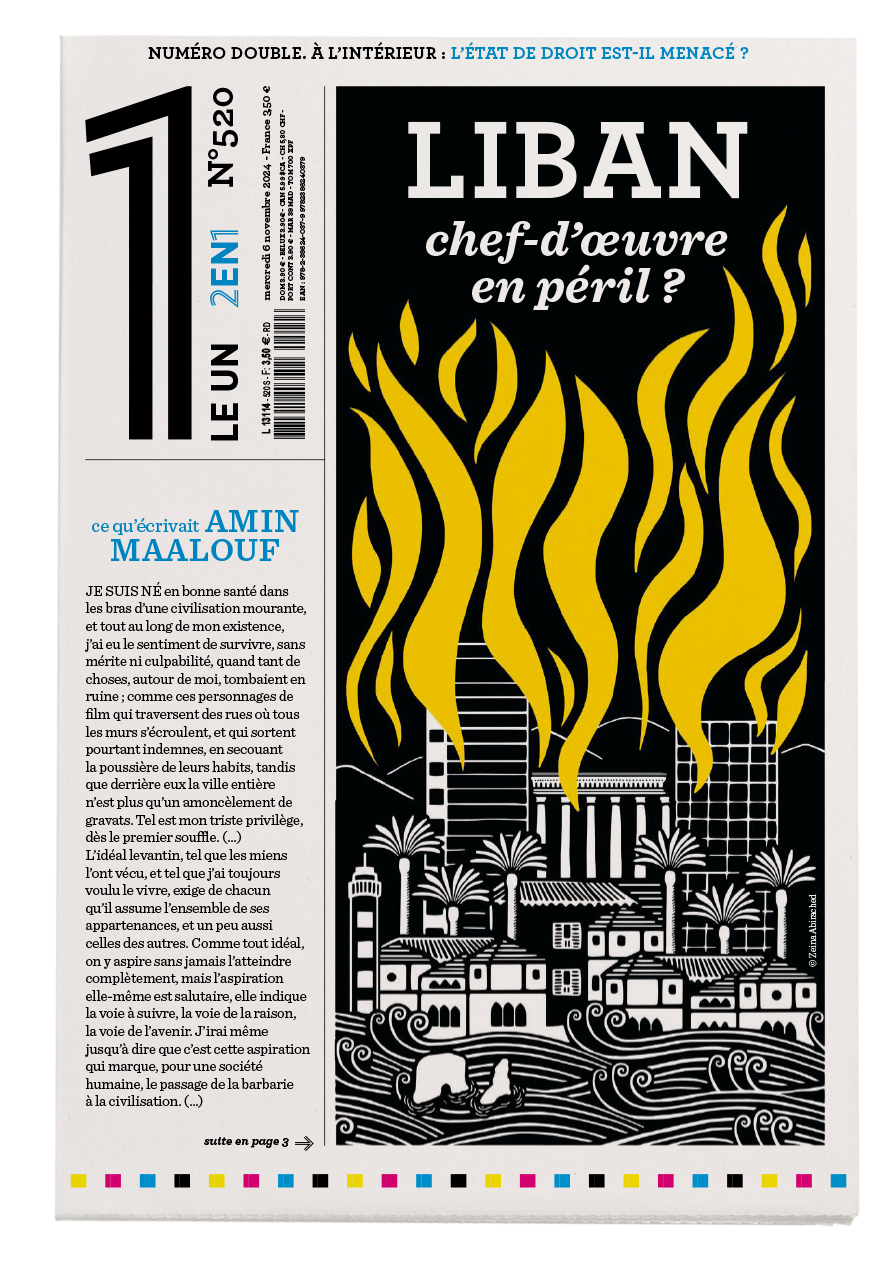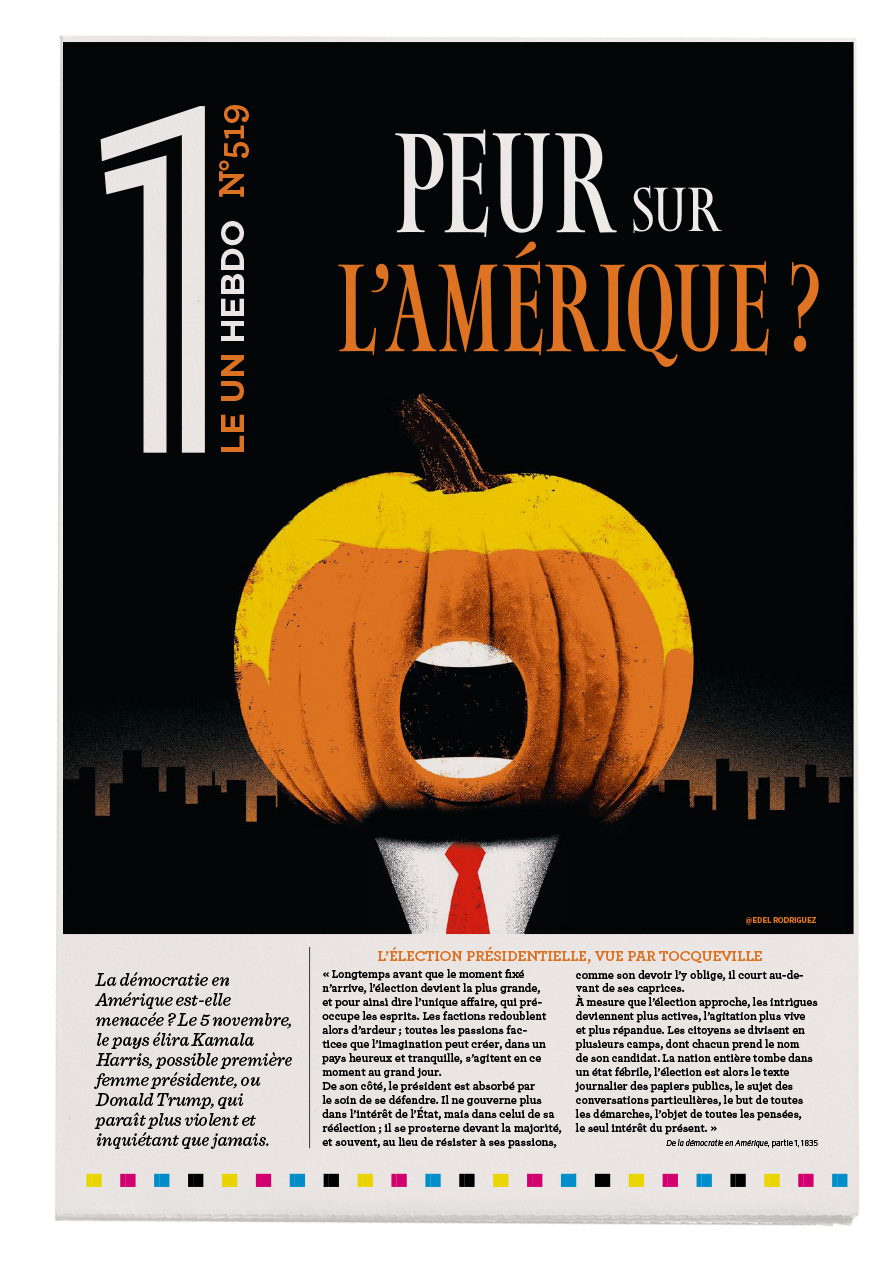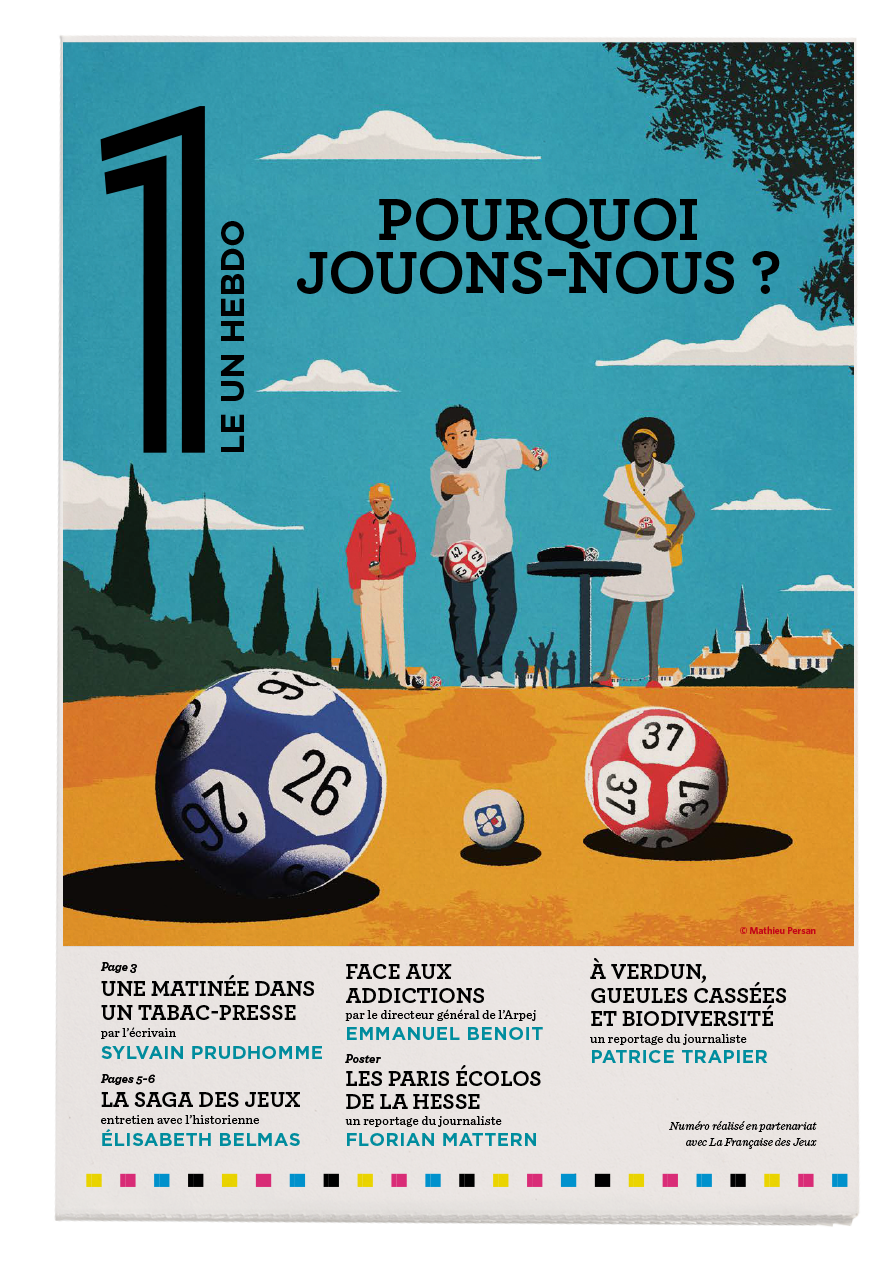« On pourrait imaginer un contre-pouvoir citoyen aux gafam »
Temps de lecture : 12 minutes
Pourquoi a-t-on eu foi dans ce que vous appelez la démocratie directe des réseaux sociaux ?
En 2010, grâce à ces plateformes, le Web devenait accessible à tous. Puis on a assisté aux premiers usages démocratiques des réseaux sociaux avec les Printemps arabes. On s’est dit que la technologie nuisait aux dictatures car l’information pouvait circuler sans censure. On était aussi dans un paradigme général de positivisme par rapport à la technologie, qu’on vivait comme émancipatrice par essence. C’était aussi le discours des Gafam. Longtemps, le slogan de Google fut « Don’t be evil » : « Ne soyez pas malveillants ». Dans une vision très utopiste, ils se présentaient comme de bons géants sympathiques qui allaient nous aider, même s’ils gagnaient beaucoup d’argent. On n’avait qu’une envie, c’était de travailler pour eux ! C’était une première arnaque des Gafam. Ils ont oublié de dire à ce moment-là ce dont on s’aperçoit aujourd’hui : sur Internet, depuis l’apparition des premiers forums où les gens pouvaient discuter entre eux, la problématique de la modération a toujours été présente. Mais les réseaux sociaux n’ont jamais voulu mettre les mains dedans. Leur position est de dire : nous ne sommes qu’un tuyau, nous sommes pour la liberté d’expression absolue, toute modération est une censure, allez-y, exprimez-vous ! Ce qu’on a pu vivre comme une libération du discours sur un libre marché des idées, on s’aperçoit dix ans après que c’était une grosse erreur de départ. Ou plutôt un choix de business délibéré…
Ce secteur est-il inspiré par l’idéologie libertarienne, qui rejette toute idée de contrôle ?
Je vois une différence d’approche entre Facebook et Twitter. Facebook s’est voulu le réseau des familles. Il a censuré automatiquement tout contenu « adulte », toute nudité, ce que Twitter n’a pas fait. Le choix de l’oiseau bleu était certes mâtiné d’idéologie libertarienne. C’était aussi un bon moyen d’économiser de l’argent sur la modération et d’évacuer ce problème. Si Facebook voulait modérer manuellement les contenus postés sur ses plateformes dans le monde, il lui faudrait 300 000 ou 400 000 modérateurs… Le modèle économique n’y résisterait pas. Facebook pourrait peut-être se le permettre maintenant, mais pas Twitter, avec son esprit de petite start-up californienne et ses faibles effectifs.
Comment a-t-on réalisé que Twitter pouvait être dangereux pour la démocratie ?
Dans la période du tout premier Twitter, entre 2009 et 2011, c’était un réseau sympa entre jeunes geeks, même s’il y avait pourtant déjà des symptômes inquiétants avec les premiers harcèlements.
La présidentielle de 2012 a constitué une deuxième étape. Les militants se rejoignent sur Twitter, et aussi les politiques qui s’en servent pour diffuser des messages de façon plus efficace que par les communiqués de presse habituels, souvent peu repris. De plus en plus de gens influents viennent sur ce réseau et l’utilisent pour communiquer. Le réseau prend une importance considérable et même disproportionnée par rapport à sa taille. Problème : les journalistes sont tous sur Twitter et très peu sur Facebook. On est dans un entre-soi, tout en pensant que Twitter est une petite France. Or non, c’est juste une France particulière, avec beaucoup de CSP +.
Une autre étape sera la prise de conscience par la presse et les politiques que ce qui se passe sur Twitter est intéressant et qu’on doit en parler. En 2018, une fille et son père se retrouvent en garde à vue après un problème de paiement chez Ikea. La fille lance un thread (une série de messages liés entre eux) sur Twitter : ce simple incident donnera lieu à 27 reprises d’articles. Une lettre aux médias ou un post Facebook n’aurait jamais eu autant d’impact. Durant cette phase, les journalistes suivent Twitter du matin au soir et surcouvrent ce qu’il s’y passe ; ils en font l’alpha et l’oméga de l’information.
« Le réseau prend une importance considérable et même disproportionnée par rapport à sa taille »
Parallèlement, dès 2015, la dimension morale devient prégnante : les phénomènes émotionnels, les injonctions à s’indigner se multiplient. Certains comprennent qu’ils peuvent avoir de l’influence sur Twitter et provoquer des réactions. Les identitaires français sont les plus forts pour monter les choses en épingle et créer des polémiques artificielles. Un fait anecdotique peut venir servir le récit qu’on porte. Souvenons-nous des tweets sur le hijab vendu par Décathlon. La Manif pour tous a su utiliser cette stratégie hors média et hors partis dans une communication directe via les réseaux. La stratégie consiste à inventer un « monstre » à combattre et à créer sur les réseaux sociaux de véritables délires, comme autour de l’ABCD de l’égalité, en 2013, lorsque des rumeurs prétendent que Najat Vallaud-Belkacem, alors ministre des Droits des femmes, veut transformer les petits garçons en petites filles. Sont ainsi apparues des officines qui ont produit en masse des informations faites pour les réseaux sociaux, créant des polémiques à partir de rien.
Quel est le processus de radicalisation des militants ?
Avant, militer consistait à aller distribuer des tracts sur les marchés. Si vous insultiez les gens, ils ne prenaient pas vos tracts… Sur les réseaux, il y a une logique de camps et de guerre, au départ plutôt gentillette : on place son hashtag avant celui de l’autre dans des ripostes parties. Puis cela dégénère avec des armées de trolls organisés. J’ai moi-même vécu de telles attaques, au point que j’ai fini par quitter Twitter. Concrètement, une armée de trolls organisés – qui peuvent par exemple militer pour la République en marche (LREM) – se coordonnent en amont sur des fils Telegram ; ils désignent des cibles et tapent sur un journaliste en l’accusant d’être un militant de l’autre bord. Il est plus facile de le dénigrer que d’aller réfuter le fond de ses arguments. Quand vous faites de la vérification d’infos comme je l’ai fait pendant une décennie, un coup vous vexez des gens de LREM, un autre des soutiens de la France Insoumise, puis des libéraux… À chaque fois, on vous accuse de travailler pour le camp d’en face.
« Tout ce qui est dissonant a du mal à passer. Une pratique d’ostracisme propre aux réseaux sociaux se diffuse »
Il y a aussi une logique d’enfermement bien connue : je ne veux pas accepter de paroles critiques par rapport à mon parti, mon camp, mon mouvement ; je rejette ce qui ne va pas dans mon sens. Sur Twitter, on s’abonne à des comptes de personnes dont on est proche. On crée notre petite bulle de filtres. Tout ce qui est dissonant a du mal à passer. Une pratique d’ostracisme propre aux réseaux sociaux se diffuse. Prenez Valeurs actuelles : avant, si vous n’aimiez pas ce magazine, vous ne l’achetiez pas ; vous n’alliez pas vous planter devant un kiosque en criant au scandale. Avec les réseaux, vous allez relayer sa couverture pour vous en indigner auprès de votre lectorat qui ne l’aime pas non plus. Vous lui ferez de la pub et contribuerez à lui donner une aura de projection, une existence. Ça n’a aucun intérêt. Mais cela permet de se renforcer soi-même dans le sentiment de partager avec ses amis de hautes valeurs éthiques et morales. C’est potentiellement dangereux pour la démocratie, car on a de plus en plus de mal à débattre posément.
Les politiques ont toujours manipulé l’opinion. Qu’apportent de nouveau ces plateformes ?
C’est vrai. Mais aujourd’hui, face à des canaux d’informations moins généralistes, la culture de la vérification est une nécessité encore plus prégnante. Les politiques développent une tendance à cultiver leur propre réalité, comme Trump l’a fait jusqu’à la folie. Les réseaux sociaux permettent d’aller très loin en cédant à la tentation de raconter les choses à sa propre manière, surtout avec l’appui d’armées de trolls. Dans le cadre de l’affaire Benalla, les organisations de LREM se sont servies de tels groupes pour relayer un faux message fabriqué à l’Élysée, une fausse vidéo et un montage, laissant croire que les gens sur qui Benalla avait tapé n’étaient pas si innocents. On fabrique ainsi une fausse preuve qu’on fait diffuser par son camp et ses militants.
Dans votre ouvrage, vous citez le philosophe des sciences Karl Popper : « La société qui offre une tolérance sans limite risque d’être détruite par l’intolérant. » Comment limiter les dangers des Gafam ?
Les réseaux sont dans le paysage et il est inenvisageable demain de les supprimer. Ils seront toujours là. À eux de répondre à cette question. Ce qui s’est passé aux États-Unis, j’ose l’espérer, amènera des réflexions. Même si la forme même de Twitter, l’immédiateté, la brièveté, pousse à l’excès. Il y a eu des expérimentations pour laisser un délai de trois minutes entre le moment où vous tapez votre tweet et le moment où il est envoyé, pour éventuellement l’annuler ou le modifier. Mais un tel système casserait la machine. Twitter a intérêt à ces emballements. Ça fait de l’audience, de l’engagement, donc du profit, avec des utilisateurs qui restent des heures sur la plateforme et à qui on peut diffuser des pubs. C’est le modèle économique. Notre erreur de base a été de croire qu’il s’agissait de philanthropes alors que nous sommes face à des entreprises. Le trash est préférable au tiède. Une première solution serait d’amener un peu de modération et de sagesse dans la manière dont on se comporte nous-mêmes sur ces réseaux. Ce serait un début, avant de demander aux masses anonymes de le faire. Si les journalistes, les politiques, les communicants, les professionnels de la parole, tous ceux qui, dans une société, sont censés porter les discours et nourrir le débat public démocratique, prenaient conscience qu’ils sont devenus prisonniers du monstre que Twitter est devenu, avec son lot de surenchères et de réactions permanentes, alors on pourrait se policer. Et aussi aller voir ailleurs.
Ailleurs ?
Oui. Comment a-t-on pu rater les Gilets jaunes ? On était obsédés par Twitter et on a délaissé les autres réseaux sociaux. Les Gilets jaunes étaient sur Facebook… Ils étaient visibles, il suffisait de s’y intéresser. Mais personne ne l’a fait…
Qu’avez-vous pensé de la fermeture du compte Twitter de Donald Trump, que vous qualifiez de « président troll » ?
Chacun a mesuré combien ce réseau avait joué un rôle central pendant quatre ans, en diffusant les messages de l’homme le plus puissant du monde. Une étude a montré que la désinformation avait globalement baissé aux États-Unis suite à la suppression de son compte ! Mais cela pose la vraie question de la place de ce réseau que personne n’a élu. Les dirigeants de Twitter ont eu un double discours. Des années durant c’était : on ne supprime pas son compte, c’est le président, il dit ce qu’il veut. Puis, au cours des derniers mois ils ont signalé que ce qu’il affirmait était faux à chacun de ses tweets. Twitter n’a jamais voulu se préoccuper de modération, jusqu’à en arriver à ce point extrême de supprimer le compte du président américain. Dans la foulée, des comptes de l’alt-right sont partis sur des réseaux alternatifs comme Parler. Cela soulève une autre question : vaut-il mieux que ces gens soient aux marges d’Internet, dans leur petit monde à eux, et qu’ils polluent moins le canal central.
« Notre erreur de base a été de croire qu’il s’agissait de philanthropes alors que nous sommes face à des entreprises »
Sommes-nous impuissants ?
On pourrait imaginer une utopie : un contre-pouvoir citoyen aux Gafam, avec des représentants citoyens élus pour poser des questions éthiques, auxquelles ces entreprises répondraient, mais y auraient-elles intérêt ? Après l’élection de Trump, Google et Facebook sont venus taper à la porte des fact-checkers du monde entier pour demander ce qu’on pouvait faire contre la désinformation. Mais ces actions avaient leurs limites, assez fortes. Facebook a mis en place des programmes de vérification des infos, mais les contenus des publicités politiques n’étaient pas concernés. Ce que la plateforme nous donne à vérifier reste dépendant d’un algorithme secret dont on n’a pas la clé. On ignore sur quel critère une information passe ou non. De son côté Google tâtonne. On voit que les plateformes sont sur un fil ténu, car elles n’ont jamais réfléchi à la question de la liberté d’expression, à ce qu’il est bon d’autoriser et à ce qui ne l’est pas, et sur quelle base. Après la suppression du compte de Trump, on a vu les réactions en chaîne d’autres Gafam, qui se sont mis à supprimer beaucoup de contenus de la mouvance conspirationniste QAnon. Sur quels critères ? Si Google avait voulu, il aurait pu le faire bien avant vu sa puissance algorithmique. On peut rêver : un parlement mondial des Gafam aurait une utilité.
Reste la question de ce que veulent les citoyens. Ces contenus sont aussi recherchés…
En effet, ils ne viennent pas de nulle part. Si les gens se ruent vers des infos complotistes à longueur de temps, c’est qu’ils ne se reconnaissent plus dans les modèles capitalistiques et démocratiques. Ils cherchent des réponses. Le rêve des tenants de QAnon, c’est, une fois tous les méchants « tués », de pouvoir donner de l’argent au peuple. L’idéologie de ce mouvement est sous-tendue par une forme de populisme, aider ceux d’en bas.
« Il y a comme une course à l’armement sur ces réseaux sociaux »
Il y a un capitalisme qui peine à comprendre qu’il repose sur la démocratie. Se pose à nous le problème de la confiance dans les élites. Les réseaux sociaux accentuent l’horizontalisation de nos sociétés et de l’information. La réponse ne peut pas prendre la forme du surplomb et du mépris. C’est ce que j’ai appris en dix ans de vérifications. Ce n’est pas en traitant les gens de débiles qu’on avance, car ils existent et on ne peut les empêcher de penser ce qu’ils pensent. L’enjeu est de parvenir à les convaincre. De leur fournir des discours positifs dans lesquels ils se retrouvent. Ils ne se reconnaissent pas dans les discours dominants.
Comment les ramener dans un chemin de rationalité ?
Je n’ai pas de réponse. Comme dans le cas des gens qui sont entrés dans une secte, il est très dur d’arriver à se dire qu’on a été abusé par des fausses infos auxquelles on a cru dur comme fer pendant des années. C’est un travail individuel, courageux et difficile. Avec QAnon, on voit des gens se couper de leur famille, de leurs enfants. Ça va très loin. Cela détruit jusqu’aux cellules familiales. Si des parents proches ne parviennent pas à les convaincre qu’ils font fausse route, qui le peut ? Les réseaux sont là pour rester. La question demeure : comment éviter de vivre dans un monde où chacun sera dans sa réalité, dans son couloir.
Ce n’est pas rassurant, dans la perspective de la présidentielle de 2022.
Le scénario redouté de voir émerger un personnage à la Trump est totalement possible. Il y a une déception générale à l’égard de la classe politique qui n’arrive pas à se réinventer, que le Covid a mise à genoux, le spectre d’une dette monstrueuse et pas grand-chose à promettre sinon l’austérité. Dans ce contexte, un personnage issu des réseaux ou qui saurait s’en servir pourrait émerger. Le côté démocratie directe favorise l’irruption en permanence de la surprise politique – voyez l’affaire Griveaux. On ne sait jamais de quoi demain sera fait. Une fuite de données opportune peut compromettre tel ou tel favori. Cela a failli arriver à Macron en 2017, avec les Macronleaks, mais ils sont sortis trop tard et il n’y avait pas grand-chose dedans. Dans le cas de Hillary Clinton, en revanche, les fuites relatives à ses e-mails ont permis de construire un récit qui a avantagé Trump. Il y a comme une course à l’armement sur ces réseaux sociaux. Quand vous êtes le parti au pouvoir, il est logique d’entretenir une armée de trolls. Si tout le monde en a une sauf vous, vous pouvez craindre d’être écrasé. Les réseaux auront un rôle en 2022. Qui feront-ils émerger ? Impossible de le savoir.
Propos recueillis par E.F.
« Le militantisme de clavier impacte directement le réel »
Tristan Mendès France
« L’essentiel de l’info à laquelle nous sommes exposés est phagocyté par des militants souvent extrémistes. » Il existe un déséquilibre fondamental entre l’info standard, équilibrée, et tous les contenus fortement idéologisés, qui ont leurs soldats prêts à les imposer. » Pour le spécialiste du nu…
[Algorithmes]
Robert Solé
OÙ sont-ils, ces fichus algorithmes qu’utilisent Google, Amazon et compagnie pour nous prendre dans leurs filets ? Rien ne sert de soulever le capot de l’ordinateur : il n’y a rien à voir, et …
Sans démocratie, pas de GAFAM !
Aurélie Jean
Le récent bannissement de Trump de Twitter serait-il le symbole de la chute démocratique dans laquelle nous entraîneraient les réseaux sociaux ? La réalité est bien plus complexe. Sans revenir…