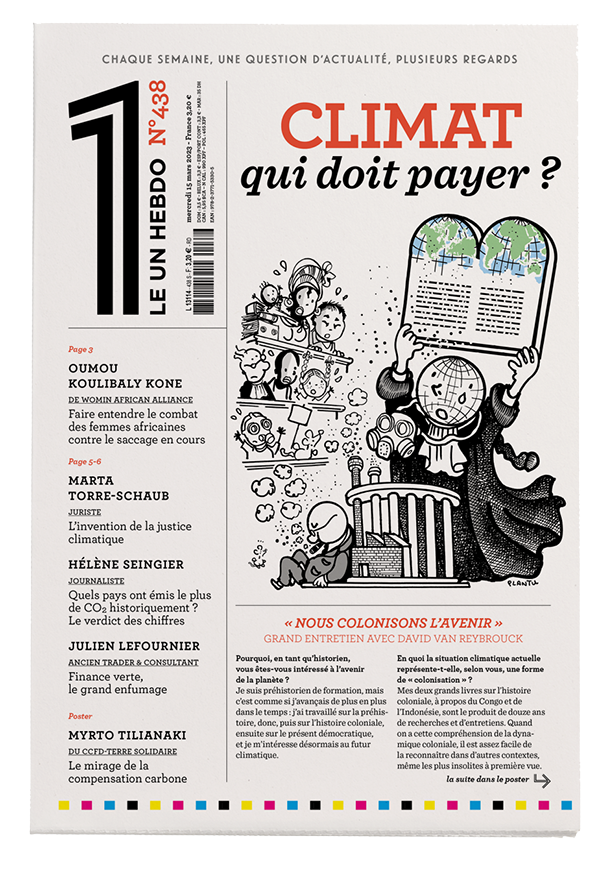Une révolution judiciaire mondiale se produit sous nos yeux
Temps de lecture : 7 minutes
La justice climatique est un champ du droit encore en chantier : les conventions internationales sont rares, les outils globaux de compensation ou de réparation inexistants et les liens de cause à effet délicats à établir – l’atmosphère de la Terre étant la même pour toute l’humanité, qui blâmer pour le changement climatique qui entraîne la submersion de tel archipel du Pacifique ou le méga-incendie de telle forêt en Australie ?
On pourrait être tenté de faire un parallèle avec d’autres domaines du droit de l’environnement qui concernent eux aussi des espaces ou des biens communs de l’humanité comme la haute mer, la couche d’ozone ou la biodiversité. Mais le système climatique est encore différent car il relève de l’atmosphère, matière par définition diffuse, globale et planétaire.
Des individus, assujettis aux modifications d’un milieu qu’ils n’ont pas provoquées, subissent une dégradation de leurs conditions de vie.
Pourtant, le secteur est en ébullition. Le mouvement de la justice climatique, né au début des années 2000, demande aux États de prendre leurs responsabilités face aux risques et dommages encourus par la population qui ont leur origine dans le changement climatique.
Ce mouvement s’inscrit dans la lutte pour la justice environnementale : des individus, assujettis aux modifications d’un milieu qu’ils n’ont pas provoquées, subissent une dégradation de leurs conditions de vie. Pour certains de ces groupes vulnérables, c’est même leurs droits humains qui ne sont plus respectés.
Le juge mobilisé par la question climatique
De l’Inde à l’Australie, du Pakistan à la Colombie, des Pays-Bas aux États-Unis : les litiges ayant pour objet le changement climatique et l’établissement des responsabilités de certains acteurs dans ce phénomène se multiplient dans le monde. Cet « activisme » judiciaire révolutionne les modalités d’action, qui se réduisaient jusqu’ici aux négociations internationales dans le cadre des Nations unies – les fameuses COP.
Au total, dans le monde, plus de 1 500 procès climatiques ont été comptabilisés par l’ONU. On peut citer le cas de cet agriculteur du Pakistan qui a saisi la justice en 2015 pour demander à l’État de protéger tous les citoyens ainsi que les générations futures contre les effets du changement climatique. La même année, aux Pays-Bas, 900 citoyens se sont unis, aux côtés de l’ONG Urgenda, pour réclamer à l’État de prendre soin d’eux et de faire le nécessaire pour assurer leur survie. Le tribunal, par trois fois, a exigé que soient menées des politiques climatiques plus ambitieuses. En Inde, en Afrique du Sud, en Autriche, l’urgence climatique est désormais portée devant les juges. Une révolution judiciaire mondiale est en train de se produire sous nos yeux.

Certaines de ces initiatives ont connu un succès remarquable. Au Royaume-Uni, en 2020, la justice a annulé le projet d’extension du grand aéroport de Heathrow parce qu’il ne tenait pas compte de l’accord de Paris. L’année suivante, l’Allemagne enregistrait une décision historique de la Cour fédérale constitutionnelle, selon laquelle le législateur doit protéger les « générations futures » en rédigeant une loi climatique qui n’obère pas les capacités de la jeune génération à vivre dans les mêmes conditions que les générations présentes. En France, la commune de Grande-Synthe, située au bord de la Manche, a attaqué l’État car elle est menacée de submersion marine. Le Conseil d’État a reconnu, en 2020 et en 2021, que les dispositifs normatifs français de lutte contre le changement climatique étaient contraignants pour l’État. En conséquence, il a intimé à celui-ci de prendre des mesures plus fortes en faveur de la neutralité carbone.
En France, c’est la société Total qui fait face à trois procès, notamment pour les impacts de ses activités en Ouganda
Les entreprises pétrolières se trouvent, elles aussi, dans le collimateur de cette nouvelle justice. Aux Pays-Bas, en 2021, une ONG a fait traduire la société Shell devant le tribunal pour ne pas avoir respecté son « devoir de diligence » dans la conduite de ses activités énergétiques. La cour a enjoint au groupe de réduire ses émissions mondiales de gaz à effet de serre de 45 % à horizon 2030, par rapport à 2019. En France, c’est la société Total qui fait face à trois procès, notamment pour les impacts de ses activités en Ouganda.
Des responsabilités élargies
Le champ des responsabilités invoquées par cette justice climatique s’élargit peu à peu. On remarque trois nouveautés ces dernières années. La première consiste à exiger que les États, au nom de leur devoir de protection de la population, répondent désormais de leur inaction ou de la lenteur de leur action en matière climatique. On l’a vu en France avec l’Affaire du siècle ou en Belgique avec l’Affaire climat : les deux États ont été reconnus responsables d’agir trop peu ou de façon négligente.
La deuxième nouveauté est le développement de procès contre des entreprises, non plus pétrolières mais bancaires ou d’investissement. C’est le cas, en France, avec la banque BNP Paribas, que des ONG assignent en justice pour sa « contribution significative aux dérèglements climatiques » : son plan de vigilance lié aux risques climatiques n’a pas été jugé suffisant face à l’ampleur et au périmètre de ses activités d’investissement.
Le troisième élément inédit est la « personnalisation » des actions en justice. Certaines sont lancées par des individus seuls, d’autres visent des personnes précises. Au Royaume-Uni, par exemple, ce sont des dirigeants de la société Shell – et non l’entreprise en tant que personnalité juridique – qui se retrouvent dans le prétoire.
Soulevant des questions de droit international et national, ces litiges démontrent la grande ingéniosité juridique des requérants mais aussi des juges. Ils se fondent sur les constitutions, les lois nationales ou les plans climat, mais aussi sur des engagements internationaux comme l’accord de Paris sur le climat. Les décisions se réfèrent à des notions aussi variées que le « droit à la vie » des individus, le « devoir de vigilance » des entreprises ou encore le « devoir de protection » des États vis-à-vis de leur population.
Autre fait nouveau : la justice supranationale est également mobilisée. Le mois dernier, le Vanuatu, un petit archipel d’Océanie menacé de submersion, a lancé des démarches auprès des Nations unies pour que la Cour internationale de justice clarifie les obligations internationales des États en matière de climat et de droits de l’homme. 150 pays appuient désormais la demande de l’archipel.
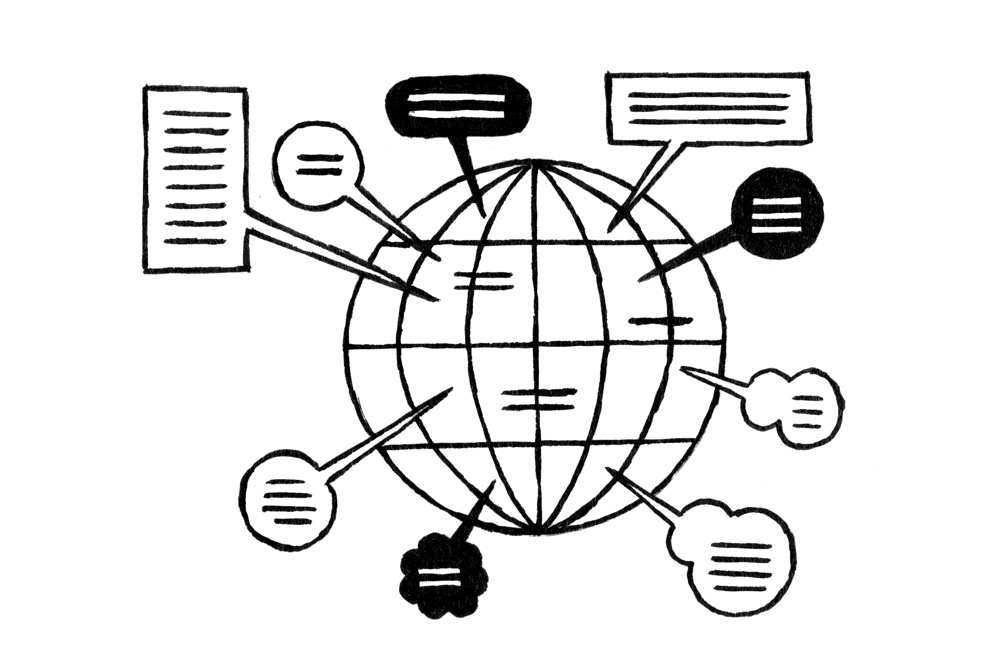
Plus près de nous, la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg a reçu pas moins de six requêtes climatiques. L’une d’elles émane d’un Français, Damien Carême, maire de la commune de Grande-Synthe, qui a obtenu gain de cause devant le Conseil d’État. Il reproche à la France de violer son droit à la vie ainsi que son droit à la vie privée et familiale – notamment le droit à jouir d’un domicile paisible.
Quel bilan pour la justice climatique ?
Les Pays-Bas et la France font partie des pays qui enregistrent le plus de succès pour ces actions en justice. Ailleurs, malgré l’effervescence, les échecs sont nombreux. Cela est dû en partie au manque de maturité des systèmes juridiques face à de telles questions scientifiques et politiques, mais aussi aux lacunes scientifiques des magistrats, liées à leur formation, ou encore aux obstacles « techniques » en matière de preuve et d’expertise.
Mais ces revers ont aussi une dimension politique : aux États-Unis ou en Belgique, des juges ont estimé que la question climatique relevait du pouvoir exécutif et législatif, ou argué de failles juridiques pour éviter de se prononcer sur le fond. Ainsi, dans deux des procès intentés à Total en France, le juge des référés a rejeté les demandes des ONG plaignantes et a appelé le gouvernement à préciser les contours de la loi sur le devoir de vigilance. La question climatique devient hautement sensible, et la justice en est consciente. Si les outils juridiques pour contraindre les différents acteurs publics et privés à honorer leurs obligations existent, encore faut-il les rendre plus lisibles et plus « effectifs ».
Quoi qu’il en soit, ces différents procès peuvent avoir pour effet bénéfique de faire « craquer » les moules traditionnels du droit, encore trop rigides face aux enjeux écologiques d’aujourd’hui. Mais ils sont surtout un extraordinaire levier d’action pour conduire nos sociétés vers une meilleure gouvernance du climat et une transition plus juste.
Illustrations Jochen Gerner
« Un colonialisme qui ne dit pas son nom »
David Van Reybrouck
L’historien et écrivain belge David Van Reybrouck, qui a minutieusement étudié la colonisation du Congo et de l’Indonésie, discerne aujourd’hui des logiques similaires dans l’attitude des pays du Nord à l’égard non seulement des pays du Sud, mais aussi des générations futures. Il appelle à une pr…
[Générations]
Robert Solé
« Vous avez joyeusement saccagé la planète. Vous nous léguez une catastrophe dont les plus grandes victimes seront naturellement les plus pauvres. » Imaginé par Robert Solé, ce dialogue fictif, aux airs de réglement de compte, fait se rencontrer deux générations autour du déréglement climatique.<…
« La compensation carbone est devenue un vrai levier d’inaction »
Myrto Tilianaki
Chargée de plaidoyer au CCFD-Terre solidaire, Myrto Tilianaki dénonce le caractère contre-productif des mécanismes de compensation carbone.