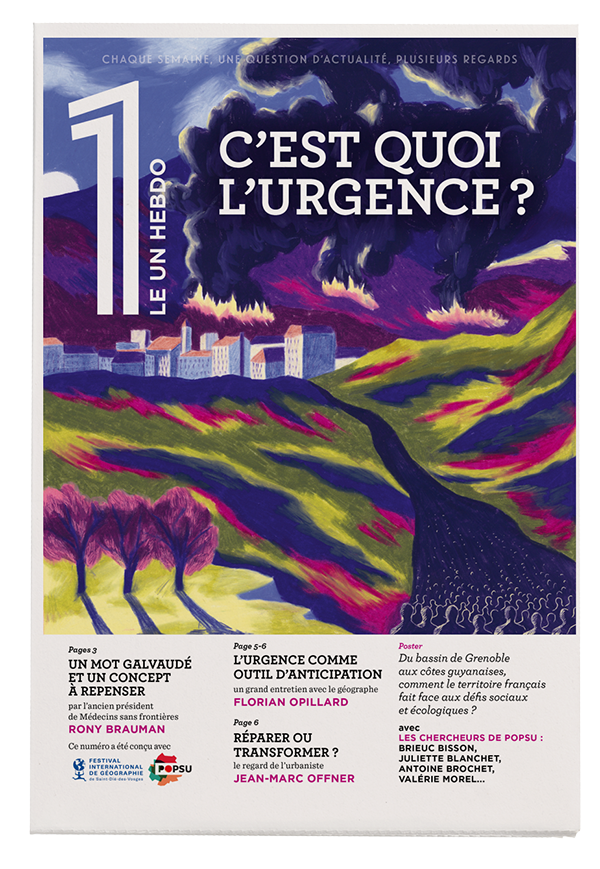Depuis Paris, il faut d’abord voler jusqu’à Cayenne, chef-lieu de la Guyane française. De là, s’engager sur la route nationale 1 qui longe l’Atlantique et filer droit, trois heures durant, vers l’extrême nord-ouest du département, à la frontière avec le Suriname. C’est là, face à l’océan, coincée entre l’embouchure des fleuves Mana et Maroni, que se trouve Awala-Yalimapo. Cette commune rurale d’un peu plus de 1 400 habitants, peu dense – 7 habitants au kilomètre carré –, terre ancestrale des Amérindiens Kali’nas, est en passe de sortir de l’anonymat. Elle pourrait devenir un modèle d’avenir en matière de renouvellement des approches de la gestion côtière.
Grâce au travail des défenseurs des droits des Amérindiens, Awala-Yalimapo bénéficie depuis 1988 du statut spécial de commune autochtone. Sa gestion est assurée par un maire, mais également par deux chefs coutumiers. Contraints d’abandonner la mobilité des lieux de vie par la départementalisation en 1946 et par la planification de l’espace pensée par l’État français pour en fixer les fonctions, les Kali’nas – l’un des sept groupes amérindiens de Guyane – ont dû se sédentariser dans un espace naturellement mouvant.
Résultat de l’activité sédimentaire du fleuve Amazone dont l’embouchure se situe à près d’un millier de kilomètres au sud-est, des bancs de vase vont et viennent au large de la côte guyanaise, provoquant une alternance de phénomènes d’accrétion et d’érosion du trait de côte. Or ce rythme naturel tend à évoluer. Les bancs de vase, moins massifs ou moins présents, ne font plus office de protection et l’érosion progresse de 5 à 8 mètres par an depuis une dizaine d’années. Les tortues luth, habituées à venir pondre sur les plages d’Awala-Yalimapo, ne sont déjà plus en mesure de le faire. Bientôt, les habitants seront, eux aussi, affectés.
Comment s’adapter ? Quelle stratégie de gestion du littoral adopter ? C’est tout l’enjeu auquel fait face cette commune. Une première idée, proposée par le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) et validée par la municipalité, consiste à recharger la plage avec 40 000 mètres cubes de sable. Cette solution très coûteuse – environ 2 millions d’euros – ne peut être que temporaire. Une défense côtière de ce type s’entretient, il faudra recommencer quelques années plus tard. Pour réfléchir à une solution plus durable, une consultation vient d’être lancée auprès des habitants de la commune. Ces derniers ont montré au fil de leur histoire et du renouvellement de l’occupation du site qu’ils ont su s’adapter aux mouvements de la mer grâce à leur habitat léger et mobile et à leur gestion collective de la terre. Leur connaissance précise du territoire, leur capacité d’adaptation d’antan et leurs aspirations de vie devront aider à penser des mesures pertinentes pour leur territoire. L’objectif est de renouer avec la tradition autochtone tout en conservant un ancrage territorial.
Cet exemple d’approche collective de la terre est l’opportunité pour nous, métropolitains, de changer de regard sur « l’habiter ». En France, depuis 2022, existe une liste de 126 communes qui doivent s’adapter de manière prioritaire aux conséquences de l’érosion côtière et respecter des contraintes particulières en matière d’urbanisme. Vingt-cinq d’entre elles sont situées en outre-mer.
Force est de constater que la méthode du « copier-coller » qui vise à élaborer des solutions en métropole pour les appliquer ensuite de la même manière en outre-mer ne fonctionne pas. Et si, pour une fois, l’expertise venait des outre-mer ? En métropole, des constructions pérennes sont encore, en 2023, engagées sur des terrains à risque d’érosion ou de submersion. N’est-il pas temps de repenser notre manière d’habiter nos territoires ? Des initiatives différentes voient le jour, comme les kerterres. Ces petites maisons écologiques construites selon des méthodes ancestrales commencent à apparaître en Bretagne. Encore considérés comme des solutions alternatives, ces logis peu coûteux et respectueux de l’environnement sont pourtant une proposition intéressante pour des personnes qui ne sont plus en mesure d’accéder à la propriété foncière classique. Elles permettraient de repeupler des territoires littoraux devenus des villages touristiques qui ne sont vraiment occupés qu’en période estivale.
Ces enjeux nous invitent à nous interroger au-delà de la gestion foncière elle-même. La question est : comment vivre et habiter ensemble ? Les différentes urgences auxquelles le monde fait face aujourd’hui permettent de refaire territoire. En France, la nécessité d’agir face à l’érosion a principalement été de proposer des solutions techniques. Le cas d’Awala-Yalimapo nous montre que les solutions se trouvent peut-être hors des sentiers battus. Les usagers ont besoin d’être davantage pris en compte dans le projet territorial. L’urbanisation ne doit pas se faire uniquement selon le projet du bâti. Elle doit également tenir compte du milieu, en puisant dans les identités et les savoir-habiter de nos anciens, mais aussi dans la diversité des savoirs du monde entier. S’adapter n’est plus une option, c’est une nécessité.
Propos recueillis par MANON PAULIC