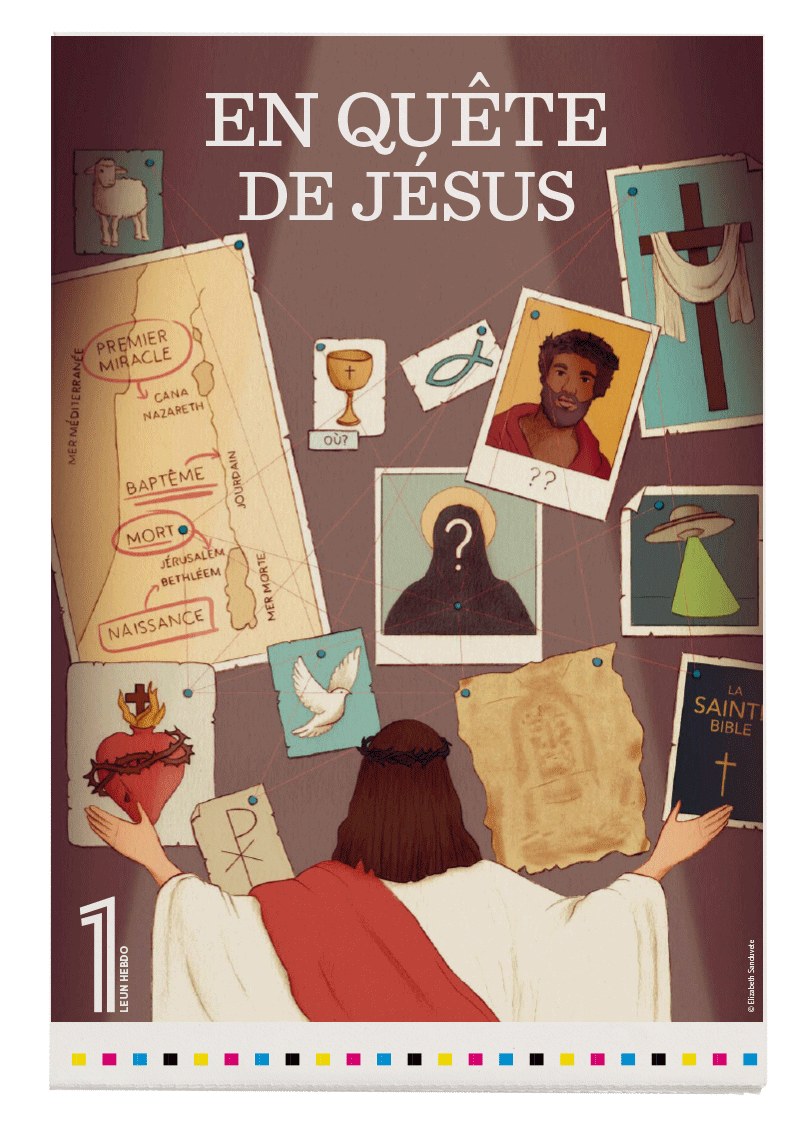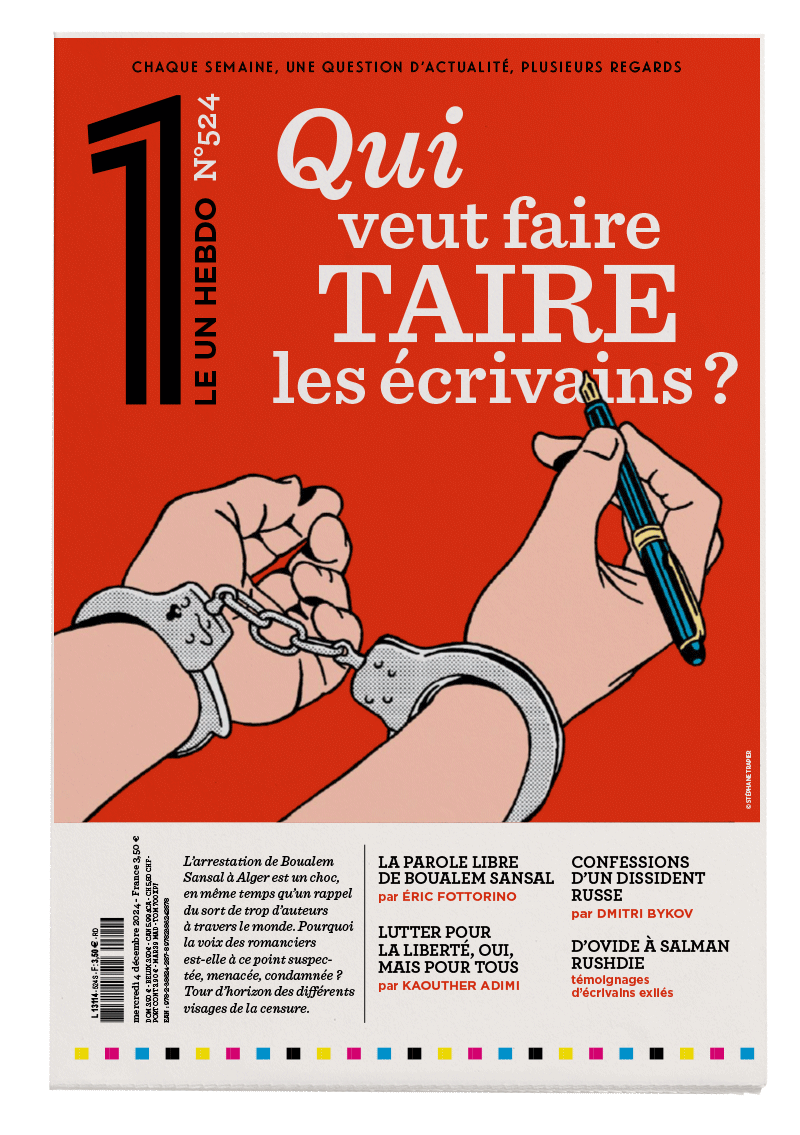Europe centrale : les raisons d’une fronde
Temps de lecture : 7 minutes
Quand le mur de Berlin tombe en 1989, les pays d’Europe centrale deviennent, pour la première fois depuis des siècles, maîtres de leurs relations internationales. Fraîchement indépendants, ils doivent rapidement se placer dans l’espace géopolitique et déterminer la nature de leurs relations avec le reste de l’Europe. Deux tendances se dessinent. D’un côté, la tendance nationaliste : elle se manifeste par exemple en Yougoslavie avec la politique d’expansion et de reconquête des Serbes sous la direction de Milošević, qui débouche sur une guerre meurtrière. De l’autre côté, la tendance pro-européenne, axée sur la coopération et la réunification de l’Europe.
Ce mouvement, inspiré par les intellectuels polonais de la revue dissidente Kultura, prônait depuis les années soixante le rapprochement entre l’Europe centrale et les pays de l’Ouest et la reconnaissance des frontières telles qu’elles ont été fixées en 1945. Il s’agissait d’enterrer les conflits ancestraux, de collaborer avec les nouveaux voisins et de créer une association qui permettrait, d’une part, de se protéger contre la Russie et, d’autre part, de contribuer à la construction européenne. Cette « politique orientale » a prédominé en Europe centrale, tout au long des années 1990-2000. Elle est à l’origine du groupe de Visegrád, fondé en 1991 par le président tchèque Václav Havel, le président polonais Lech Wałęsa et le Premier ministre hongrois József Antall. Le but : préparer ensemble l’adhésion à l’Union européenne et à l’Otan.
Une fois ces objectifs atteints, le groupe de Visegrád, ou V4, devient une sorte de club diplomatique, un espace de discussion où les dirigeants échangent sur les problématiques régionales, un groupe comme il en existe ailleurs en Europe. Ses membres y voient aussi un moyen d’apporter une certaine expertise, une contribution aux relations de l’UE avec l’Est. Cependant, cet espoir n’aboutit guère. Par exemple, lors des crises ukrainiennes avec la Russie, les « grands », c’est-à-dire l’Allemagne et la France, négocient avec Poutine sans vraiment consulter le V4, ce qui engendre certaines frustrations.
Ensuite, lorsque les régimes illibéraux arrivent au pouvoir en Hongrie, en Pologne et, plus récemment, en Tchéquie, le cadre diplomatique de Visegrád prend un tout autre sens. La situation se cristallise lors de la crise des réfugiés de 2015 : ces pays refusent catégoriquement la politique de répartition des réfugiés par quotas proposée par la Commission européenne. Le groupe de Visegrád devient alors l’organisateur d’un « front du refus », un instrument diplomatique contre la Commission, une sorte d’îlot de contestation au cœur même de l’Europe.
Les racines du nationalisme
Aujourd’hui, à rebours du sens originel du groupe de Visegrád, les pays d’Europe centrale sont dominés par un discours nationaliste eurosceptique, voire europhobe. Comment un tel discours a-t-il pu s’implanter dans cette région ? Les raisons sont multiples et complexes. Tout d’abord, il faut bien comprendre que le sentiment national est historiquement fort dans ces pays. En effet, le point commun entre la Hongrie, la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie est que ces nations ont subi pendant plus de deux siècles le joug des grands empires européens : la Russie, la Prusse, l’Autriche et l’Empire ottoman. Comme ces populations n’avaient pas d’État à proprement parler, leur identité s’est cristallisée autour des langues, des cultures, des religions, des mémoires, pour donner une forme de nationalisme ethnique, dans un contexte très multiculturel. C’était différent du nationalisme français, par exemple, qui, lui, s’est toujours construit au sein de l’État dans un cadre citoyen. Ce substrat nationaliste a perduré dans l’ensemble de la région, il est même devenu un des modes de légitimation du régime pendant les quarante ans de domination soviétique.
Lorsque les pays de Visegrád se sont libérés des Soviétiques, et donc de plusieurs siècles de domination impériale, ils ont voulu s’intégrer à l’Europe en affirmant leur propre identité. La libération s’est accompagnée d’une explosion culturelle, d’une redécouverte du passé, d’une soif d’échanges et d’expressions nouvelles. Ce qui a nourri aussi, dès les années 1990, des courants politiques nationalistes. Ainsi, lorsque la perspective d’adhérer à l’Union européenne, ce qu’ils appelaient la réunification (plutôt que l’élargissement) de l’Union, est devenue concrète, à portée de main, on sentait très bien une double perspective : il en ressortait à la fois une envie d’Europe très forte et une volonté de préserver l’identité nationale. Ces deux points n’étaient pour autant pas ressentis comme contradictoires. Pour bien comprendre les discours nationalistes actuels, ceux qui s’en prennent directement à l’Europe, il faut également revenir sur l’histoire plus récente. Après l’effondrement du bloc de l’Est, s’est engagé ce que l’on a appelé « la transition », ce qui revenait à l’intégration des pays anciennement communistes dans le monde capitaliste. Cette transition conduite sur le mode ultralibéral n’a pas profité à tout le monde. Elle a certes provoqué un boom économique inédit, mais elle a également été accompagnée d’une augmentation massive des inégalités. Une partie de la population s’est sentie exclue, minoritaire, laissée pour compte. Je pense notamment aux anciens travailleurs des fermes d’État qui n’ont pas été réembauchés dans les campagnes ou aux employées des grandes usines qui ont perdu leur emploi lors des restructurations, condamnés à des pré-retraites.
Toute cette population s’est retrouvée du jour au lendemain abandonnée, vivant de petits boulots et de trafics, et nourrissant un ressentiment de plus en plus violent. C’est sur cette colère que se sont appuyés de nombreux leaders populistes comme Orbán ou Kaczyński pour faire émerger l’un de leurs thèmes centraux : c’est la faute à l’Europe. Dans leurs discours, ils fustigent une Union européenne qui aurait pris la place de l’Union soviétique, serait à l’origine de tous les maux du pays, et à laquelle il faudrait résister. Il y a quelques jours encore, un député du PiS déclarait : « La Pologne “illégale” a lutté contre l’occupant pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a ensuite lutté contre les occupants soviétiques, et nous lutterons contre les occupants de Bruxelles. ».
Le paradoxe des régimes illibéraux
Aujourd’hui, la Pologne, la Hongrie et, dans une certaine mesure, la République tchèque sont gouvernées par des régimes nationalistes-conservateurs à tendances autoritaires, qui respectent de moins en moins les règles du droit européen – des règles qu’ils ont eux-mêmes acceptées par référendum lors des négociations sur l’acquis communautaire pour l’adhésion, et qu’ils ont établies avec les autres États membres en adoptant le traité de Lisbonne !
Prenons l’exemple de la Pologne et de ses réformes judiciaires. Depuis 2015, le ministre de la Justice et procureur général Zbigniew Ziobro s’attaque à l’indépendance de la justice. D’abord en créant un organe de contrôle des juges qui permet de licencier ceux dont les jugements déplaisent au gouvernement, puis en remplaçant les membres du tribunal constitutionnel et de la Cour suprême. C’est dire que le PiS contrôle absolument tout l’appareil juridique. C’est comme cela qu’il construit un État autoritaire, en reprenant des vieilles méthodes de l’État-parti de la Pologne populaire ! En réponse à ces violations de l’État de droit, la Commission, c’est-à-dire la gardienne des traités, saisit la Cour européenne de justice et menace la Pologne de sanctions financières.
Aujourd’hui, la Pologne se trouve dans une impasse : les relations avec l’UE sont extrêmement tendues, et le régime ne semble plus avoir d’autre choix que de quitter l’Union ou bien de reculer. Pourtant, malgré ce que l’on peut entendre, l’objectif n’est pas le « Polexit ». L’homme fort du régime, Jarosław Kaczyński, vice-Premier ministre et chef du PiS, a même affirmé récemment : « Il n’y aura pas de Polexit. Sans équivoque, nous voyons l’avenir de la Pologne dans l’UE. » Non, Kaczyński a plutôt le fantasme d’une « Europe des nations », à la de Gaulle, où la Pologne continuerait à bénéficier des subventions de l’UE et du grand marché sans avoir à en respecter les lois. Une position bien entendu inacceptable pour les partenaires européens.
La situation est mauvaise. Pour autant, je ne pense pas que les pays de Visegrád soient réellement en voie de devenir des dictatures ou de quitter l’UE. Ce sont des pays qui ont une grande culture politique, des traditions de résistance fortes, et dont la population sait revendiquer ses droits – il suffit de voir les mobilisations pour le droit à l’avortement en Pologne où, au lendemain de la décision du tribunal constitutionnel, plus d’une centaine de milliers de personnes ont manifesté à Varsovie et dans 120 villes à l’appel de l’opposition. Par ailleurs, les résultats des dernières élections ont révélé la relative fragilité des positions des leaders populistes, tant en Pologne et en Hongrie qu’en République tchèque. Partout, les partis d’opposition ont pris la tête des principales villes (Varsovie, Budapest…), même dans les régions les plus conservatrices. Je n’aime pas parler d’optimisme, mais j’ai tout de même la certitude que ces pays ne se fermeront pas, ou ne se laisseront pas fermer. Après tout, ils sont aussi européens que les pays de l’Ouest.
Conversation avec LOU HÉLIOT
« la Pologne ne partira pas et c’est dommage ! »
Nicole Gnesotto
« Les Européens ne disent rien, rien du tout. On parlait autrefois de la réconciliation franco-allemande. On a ensuite parlé de la réconciliation Est-Ouest. Depuis, plus rien. » La vice-présidente de l’institut Jacques-Delors revient sur les différends qui opposent aujourd’hui l’Union européenne …
[Illibéral]
Robert Solé
NON, bien sûr, on ne va pas mettre la Hongrie ou la Pologne à la porte. Mais comment faire comprendre à leurs dirigeants que l’Union européenne n’est pas une simple vache à lait et qu’elle repose sur des valeurs qui ne se divisent pas ?
Cela va mieux en le disant
Jean-Dominique Giuliani
Le principe habituel selon lequel « on reproche à l’Europe de ne pas faire ce qu’on lui a interdit » aurait-il vécu ? Dans la crise sanitaire, l’Union européenne a su se montrer réactive et efficace. Elle poursuit par ailleurs, à son rythme, une réelle intégration qui aide ses É…