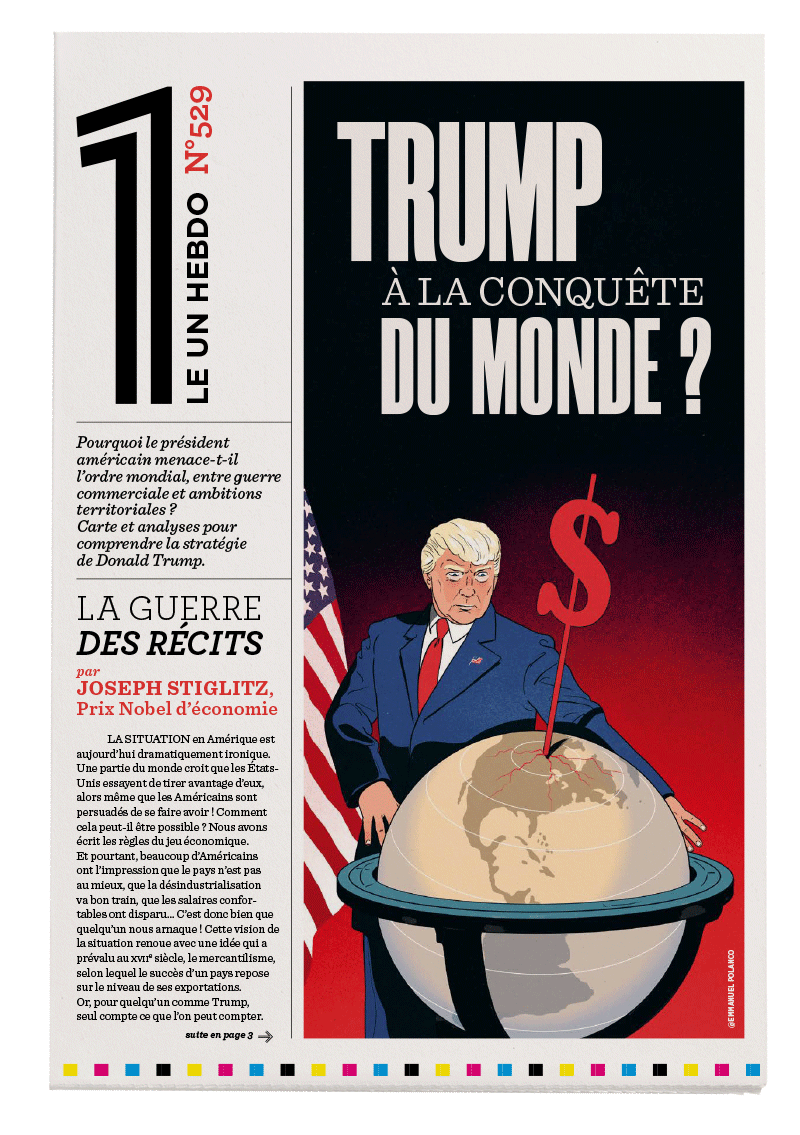« Les conflits d’usage sont très anciens »
Temps de lecture : 9 minutes
À qui appartiennent les espaces naturels sauvages ?
Cela dépend beaucoup des espaces sauvages en question. La composition floristique de la forêt amazonienne, par exemple, est le produit du travail des populations amérindiennes qui y pratiquent l’horticulture sur brûlis. Ce n’est donc ni une forêt sauvage ni une forêt vierge ; c’est une forêt anthropogénique. En Australie, la pratique du feu de brousse par les populations autochtones a transformé profondément le milieu. Autrement dit, les milieux sauvages, au sens classique du terme, sont assez rares. Quant aux autres, on peut dire qu’ils appartiennent à ceux qui les ont fabriqués ou qui les utilisent. Cette idée entre en contradiction avec la politique de protection de la nature.
Dans quelle mesure ?
Prenez le tout premier parc naturel, Yellowstone. Au moment de sa création en 1872, les populations autochtones d’Amérindiens qui y résidaient ont été déportées par l’armée. Cet espace, vu par la nation américaine comme une sorte de cathédrale sauvage de la wilderness, confiée par Dieu aux Américains, était en réalité un endroit déjà occupé. On peut multiplier les exemples de ce type dans lesquels la protection dite de la « nature » vient mettre en péril les usages traditionnels d’un environnement qui a été en partie façonné par les populations locales.
Les conflits d’usage de la nature sont-ils inédits dans l’histoire ?
Les conflits d’usage sont très anciens. Le mot français « forêt », par exemple, vient du latin foresta, qui est distinct du terme par lequel on désigne la grande forêt hercynienne du nord de l’Europe, la silva. Parce que la foresta, c’est la silva envisagée du point de vue juridique. Les premiers seigneurs féodaux de la dynastie carolingienne se sont arrogé des droits sur ces forêts au détriment des populations locales qui en vivaient. C’est le mouvement des « enclosures » : de la fin du Moyen Âge au xviiie siècle, des endroits qui servaient de pâturage partagé à de petits paysans – souvent des landes – ont été progressivement enclos par des barrières. Des propriétaires privés s’en sont ainsi emparés, condamnant à la misère des populations entières. C’est aussi, sous le Second Empire, dans les Landes, le hold-up commis par l’État sur des terrains de pâture pour les moutons. Ils ont été vendus aux enchères pour en faire des monocultures de pins. Les réactions de certaines populations à la réintroduction de l’ours dans les Pyrénées témoignent à mon sens d’une réaction contre la mainmise de l’État central sur des communs*. Les villages de montagne avaient des communs gigantesques qui étaient utilisés pour l’estive. Lorsque l’État a commencé à créer des parcs naturels, il a empiété sur ces communs et, d’une certaine façon, les ours ont été vus localement comme des agents de l’État venus accaparer un espace qui était auparavant un espace commun.
Le capitalisme est, en quelque sorte, le résultat d’un mouvement progressif très ancien de privatisation des communs en Europe. Le colonialisme est sa forme extrême.
Les conflits d’intérêts existaient-ils avant la sédentarisation ?
La sédentarisation est un long processus et il existe encore aujourd’hui beaucoup de peuples non sédentaires. Je m’étais intéressé, en Iran, à un système de transhumance impliquant cinq tribus. Des accords étaient conclus avec les populations sédentaires pour traverser leurs lieux de vie avec ces troupeaux immenses, accéder à certains points d’eau et utiliser les chaumes comme pâture. L’Américaine Elinor Ostrom, prix Nobel d’économie, a montré que lorsqu’il y a des communs, il y a toujours des règles d’usage pour les partager.
Existe-t-il autant de relations à la nature que de sociétés ? Ou l’Occident s’oppose-t-il à un rapport au monde homogène de type animiste ?
Si l’on raisonne comme vous venez de le faire, c’est parce que ce que j’ai appelé le naturalisme, c’est-à-dire l’idée d’une séparation entre humains et autres qu’humains, a beaucoup progressé avec la colonisation, l’impérialisme et la mondialisation. Sous ce rouleau compresseur, les autres façons de concevoir ces rapports sont devenues minoritaires. Mais avant le développement du capitalisme, la conception naturaliste était minoritaire.
« La forêt amazonienne n’est ni sauvage ni vierge ; c’est une forêt anthropogénique »
L’idée de nature n’existe que chez nous. Dès qu’on parle de « nature » – et c’est pour ça que le terme me gêne –, on la met à l’extérieur. Soit pour se l’approprier et en faire une ressource. Soit pour la protéger, mais « comme maître et possesseur », pour reprendre la formule de Descartes. Ailleurs, les formes d’interactions entre humains et autres qu’humains sont complètement différentes. Elles peuvent prendre la forme de négociations constantes. On communique avec les autres qu’humains dans les rêves, dans les incantations magiques. C’est ce que j’ai appelé l’animisme. Il existe d’autres systèmes – par exemple, celui que l’on a connu du Moyen Âge à la Renaissance – dans lesquels les humains et les autres qu’humains étaient inclus dans un grand dispositif hiérarchique, la « chaîne de l’être ». Depuis Dieu jusqu’aux créatures les plus humbles, ce système articulait les différentes composantes de cette chaîne avec de petits écarts ontologiques. Il y avait une continuité. Ce dispositif existe encore d’une certaine façon dans les grandes civilisations d’Extrême-Orient, à travers l’hindouisme notamment. Il surnage même paradoxalement dans la pensée chinoise actuelle, bien qu’elle ait embrassé le développement industriel avec enthousiasme.
L’Occident a tendance à considérer que les peuples autochtones protègent mieux la nature. Est-ce vrai ?
C’est vrai en contexte normal, c’est-à-dire sans pression colonisatrice. Certes, certaines espèces ont été annihilées, notamment par la chasse. Dans le sud des États-Unis, par exemple, le cerf de Virginie a été chassé intensivement par les Amérindiens, à l’encontre de leurs pratiques habituelles, parce qu’un marché s’était créé pour sa viande. L’apparition de ce marché a introduit un déséquilibre dans un système d’usage du milieu. Je pense que la plupart des cas de destruction d’une ressource par des populations traditionnelles peuvent s’expliquer par des phénomènes de ce type.
De la même façon, il faut du temps aux peuples nomades de Mongolie – mais aussi aux habitants de petits villages du Lot – pour comprendre que tous les déchets ne sont plus biodégradables et qu’il ne faut plus les jeter dans la steppe ou dans les bois. Développer un rapport différent avec le milieu, lorsque des conditions nouvelles interviennent, demande du temps.
Mais dans des conditions « classiques », les populations autochtones protègent-elles plutôt mieux les espaces ?
Oui. Les photos aériennes du territoire de la population amérindienne Xingu, en Amazonie brésilienne, sont exceptionnellement parlantes : d’un côté la forêt dense du parc et, dès qu’on en sort, de gigantesques déboisements pour la culture du soja. Ce phénomène a aussi une dimension affective : la vie en forêt, pour des gens qui y ont mené leur existence depuis des millénaires, leur semble plus épanouie que la vie dans des espaces déboisés, où il fait chaud, où le gibier a disparu…
L’IPBES, l’équivalent du Giec pour la biodiversité, a reconnu les peuples autochtones comme « gardiens de la biodiversité ». Les approches non occidentales sont-elles davantage prises au sérieux aujourd’hui, ou s’agit-il d’une forme d’hypocrisie ?
Je crois qu’il y a un peu des deux. Les leaders autochtones qui portent un message de défense de leur milieu sont la cible privilégiée des milices de propriétaires terriens. On parle de centaines d’assassinats en Amérique latine – c’est à faire se dresser les cheveux sur la tête ! Mais il est vrai que les populations autochtones ont réussi à faire entendre leur voix de façon plus nette qu’auparavant. Cela dit, c’est une position extrêmement fragile, comme nous le montre l’élection de Trump.
À qui profite le système actuel de protection de l’environnement, avec des espaces sanctuarisés d’un côté et des espaces très exploités de l’autre ?
Il profite essentiellement, et c’est un paradoxe, aux personnes responsables de la destruction de ces milieux, c’est-à-dire à la bourgeoisie citadine. Ce mouvement n’est pas récent : au xixe siècle, le mouvement romantique célébrait, dans la littérature mais aussi dans la peinture, le caractère sauvage naturel de certains espaces, parce qu’ils tranchaient avec les villes polluées ou les paysages profondément transformés par la révolution industrielle.
Tout le monde recherche des espaces qui donnent l’illusion de retrouver un milieu qui aurait été protégé et soustrait aux atteintes de l’industrialisation.
Est-il possible d’élaborer une politique de préservation de la nature qui ne favorise pas une cosmologie au détriment des autres ?
J’ai suggéré il y a quelques années à l’Unesco de créer des espaces qui soient protégés non pour des raisons écologiques classiques – capter du carbone, sauvegarder la biodiversité, etc. – mais parce que ces lieux étaient nécessaires à l’existence de populations autochtones.
Il est intéressant de constater que certaines d’entre elles demandent que leurs terres soient reconnues en utilisant des arguments de ce type. Lors de la COP21 en 2015 à Paris, une petite communauté d’Amérindiens de l’Amazonie équatorienne, Sarayaku, a demandé la protection de son territoire au nom des relations matérielles et spirituelles qui s’y déploient. C’est un mouvement qui prend de l’ampleur.
Finalement, quel est le meilleur moyen de protéger un espace ?
L’habiter intelligemment plutôt que le vider de ses habitants. Dans les années 1980, j’avais été très choqué par cette histoire : un jeune Allemand avait décidé de protéger une partie de la forêt amazonienne en Équateur et avait jeté son dévolu sur une zone qui contenait des bosquets d’une certaine espèce de palmier. Or ce palmier est par définition le signe de l’anthropie d’un écosystème : s’il était là, c’est parce que des populations humaines y avaient résidé et avaient permis sa prolifération. Et lui souhaitait qu’on vide cette région de ses populations locales ! C’était la marque d’une méconnaissance complète du fonctionnement des écosystèmes et d’un impérialisme absolument désespérant.
Vous prônez un « universalisme moins impérial », qu’entendez-vous par là ?
J’ai développé l’idée d’un « universalisme relatif », au sens où il préserverait les relations dans un espace donné. Il est donc fondé sur un inventaire des relations souhaitables ou non souhaitables entre humains et autres qu’humains. C’est un travail titanesque qu’il faudrait accomplir. Mais il n’est pas tellement différent de celui qu’a accompli, il y a un peu plus d’un siècle, la philosophie des Lumières. Elle a mis sur le devant de la scène certaines valeurs qu’on a longtemps considérées comme universelles, alors qu’elles avaient été forgées uniquement à partir de la connaissance des élites européennes.
Propos recueillis par HÉLÈNE SEINGIER & MANON PAULIC
* Les communs sont des ressources, matérielles ou immatérielles, gérées collectivement par une communauté selon des règles garantissant un accès équitable et partagé. Contrairement aux modèles public et privé, cette approche prône une gouvernance et un usage collectifs plutôt qu’une appropriation exclusive. La notion peut s’appliquer à la connaissance (logiciels libres), au logement (initiatives d’autogestion) ou aux ressources naturelles, comme au Guatemala où les peuples autochtones gèrent et préservent les forêts.


« Les conflits d’usage sont très anciens »
Philippe Descola
À qui appartiennent les espaces naturels sauvages ?
Cela dépend beaucoup des espaces sauvages en question. La composition floristique de la forêt amazonienne, par exemple, est le produit du travail des populations amérindiennes qui y pratiquent l’hor…
[Décret]
Robert Solé
FINALEMENT, je laisse tomber le Groenland. J’ai une autre idée. Préparez-moi un décret à signer.
– Très bien, monsieur le président. Quel en sera l’objet ?
– Nous allons annexer la face éclairée de la Lune. Mais pas un mot à Elon ! Je veux lui fair…
Montagne, forêt, littoral surmonter les conflits d’usage
Hélène Seingier
Oriane Raffin
L’histoire commence comme un conte pour enfants : il était une fois un marquis qui possédait un vaste domaine, au cœur des Alpes. Les randonneurs venaient y admirer la tour Percée – une arche naturelle exceptionnelle –, les passionnés y faire du ski de randonnée. Mais, un jour de 2023,…