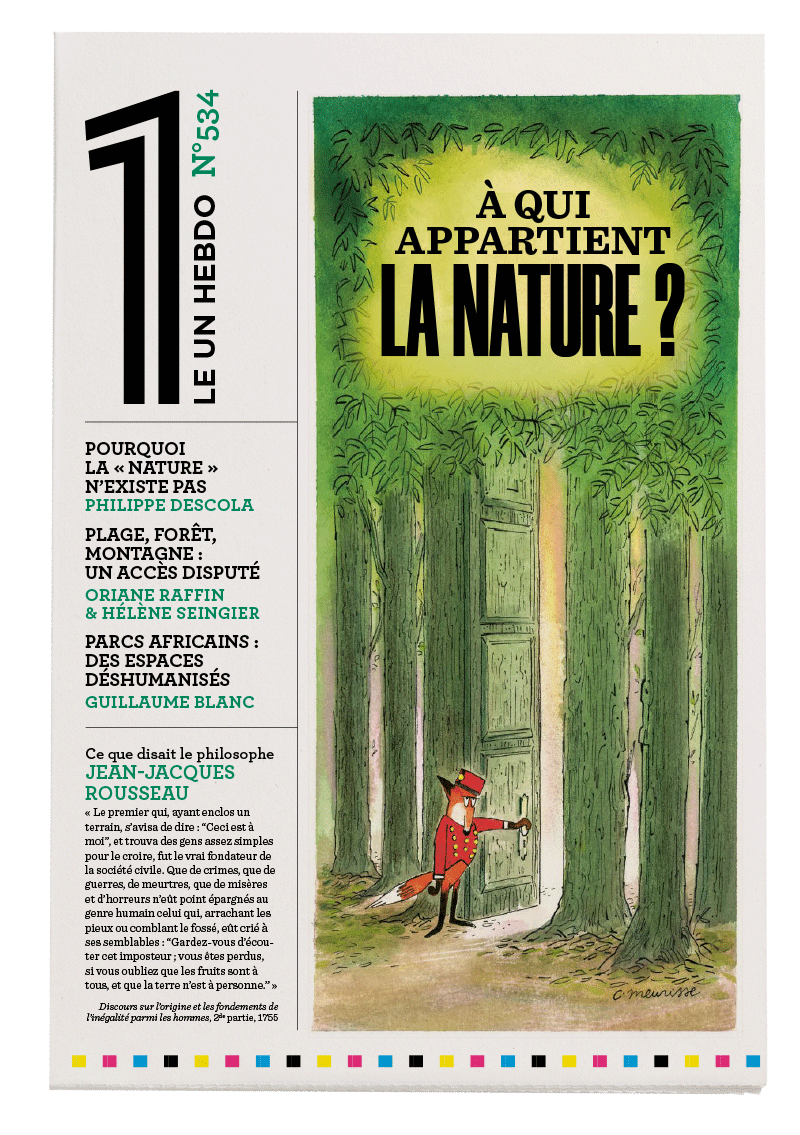Makatea chavira
Temps de lecture : 5 minutes
Le sort de Makatea fut gravé dans la pierre en 1896, quelques années après que la France eut annexé l’île à son empire Pacifique en pleine expansion. […] Cette année-là, un navire baptisé Lady M, battant pavillon de la Pacific Islands Company, fit une brève escale à l’atoll de Nauru, à quatre mille kilomètres au nord-est de Sydney. À terre, le subrécargue du navire, un dénommé Denson, tomba par hasard sur un mystérieux caillou qu’il prit pour du bois pétrifié. Il l’empocha avec le vague projet d’y tailler des billes pour ses enfants. Ce jeu gagnait en popularité, et Denson comme ses enfants adoraient y jouer.
Au lieu de quoi ce drôle de caillou servit à caler une porte dans les bureaux de Sydney de la Pacific Islands Company. Pendant trois ans, ce lingot d’or du Rhin, quoique bien en vue, passa inaperçu. Un beau jour, Albert Ellis, prospecteur pour la compagnie, passa à Sydney. Le butoir attira son regard, et il le fit analyser. Des veines de phosphate venaient d’être découvertes sur l’île Baker, à trois mille kilomètres au sud-ouest de Hawaï. Ellis soupçonnait la présence d’autres gisements de pierre magique, disséminés parmi les minuscules points épars qui constellaient au petit bonheur la vaste page blanche du Pacifique.
Les résultats arrivèrent. L’intuition d’Ellis était juste. L’étrange butoir contenait la substance qui commençait à nourrir le monde.
Le phosphate entrait dans la fabrication de toutes sortes de choses : lessives, matériaux de construction, et munitions. Mais son effet sur les récoltes était révolutionnaire. En tant qu’engrais, il n’avait pas d’égal. Grâce au phosphate, le rendement des cultures vivrières partout dans le monde se mit à crever le plafond. Sans le phosphate, la civilisation serait menacée d’une extinction malthusienne. […]
La veine de phosphate qui traversait l’île en diagonale surpassait tous ces autres atouts et sonnait leur perte
Makatea avait des récifs, des falaises majestueuses, et des grottes spectaculaires enfermant des sources souterraines. Elle regorgeait d’insectes, d’escargots, de poissons et d’oiseaux, y compris des espèces qui n’existaient nulle part ailleurs. L’eau fraîche y abondait, chose rare dans le Pacifique. La forêt vierge grouillait de crabes de cocotier, les plus gros invertébrés terrestres au monde, et un mets de choix à l’égal du homard. Mais la veine de phosphate qui traversait l’île en diagonale surpassait tous ces autres atouts et sonnait leur perte.
Deux cent cinquante personnes seulement vivaient sur l’île lorsque l’entreprise des étrangers débarqua en 1911 pour s’emparer de la pierre magique. […] Rares furent les Makatéens prêts à travailler pour les Popa’a. Ils aimaient la vie qu’ils menaient, et trouvaient ce nouveau genre de travail barbare. Les Blancs durent chercher ailleurs leurs mineurs. L’île vit déferler des légions de serfs japonais. Des centaines d’autres manœuvres arrivèrent de Chine, du Viêtnam, de toutes les îles du Pacifique. À la longue, ce furent des milliers de mineurs que la Compagnie française des phosphates de l’Océanie embaucha pour creuser le sol d’une île large de six kilomètres.
Makatea se transforma en fourmilière. Les mineurs n’avaient pas d’outils plus perfectionnés que des pelles et des pioches.
Chaque homme était descendu dans un trou où il passait sa journée à charger dans un seau le phosphate extrait à la main et à en inhaler la poussière. Au-dessus du trou, son collègue hissait les seaux et les vidait dans une brouette. Une fois la brouette remplie, l’ouvrier de surface la poussait au-dessus des ravins grandissants sur un réseau de planches branlantes, jusqu’à un tapis roulant alimentant un train dont la voie ferrée finit par couvrir la moitié de la longueur de l’île. C’est ainsi qu’un tiers de Makatea devint un paysage lunaire de roc déchiqueté, semé de crevasses larges de deux ou trois mètres et profondes de trente.
Lorsque les mines fermèrent du jour au lendemain en 1966, Makatea s’effondra
Pendant des décennies, l’île prospéra. Makatea était l’unique vache à lait de la Polynésie française, et devint l’un des lieux les plus développés de la colonie Pacifique. Elle avait l’électricité et l’eau courante, des commerces, des salles de billard, un bistrot, des courts de tennis, un terrain de foot et même un cinéma.
Elle avait aussi des mineurs qui mouraient de maladies pulmonaires, des enfants empoisonnés par l’eau contaminée. […]
Lorsque les mines fermèrent du jour au lendemain en 1966, Makatea s’effondra. Toute la main-d’œuvre importée partit ailleurs. Beaucoup d’insulaires quémandèrent un emploi à mille kilomètres de là, dans les îles autour de Mururoa, où les Français s’étaient lancés dans leur nouvelle aventure polynésienne : faire sauter les atolls à coups de bombes atomiques. La population de l’île se réduisit à une fraction de ce qu’elle était avant l’arrivée de la CFPO. La seule entreprise subsistante, c’était une jungle décidée à se venger.
Certains peuples du Pacifique aiment à dire : Toute île est une pirogue, toute pirogue une île. Quand les mines de phosphate fermèrent, Makatea chavira.
Pour les Makatéens, la terre – fenua – est sacrée, c’est la maison de l’âme. Mais la terre de Makatea a fini éparpillée sur tous les bords du Pacifique, dopant les récoltes dans plusieurs pays lointains. La croissance des récoltes entraîna celle de la population, et cette population accrue inspira tous les progrès, toutes les inventions, toutes les découvertes miraculeuses des douze décennies suivantes, à un rythme toujours accéléré. Les courbes ascendantes de l’humanité avaient eu besoin de phosphate.
Makatea avait aidé Homo sapiens à dominer la Terre. Mais dans ce processus, l’île s’était consumée.
Tout le monde a besoin de manger, mais peu de gens remarquent qui met la table. Makatea l’oubliée, c’est ainsi que certains livres surnomment l’île. Mais l’épithète est mal choisie. On ne peut oublier que ce qu’on a connu.
Extrait d’Un jeu sans fin, traduit de l’anglais américain par Serge Chauvin © Actes Sud, 2025
« Les conflits d’usage sont très anciens »
Philippe Descola
L’anthropologue Philippe Descola nous invite à prendre un recul aussi bien historique que géographique pour nous détacher de l’idée occidentale moderne selon laquelle l’homme est séparé de la nature.
[Décret]
Robert Solé
FINALEMENT, je laisse tomber le Groenland. J’ai une autre idée. Préparez-moi un décret à signer...
Montagne, forêt, littoral surmonter les conflits d’usage
Hélène Seingier
Oriane Raffin
En France, les conflits d’usage ont tendance à augmenter. De la Bretagne aux Alpes, en passant par les calanques marseillaises, Oriane Raffin et Hélène Seingier décryptent les facteurs qui entravent l’accès à certaines zones naturelles. Une enquête du 1 hebdo.