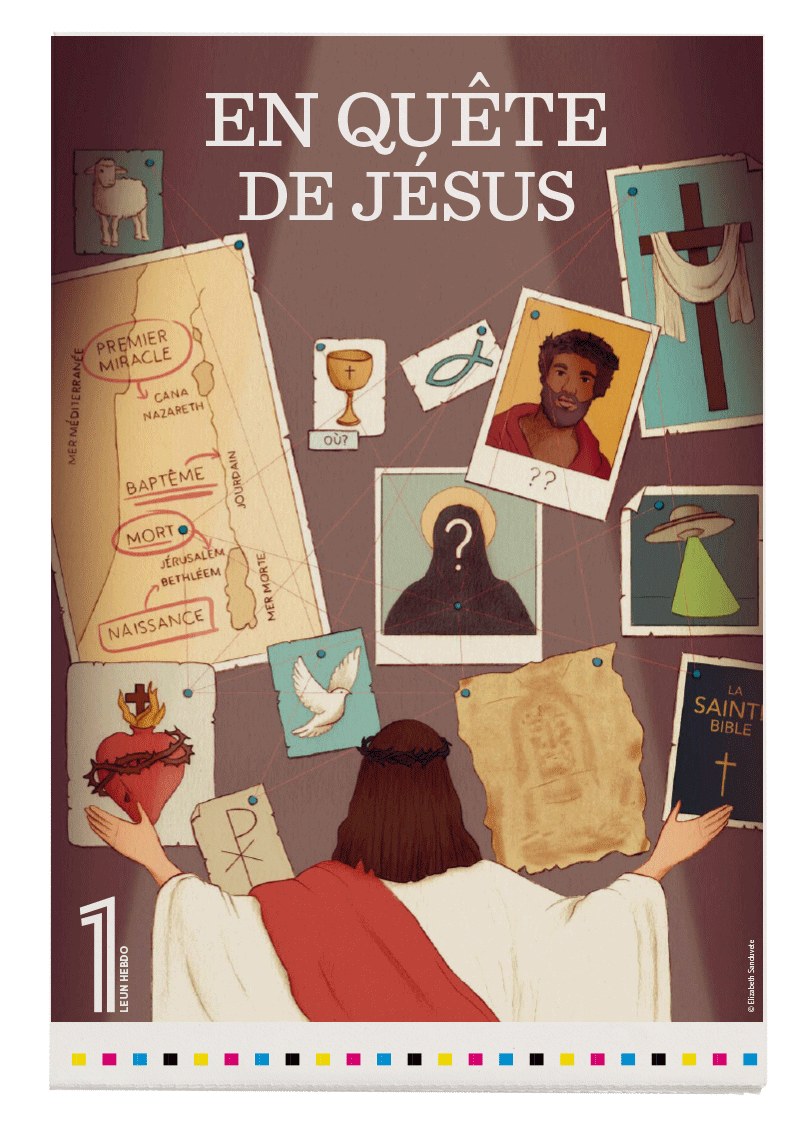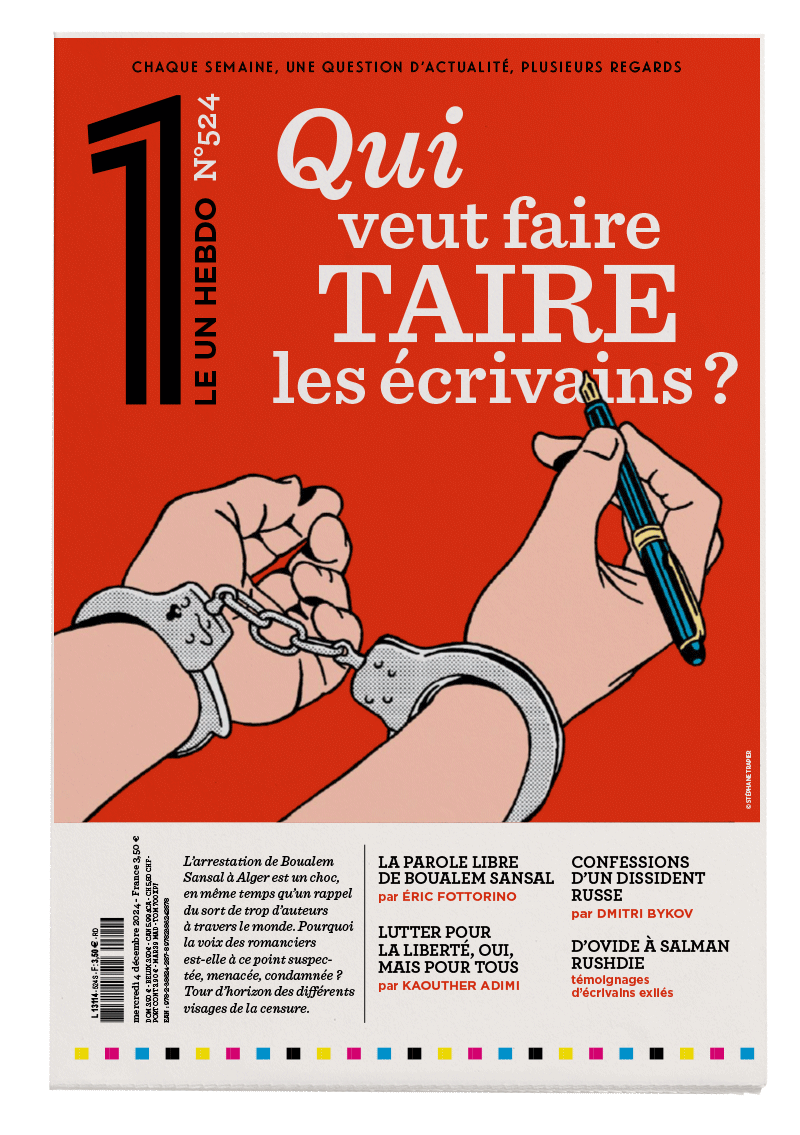Une démocratie citoyenne, enrichie et augmentée
Temps de lecture : 11 minutes
La loi sur les retraites a donc été adoptée et promulguée. Le Conseil constitutionnel a estimé qu’elle était conforme à la Constitution, à quelques cavaliers sociaux près. Connaissant les modes de raisonnement du Conseil, sa jurisprudence passée, son désir de défendre avec ferveur les libertés mais sa timidité quand il s’agit de s’aventurer sur le terrain des relations entre les pouvoirs, je ne m’attendais pas à autre chose. Tout cela suffit-il à nous permettre de considérer que, dans la circonstance, le fonctionnement de nos institutions a été conforme à l’idée que nous nous faisons de la démocratie ? Un processus peut être légal sans être authentiquement démocratique. En l’occurrence, les instruments de « rationalisation » du parlementarisme qui ont été utilisés sont tous réguliers, mais leur accumulation finit par créer un problème démocratique. La réaction de l’opinion, après l’adoption par le recours à l’article 49.3 de la Constitution d’un texte aussi important, signifie qu’à la crise sociale s’est ajoutée, qu’on le veuille ou non, une crise démocratique. Nous avons là un sérieux problème qui trouve son origine dans le résultat des dernières élections législatives : en juin 2022, le fait majoritaire s’est retiré de notre vie institutionnelle pour la première fois depuis 1962, et nous n’avons pas fini d’en mesurer les conséquences.
La disparition du fait majoritaire
La Constitution de la Ve République a été écrite par des gens qui souhaitaient donner de la stabilité à l’exécutif et écarter les désordres parlementaires de la IVe. Pour cela, ils avaient prévu toute une série d’instruments permettant de limiter la liberté du Parlement. Pendant longtemps, cet arsenal n’a pas servi à grand-chose, sinon à rappeler à l’ordre des majorités quand elles commençaient à traîner des pieds. Pour une raison simple : en dehors de la période 1988-1993, les présidents ont toujours disposé de majorités absolues. Depuis 2022, les choses ont changé. Avec un président sans majorité absolue, la logique aurait voulu qu’on passe à une interprétation plus parlementariste des institutions. C’est du reste ce qui a été fait pour les premiers textes de la législature qui ont été votés par des majorités ad hoc.
Mais avec la réforme des retraites, le pouvoir exécutif a agi comme si la disparition du fait majoritaire n’avait pas eu lieu. Mon propos ne vise pas à remettre en cause la démocratie représentative, au contraire ! Beaucoup de Français, à commencer par ceux qui manifestaient dans la rue, voulaient savoir ce que leurs représentants pensaient du texte sur les retraites. Combiné à la stratégie d’obstruction d’une partie des oppositions, ce refus a donné le sentiment au pays que l’on avait fait violence à l’esprit de la démocratie.
Cette crise démocratique ne se limite pas aux institutions, elle touche aussi les relations du pouvoir avec les corps intermédiaires
Cette crise démocratique ne se limite pas aux institutions, elle touche aussi les relations du pouvoir avec les corps intermédiaires. Dans l’affrontement que nous venons de vivre, les syndicats ne parlaient pas seulement pour eux-mêmes, ils avaient l’appui d’une large part de la population. Ont-ils été entendus ou même simplement écoutés ? Le président et le gouvernement se défendent en évoquant leurs efforts de concertation. Il est vrai qu’en dépit de l’empressement initial d’Emmanuel Macron, la Première ministre a obtenu un mois de discussions supplémentaire. Mais les termes de l’échange étaient tellement contraints qu’il ne restait presque rien à discuter. Ligne rouge sur les pensions, ligne rouge sur les cotisations… Il n’y avait plus que les mesures d’âge et, parmi elles, le report de l’âge légal a d’emblée été imposé comme la mesure phare. La seule négociation possible concernait les compensations sociales. On a fait les gestes et le cérémonial d’une concertation, mais sans l’ouvrir réellement.
« Modernisation élitiste »
On pouvait difficilement s’éloigner davantage de la promesse contenue dans le slogan de la campagne de 2022 « Avec vous ». Tel qu’il avait été glosé par l’intéressé lui-même, il s’agissait d’inventer une nouvelle façon de gouverner avec les Français. Le programme du candidat proposait des conférences des parties en région sur la santé, sur l’éducation. Autant de projets qui se retrouvent aujourd’hui sous l’ombrelle du Conseil national de la refondation (CNR). De même étaient annoncées de nouvelles conventions citoyennes. Et de fait, une Convention citoyenne sur la fin de vie a été mise en place.
Emmanuel Macron a préféré recourir au vieux système de la « modernisation élitiste » qui avait fait les beaux jours du début de la Ve République
L’idée de gouverner de façon plus inclusive et coopérative me paraissait pertinente. En 2017, Emmanuel Macron avait reçu deux mandats des Français : l’un, peut-être consenti mezza voce, pour procéder à un certain nombre de réformes structurelles ; l’autre, beaucoup plus clair, pour changer la politique. Ce second point a été oublié au début du premier quinquennat. Emmanuel Macron a préféré recourir au vieux système de la « modernisation élitiste » qui avait fait les beaux jours du début de la Ve République : revêtu de l’autorité du suffrage universel et avec l’appui d’une technocratie forte, l’exécutif a imposé ses mesures à la société sans trop lui demander son avis. Les Gilets jaunes ont interrompu cette séquence. Ont suivi le Grand Débat, la Convention citoyenne pour le climat, puis, pendant la crise Covid, la création d’un Conseil scientifique. Encore une fois, le slogan « Avec vous » semblait prolonger cette nouvelle façon de faire. Après les élections législatives de 2022, elle paraissait d’autant plus pertinente et nécessaire que, sans majorité absolue, le président ne pouvait plus aussi facilement imposer ses vues.
Une demande d’interactions continues
Il faut bien comprendre que ce modèle de « modernisation élitiste » se situe en contradiction avec une évolution profonde de la société. Une grande part des électeurs souhaitent que le mandat qu’ils accordent à leurs représentants ne se résume pas à une simple délégation, mais s’accompagne d’une relation continue. Les démocraties représentatives sont nées dans des sociétés peu alphabétisées, où l’élu était considéré comme infiniment plus compétent que ses électeurs. Montesquieu dit dans L’Esprit des lois que le peuple sait choisir un représentant mais qu’il n’est pas capable de se mêler des affaires publiques. Mais nous ne sommes plus au temps de Montesquieu. Les sociétés sont beaucoup plus éduquées, les citoyens sont ou se croient beaucoup plus compétents. Et l’idée selon laquelle quelqu’un pourrait décider en mon nom de questions qui me concernent et qu’il connaîtrait mieux que moi ne va plus de soi.
La relation entre gouvernants et gouvernés ne peut plus être une relation de domination
Avant la campagne 2022, à Terra Nova, nous avons interrogé une communauté de cinquante citoyens de toutes conditions. La première question que nous leur avons posée était de savoir quelles étaient les qualités qu’ils attendaient du prochain locataire de l’Élysée : ils voulaient qu’il soit indépendant, volontaire, déterminé, au-dessus des partis, c’est la posture gaullienne, et en même temps qu’il les écoute et discute avec eux. Ces attentes n’ont que l’apparence de la contradiction. Elles se réconcilient dans une idée simple : la relation entre gouvernants et gouvernés ne peut plus être une relation de domination. Pour être en position de gouverner, il faut non seulement être élu, mais aussi considérer que le mandat emporte avec lui une demande d’interactions continues. Cela fait partie de ce que Pierre Rosanvallon appelle la « démocratie d’exercice ».
C’est là que les Conventions citoyennes prennent tout leur sens, tout comme les consultations participatives, les contrats en région comme « Marseille en grand » ou les réunions thématiques du Conseil national de la rénovation (CNR). Si l’on n’accepte pas l’idée que les citoyens, dans leur diversité, sont porteurs de l’exigence d’une nouvelle relation politique à leurs gouvernants, la démocratie représentative a du souci à se faire. Ce n’est pas lui porter atteinte que de faire ce constat, mais, au contraire, la défendre de manière plus pertinente que ceux qui estiment qu’entre deux élections, les citoyens n’ont qu’à subir et se taire.
Des conventions qui mêlent élus et citoyens
La démocratie représentative doit se considérer comme un pouvoir du dernier mot et éventuellement du premier. Mais entre les deux, elle doit laisser toute sa place à la délibération dans les enceintes institutionnelles – le Parlement doit recouvrer sa liberté de parlementer – et bien au-delà avec la démocratie sociale, les associations, etc. Il ne s’agit en aucune façon de dessaisir les élus de leur pouvoir de décider. Mais leurs décisions seront bien meilleures si elles résultent d’une délibération plurielle, riche et ouverte.
Il ne s’agit en aucune façon de dessaisir les élus de leur pouvoir de décider. Mais leurs décisions seront bien meilleures si elles résultent d’une délibération plurielle, riche et ouverte
Comment veut-on que les citoyens s’approprient les décisions s’ils n’ont pas le sentiment d’y avoir été associés ? C’est vrai à tous les étages de la société, dans les entreprises, dans les territoires et, parfois, jusque dans les familles... Nous sommes sortis de l’époque où les cadres de la subordination étaient de telles évidences qu’ils n’avaient même pas à être formulés. Les modes d’institution de l’autorité ne résultent plus simplement d’un statut. L’élection compte, mais il s’agit d’entretenir, tout au long du mandat, ce lien d’échange avec des citoyens et des collectifs qui continuent à s’exprimer, à adhérer ou à refuser, à s’indigner.
Ce serait un non-sens d’opposer les citoyens appelés à délibérer dans des conventions et les élus. Dans certains cas, d’ailleurs, en Irlande par exemple, des conventions ont mêlé élus et citoyens. Il me semble que le bon régime de ces Conventions citoyennes, consiste à mettre des citoyens tirés au sort, mais représentatifs de la diversité sociale, en situation de produire un avis normatif, pas un avis d’expert. Il ne s’agit pas de dire ce qui est possible, mais ce qu’il conviendrait de faire. Il faut donc construire un cadre de travail qui permette de produire cet avis de type prélégislatif, et même d’aller assez loin dans l’exigence de précision, avant que les parlementaires en discutent, l’adoptent ou non, l’amendent et expliquent leurs motivations.
Une école de formation des préférences
Ces délibérations citoyennes pourraient également précéder les référendums comme c’est le cas dans l’Oregon aux États-Unis. On peut penser que les choses seraient un peu différentes si, avant de voter, les électeurs pouvaient prendre connaissance d’un avis produit, non par un des camps en compétition, mais par quelques-uns de leurs concitoyens leur expliquant les conséquences du « oui » et celles du « non ». On peut tenter d’imaginer ce qu’aurait donné le référendum sur le Brexit au Royaume-Uni si les électeurs, avant de voter, avaient reçu les conclusions d’une Convention de citoyens explicitant les conséquences de leur vote, notamment le potentiel problème de l’Irlande du Nord en cas de victoire du « oui ».
Le pari, c’est d’éclairer les décisions politiques, de faire de l’espace public une école de formation des préférences où chacun peut se déterminer à la lumière d’informations et d’arguments contradictoires. À la fin de la Convention citoyenne pour le climat, 72 % des conventionnels ont dit que les débats les avaient fait changer d’avis. Quand j’ai commencé à m’occuper avec Laurence Tubiana de l’organisation de cette Convention, je craignais que l’objectif soit trop élevé. Chemin faisant, les conventionnels se sont emparés du sujet dans sa complexité, ils m’ont convaincu que j’avais tort.
Le pouvoir du premier et du dernier mot
Après l’adoption de la loi Climat et résilience à l’été 2021, la plupart des journaux ont écrit que le gouvernement avait vidé comme une huître le rapport de la Convention. Deux ans plus tard, certains – parfois les mêmes ! – décrivent les zones à faible émission (ZFE) comme une bombe sociale à retardement. D’autres prétendent que l’obligation de rénovation thermique faite aux propriétaires bailleurs va bouleverser le marché locatif ou que le « zéro artificialisation nette » va rendre impossible la construction. Toutes ces mesures, poussées par la Convention, appartiennent à la loi Climat et résilience, un texte beaucoup plus riche et complexe qu’on ne l’a d’abord cru. Ce qui était censé être négligeable s’avère être un Himalaya. Et l’on découvre, ce faisant, que la transition écologique est un sujet horriblement compliqué.
Le pouvoir du premier et du dernier mot, ce n’est pas un petit pouvoir
La démocratie citoyenne ne vise pas à remplacer la démocratie parlementaire, mais à l’enrichir et à l’augmenter, à l’instar de la démocratie sociale. Ce qui compte, c’est l’interaction de ces formes de légitimité : il ne s’agit pas de les mettre sur un pied d’égalité, mais de les articuler. Après tout, dès 2007, la loi Larcher prévoyait que le gouvernement, avant de légiférer sur une question touchant l’organisation du travail, devait proposer aux partenaires sociaux de se concerter et de faire, éventuellement, des propositions qui pourraient être ensuite soumises au Parlement. Aux Pays-Bas, les autorités ont adopté l’objectif de neutralité carbone en 2050 et elles se sont tournées vers les territoires, les syndicats, les entreprises du pays pour leur demander de tenter de se mettre d’accord sur les moyens de parvenir à cet objectif.
Le pouvoir du premier et du dernier mot, ce n’est pas un petit pouvoir. Nous sommes à la recherche, depuis quelques années, d’un nouveau compromis entre l’efficacité et la délibération. La Ve République a très clairement fait pencher le fléau de la balance du côté de l’efficacité au détriment de la délibération. Il nous revient de rééquilibrer cette balance.
Conversation avec PATRICE TRAPIER


« Nous vivons une crise de régime »
Dominique Rousseau
Aux yeux du constitutionnaliste Dominique Rousseau, nous vivons une crise sans précédent sous la Ve République, qui se caractérise par un très fort décalage entre des institutions centrées sur le suffrage universel et des citoyens qui ne supportent plus d’être « cantonnés à l’exercice …
[Bouffonneries]
Robert Solé
En démocratie, les contre-pouvoirs sont légion. Il n’en était évidemment pas de même au temps de la monarchie absolue. La France a néanmoins connu, au Moyen Âge et sous l’Ancien Régime, une fonction qui s’est quasiment officialisée entre le XIVe et le milieu du XVIIe siècle …
Une constitution caméléon
Anne-Charlène Bezzina
Pour la juriste Anne-Charlène Bezzina, les enjeux du moment ne sont pas d’ordre constitutionnel, mais tiennent à un problème de légitimité auquel un changement de constitution ne saurait apporter de réponse.