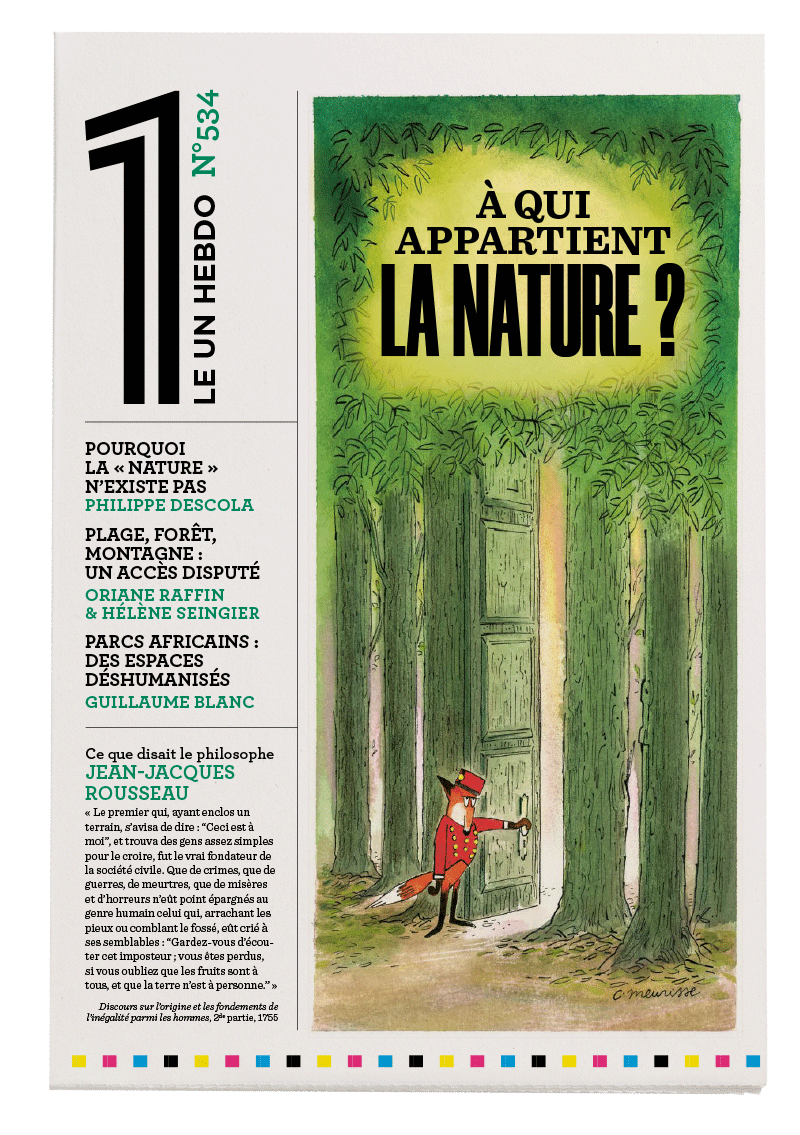La révolution maternelle
Temps de lecture : 5 minutes
Lorsque le Comité consultatif national d’éthique a commencé à se pencher sérieusement sur la question de la PMA pour toutes en 2013, il s’agissait avant tout de répondre à une demande de la société qui nous semblait claire : rendre accessible la procréation aux couples de femmes homosexuelles. Une étape logique et attendue après la promulgation du mariage pour tous. Par souci d’équité et de constitutionnalité, il convenait de l’ouvrir également aux femmes célibataires.
Après l’entrée en vigueur de la loi, le 1er septembre 2022, nous nous attendions donc à une vague massive de demandes de la part de femmes en couple, et pensions que les femmes seules y auraient recours de manière plus marginale. Neuf mois plus tard, le constat est on ne peut plus étonnant : dans la plupart des centres d’études et de conservation des œufs et du sperme (Cecos), les femmes célibataires représentent la majorité des demandes de procréation médicalement assistée, jusqu’à 60 %, contre environ 20 % de couples de femmes homosexuelles et 20 % de couples hétéros. Plus déroutant encore : 10 % des femmes seules faisant appel à la PMA sont, selon le terme qu’elles emploient elles-mêmes, « vierges » et souhaitent le rester. Certaines formulent aussi une demande de césarienne systématique. Serait-on donc passé, en cinquante ans, d’une attente d’une sexualité sans procréation, à travers les moyens contraceptifs, à celle d’une revendication d’une procréation sans sexualité ?
10 % des femmes seules faisant appel à la PMA sont « vierges » et souhaitent le rester
J’ai pour habitude de dire que le monde de la procréation change bien plus vite que notre capacité à le penser, à le saisir, voire à l’anticiper. En ce qui concerne les femmes seules, nous pensions que les Cecos seraient voués à accueillir majoritairement des femmes de 38-40 ans, mais ce sont souvent des jeunes femmes de 20 à 30 ans, parfois moins, qui viennent y faire une demande de don de sperme. Personne ne s’attendait à cette réalité qui dépasse ce que l’on avait projeté. En bioéthique, l’enjeu est pourtant d’anticiper. Nous sommes à l’aube, pourrait-on dire, d’une révolution anthropologique de la maternité que nous n’avions pas imaginée quelques années plus tôt. Au cœur de cette révolution : une passion de procréer, mais « sans autre ».
L’émergence du phénomène des mères vierges nous amène forcément à repenser à la Vierge Marie face à la démarche de ces femmes. Si leurs intentions ne sont jamais formulées comme telles, on peut se poser la question d’un éventuel retour de fascination pour l’Annonciation et le mystère de l’Incarnation ! C’est tout un fantasme parthénogénétique qui se réalise.
Comme Pascal Quignard le disait : « Nos parents faisaient autre chose en nous faisant. »
Du point de vue de la psychanalyse, ces cas de mères vierges font directement écho au point de butée que présente la procréation : un enfant n’imagine que difficilement être issu de la sexualité. Il imagine une graine entrée par la bouche ou par l’oreille, une cigogne qui le dépose à ses parents, une naissance dans un chou, mais la sexualité comme cause de l’existence reste toujours un impensé. Comme Pascal Quignard le disait : « Nos parents faisaient autre chose en nous faisant. » La possibilité pour des femmes de donner naissance à un enfant tout en demeurant vierge est la réalisation de ce point de butée de l’origine.
Cette grande révolution anthropologique de la maternité n’a par ailleurs pas commencé avec les mères célibataires. L’existence et l’usage des biotechnologies elles-mêmes ont engendré un bouleversement comme jamais il n’y en avait eu dans ce domaine de l’intime, devenu aujourd’hui politique. Avec la PMA, nous sommes passés d’un monde dans lequel le père était incertain mais la mère certaine, à un monde dans lequel père et mère sont devenus incertains. En effet, la maternité se divise, elle devient multiple. L’ovocyte, la gestation, la filiation. Ou encore la donneuse d’ovocytes, la mère porteuse, la mère d’intention. Pour accompagner cette évolution, il me semblerait pertinent de changer la manière dont la filiation est pensée. Ne plus considérer que les parents font l’enfant et donc la famille, mais penser la famille à partir de l’enfant, en inscrivant celui-ci dans une filiation.
L’évolution de cette révolution vers la maternité solo est un véritable changement qu’il nous faut penser. On peut se demander d’où vient cette pente à chercher à « procréer sans autre » et nous savons que, dans les années à venir, des questions nouvelles vont peut-être émerger du côté de l’enfant qui en est issu.
Ce qui arrive aujourd’hui n’est autre que le mouvement de la vie
Il est certain que cette forme de maternité pose un défi important. On pourrait dire que l’enfant trouve sa liberté pour advenir dans la division entre la femme et la mère. Autrement dit, pour donner une place à l’enfant, il est bon que la mère fasse preuve d’une certaine ambivalence en vivant sa vie à la fois en tant que mère, mais aussi en tant que femme. Il est bénéfique pour la réalisation de l’enfant que sa mère ait aussi une vie au-delà de l’enfant, une vie personnelle, sociale, politique, une vie dans toutes ses déclinaisons. C’est un enjeu pour elle et pour l’enfant, tout à fait réalisable, mais à garder à l’esprit.
Ces évolutions de la maternité engendrées par les biotechnologies auront-elles des conséquences pour l’enfant ? Si oui, lesquelles ? Impossible de le savoir aujourd’hui. Je crois, en revanche, que se montrer alarmiste serait une erreur. Ce qui arrive aujourd’hui n’est autre que le mouvement de la vie. Ne pas savoir où cette évolution nous mène ne devrait pas nous effrayer, nous faire aller vers une tentation conservatrice. Rappelons que, pour un enfant, les conditions de son existence importent, mais ne sont pas déterminantes. D’où l’on vient ne dit pas tout ce que l’on devient. L’origine n’est pas un destin.
Conversation avec MANON PAULIC
« Le bébé rencontre le regard de sa mère et tout commence »
Monique Bydlowski
Grande spécialiste de la psychologie de la maternité, la psychiatre Monique Bydlowski nous explique ce qui a évolué et ce qui ne change pas dans cette grande aventure humaine.
[Matrimoine]
Robert Solé
La maternité, c’est sacré. Pour rien au monde, industriels et commerçants ne laisseraient passer la fête des Mères. La gamme des cadeaux suggérés ne cesse de s’élargir.
Les Bluets, un hôpital féminin
Ondine Debré
« Les étages des Bluets, du planning à la nursery, racontent l’histoire des femmes d’aujourd’hui, dans leur désir d’être mère mais aussi de ne pas l’être ; dans leur vulnérabilité face aux violences, mais aussi dans l’immense puissance protectrice qu’elles déploient les unes pour les autres. » Un…