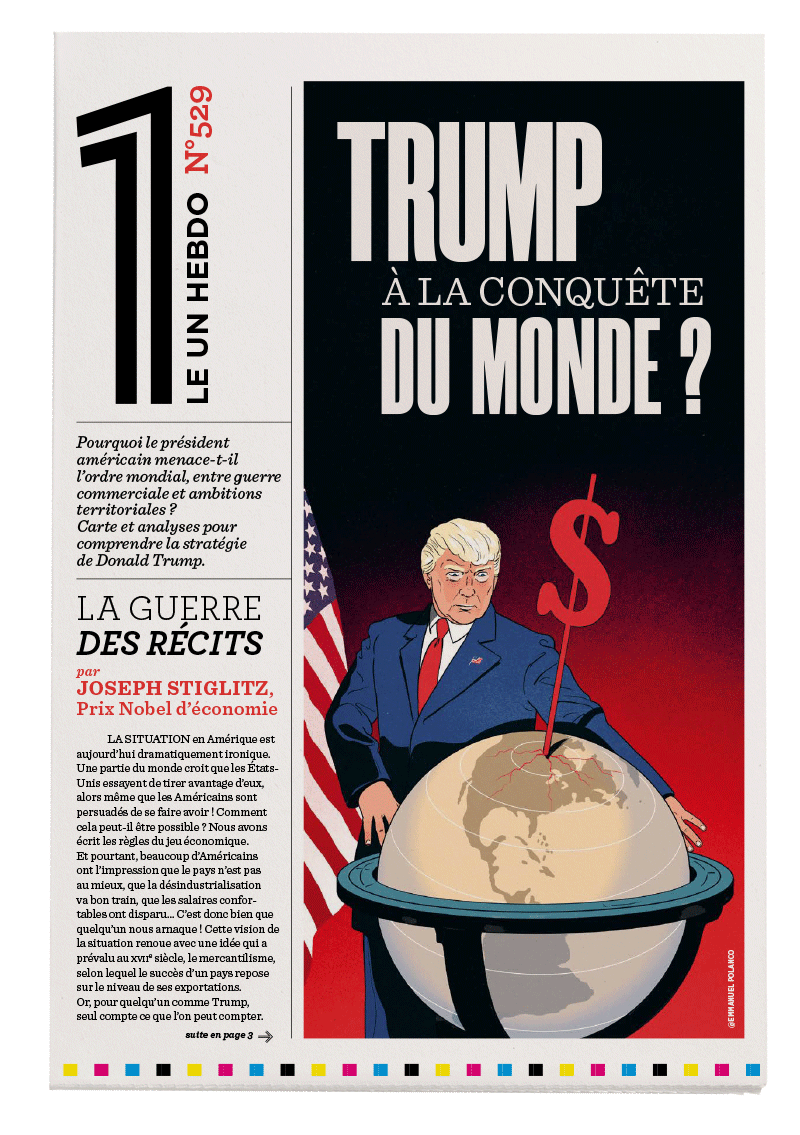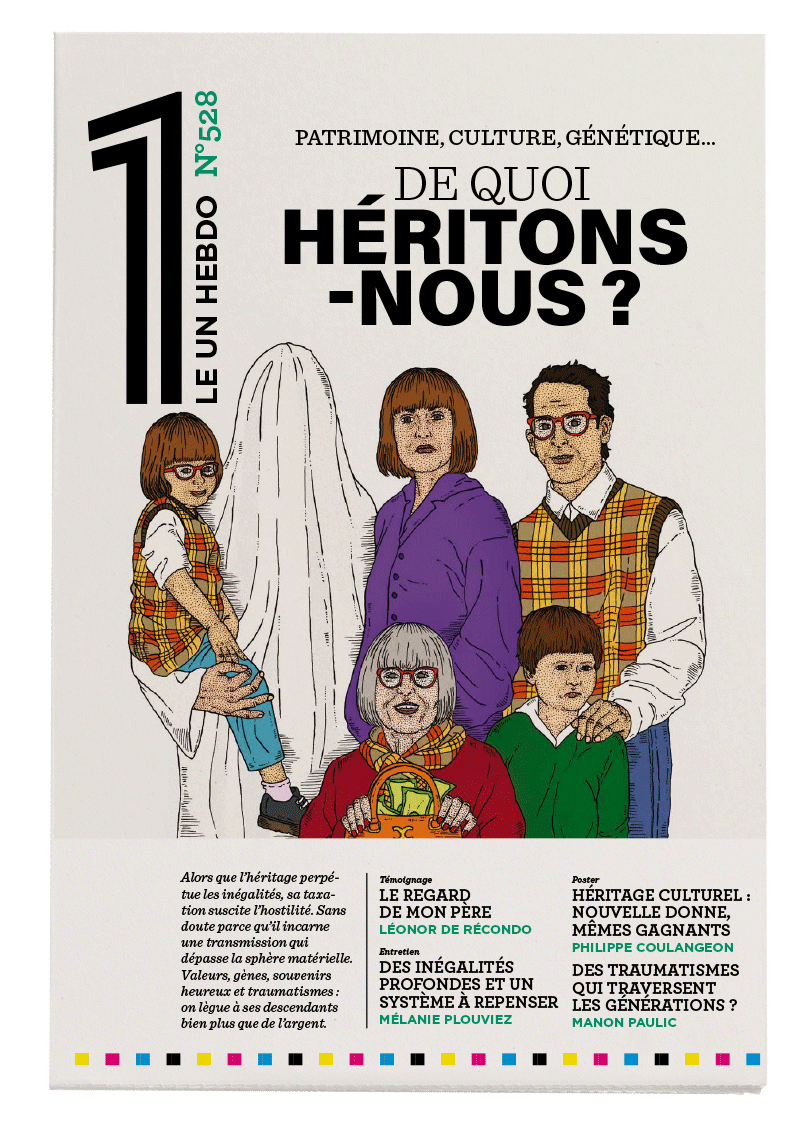« Ce sont les inégalités qui menacent la fraternité »
Temps de lecture : 12 minutes
Vous avez donné un cours sur la fraternité. Dans quel contexte ?
C’était dans le cadre du master en sociologie « Politique et économie de la protection sociale », dirigé par mon collègue Jean-Louis Laville au Conservatoire national des arts et métiers. En déroulant la grande historiographie de la solidarité, on travaille nécessairement sur des notions connexes, et sur ce qui les différencie : mutualisme, corporatisme, communautés et commons, fraternité.
Il est intéressant de comprendre cette dialectique des valeurs qui caractérise la France : une république construite autour d’un modèle de solidarité publique, qui a fait de la question sociale la question politique par excellence de la fin du XIXe siècle, qui a cherché à « concrétiser » l’État de droit par l’État social… et qui arbore en même temps dans sa devise la notion plus sacrée de fraternité.
En quelques mots, comment définissez-vous la fraternité ?
Il existe au moins trois manières de la définir : la première renvoie à la dimension religieuse, monastique, celle qui considère que nous ne faisons qu’un dans le corps du Christ, que nous sommes une même humanité fraternelle. La fraternité y est une forme d’incorporation divine, et de vie en communauté fermée, recluse. Deuxième approche, celle, révolutionnaire, qui accompagne la naissance de la Ire République, ou comment l’An I représente une nouvelle ère pour les hommes, tous égaux et frères, frères dans leur humanité mais aussi dans leur citoyenneté. La fraternité révolutionnaire est une fraternité des Lumières, de l’humanisme. Néanmoins, dans cet idéal transparaît ce que Sartre avait appelé une fraternité de terreur : il y a les « amis » de la République, les citoyens-frères de la République indivisible, et les ennemis. Cette binarité, ce radicalisme fort dans l’idéal révolutionnaire vont disparaître dans la troisième définition possible de la fraternité, celle de 1848 et au-delà, jusqu’à nos jours : non pas la sacralisation d’une dimension divine de l’humanité, mais la sacralisation d’un « ici et maintenant », incarné par la République, qui unit les hommes dans leur humanité sociale.
Il faut comprendre que la Révolution française a créé la fraternité laïque, ou ce que j’avais appelé, dans Les Pathologies de la démocratie, la transcendance sans le dogme, une manière pour elle de sacraliser les principes de la démocratie républicaine, en lieu et place de Dieu. Régis Debray a beaucoup développé cette approche, avec son « moment fraternité ». Il existerait dans toute société, selon lui, un « invariant sacral », et la fraternité pourrait le symboliser. Il est clair que la notion de fraternité, dans notre devise républicaine, contient tout cela à la fois : notre fraternité laïque et sociale est sacralisée en lieu et place d’une fraternité christique ou plus spirituelle. La République fait de nous des frères que nous ne sommes pas sans elle. Et après 1848, et la naissance de l’État social, nous pouvons poser que la République sociale et solidaire fait de nous des « frères », dissemblables mais égaux en droits. Nous aurions pu changer notre devise en remplaçant « fraternité » par « solidarité ». Mais le peuple français reste attaché à cet idéal d’indivisibilité, symbolisation très forte de l’humanité tout entière et non des seuls ressortissants nationaux. Notre fraternité française est républicaine et internationaliste. La solidarité n’est pas exclusivement nationale, du moins dans notre idéal. La traduction laïque de la communauté divine, c’est la fraternité dans son acception universaliste.
Dans le premier registre de la communauté religieuse, quelles figures incarnent la fraternité ? Le Christ, les saints ?
Oui, tout ce qui appartient à la communauté du Christ, tous ceux qui se définissent comme « frères » et « disciples », et qui adoptent un style de vie ordonné selon des règles « autres », qui font écho à la Jérusalem céleste, à la communauté éternelle des hommes. Cette fraternité monastique unit les hommes ici et au-delà. Toutes les communautés monastiques et plus largement religieuses l’ont traduit en actes, des Bénédictins aux Dominicains, en passant par les Cisterciens et les Franciscains, et d’autres plus tard, parmi lesquelles les plus politiques, à savoir les Jésuites.
En dehors du religieux, qui, dans l’histoire, a incarné la fraternité ?
Il y a bien sûr les hommes des luttes et des résistances politiques et sociales, parmi lesquels des figures historiques, encore aujourd’hui très populaires et inspirantes : Martin Luther King, Gandhi, et plus généralement ceux qui appellent à la « non-violence », l’histoire des hommes libres et égaux ne pouvant, selon eux, advenir qu’à cette condition. La non-violence n’est pas une absence d’action, elle est l’action par excellence, celle qui permet de faire durablement fondation. On peut donc sans doute citer aussi Mandela, dans son dernier moment ubuntu, après qu’il eut précisément renoncé à la lutte violente. Viennent ensuite des figures hybrides, issues du religieux et de la société civile, comme l’abbé Pierre. Bien sûr, tout homme politique peut se revendiquer de la fraternité, même si cela relève souvent de l’instrumentalisation communicationnelle. Et c’est une notion difficile à manier pour un représentant politique, car il y a quelque chose de « transgressif » dans la fraternité : précisément sa sacralité, son pas de côté, le fait qu’elle soit du côté de la légitimité (l’éthique, la question du juste) et non de la légalité (le droit).
Et aujourd’hui, quelles sont pour vous les œuvres qui illustrent la fraternité ?
Dans sa version cinématographique romanesque, il y a les films de Capra. Aujourd’hui, je la vois en acte dans les réseaux privés sur WhatsApp, les organisations des commons [un espace ou une ressource dont l’usage est partagé par une communauté de personnes], les mouvements sociaux internationaux, les marches des jeunes pour le climat.
Dans la devise républicaine, « liberté » et « égalité » sont des droits ; on peut penser que la « fraternité » est soit un devoir, soit une valeur morale. Est-elle le parent pauvre ?
D’abord, ni la liberté et l’égalité ne sont exclusivement des « droits », sinon la première serait toute-puissance et la deuxième tournerait à l’égalitarisme. De même, la fraternité républicaine n’est pas imposée comme un devoir, mais consentie – le « contrat social » promis par l’État de droit cherche à la rendre désirable. Nous voyons cette devise en trompe-l’œil, par un défaut d’optique, comme s’il y avait d’un côté les droits, de l’autre le devoir, alors que tout est dialectique. La fraternité révolutionnaire était très normative, au sens où, si nous faisons partie du même corps, gare à celui qui veut s’en soustraire ; mais la fraternité qui naît avec 1848 et qui se consolidera plus tard avec la IIIe République est une fraternité qui touche davantage à la question sociale naissante – elle concerne la notion d’assistance sociale et publique, autrement dit la matrice de ce qui deviendra plus tard la Sécurité sociale. Aujourd’hui, nous sommes les enfants de 1848 plutôt que ceux de la Révolution. Je trouve désastreux que l’on puisse faire de la fraternité un parent pauvre, que l’on veuille concrétiser en droit positif la liberté et l’égalité, puis que l’on juge pour la fraternité que l’horizon désincarné suffira. Comme disait Althusser, c’est l’« Internationale des bons sentiments ». Au contraire, ces trois termes ont tous des dimensions symboliques et normatives : ce sont des principes formels qui ont l’obligation de se traduire concrètement.
Dans notre époque contemporaine, cette notion de fraternité a-t-elle repris des couleurs ou une dimension plus forte ?
1985, avec le slogan « Touche pas à mon pote » lancé lors du grand concert de SOS Racisme, a incarné la fraternité, avec une coloration spécifique : celle du retour de la gauche au pouvoir quatre ans plus tôt. La gauche représente une tradition dans laquelle la notion de fraternité se combine avec celle de l’altérité : on est frère avec l’autre, avec celui qui ne nous ressemble pas, voire qui n’est pas de notre pays. La droite, plus traditionnellement, incarne une fraternité du même, du semblable, de la patrie. Où mettre le curseur de l’altérité dans cette notion de fraternité est le point sur lequel divergent ces deux courants politiques.
Aujourd’hui, l’économie solidaire et les commons sont des héritiers de ces moments de fraternité où l’on cherche à combiner un vivre-ensemble respectueux des équilibres naturels, biosphériques, mais aussi des vulnérabilités individuelles. Avec eux s’invente une gouvernance « endogène », portée par les parties prenantes elles-mêmes qui, bien que différentes, sont jugées égales en dignité, voire en pouvoir. La philosophie morale dite du care relève également d’une telle conception.
Puis, il y a bien sûr les moments liés à la « catastrophe », lorsque le corps de la nation est attaqué dans sa sacralité et dans son indivisible. On pense bien sûr aux attentats terroristes de janvier 2015 et à cette grande marche qui a suivi. Mais dans le slogan « Je suis Charlie », on voit bien que notre approche même de la fraternité passe par le « je ». On n’a pas dit : « Tu es mon frère » ou « Charlie est mon frère ». Ce n’est pas la figure de l’autre qu’on a soulignée, mais la figure de soi, qui est tuée à travers celle d’un autre.
Cette période assez étrange que nous avons vécue avec l’épidémie et les craintes que celle-ci a soulevées a-t-elle restauré ou abîmé les liens de la fraternité ?
Dans un premier temps, je pense que le consentement au confinement reposait sur le sentiment qu’ont eu les Français d’être fraternels. Ils n’ont pas mis en avant la restriction de liberté. Ils ont considéré que par ce geste-là, ils produisaient un comportement collectif, une obligation de responsabilisation qui par certains côtés peut avoir des allures de « liberté positive ». Ils témoignaient du corps indivisible. En se confinant, on allait normalement protéger le maximum de personnes. C’était ça, le contrat implicite, jusqu’aux remises en cause normales de l’efficacité de cette obligation, avec aussi la réalité du coût humain et du risque de mort sociale qui sont apparus depuis. Les gens ne sont pas nécessairement moins fraternels maintenant, mais la définition de la fraternité bouge, ou plutôt le contexte se modifie et modifie le périmètre auquel est censée s’adresser la fraternité : certes, il y a eu environ 30 000 morts en France, mais des millions de vies seront bouleversées par la crise socio-économique, pour des années. Idem avec le cas des masques : en contexte normal, porter un masque de façon permanente attente à la civilité, à la pacification sociale, à la confiance – tendre la main, offrir son visage à l’œil, c’est forcément un signe de paix et de fraternisation possible –, mais en contexte épidémique, il faut donner au masque une autre signification, celle de la prise en considération de la santé de tous, la mienne, mais aussi celle des plus vulnérables. Donc porter un masque signale que l’on se soucie de ce « réel ». Tout l’enjeu, ensuite, est de monter en gamme dans la question de la prévention sanitaire, sans pour autant devenir un hygiéniste paranoïaque.
Qu’est-ce qui menace la fraternité, aujourd’hui ?
Les inégalités. On revient à la dialectique du fronton républicain. Les êtres humains ne refusent pas les épreuves, s’ils ont le sentiment d’un réel partage des risques face à elles : on est d’accord pour traverser l’épreuve si ceux-ci sont mutualisés, si les inégalités nouvelles qui naîtront de cette nouvelle situation sont partagées. Ce qui peut mettre en danger la fraternité demain, c’est l’existence de passe-droits, le sentiment que certains ont davantage les moyens de traverser les difficultés que d’autres. Ce ressenti pourrait produire une fragmentation très forte. Sans oublier que nos sociétés ont perdu la culture de la fraternité : nous en avons une culture déclarative, mais plus une culture normative, « incorporée » – c’est-à-dire qui transforme réellement le vécu collectif et individuel.
Pourquoi ?
Parce que nous sommes des sociétés individualistes qui manquons la complexité de l’idée d’individuation : la fraternité n’est même plus un droit ou un devoir, elle est une belle idée, un vœu pieux. Nous oublions le caractère structurant, édifiant, de la fraternité, au sens où elle nous constitue en tant que société et aussi en tant qu’humains. Donc les inégalités sont un réel problème pour la fraternité, mais ne nous leurrons pas, nous avons aussi un vrai problème de déficit de culture incorporée de la fraternité.
À quel moment de notre vie collective, de notre histoire, cette fraternité a-t-elle été vraiment vécue et incorporée, avant d’être amoindrie par l’individualisme ?
Sincèrement, je pense n’avoir jamais connu cette époque. Or, si j’écoute ma grand-mère, la fraternité existait bel et bien dans les années 1920-1930, de façon très ordinaire dans la société française. Après 1945, les Français ont vécu la Libération et la reconstruction, peut-être aussi l’envie de se séparer de tout ce qui avait précédé, de solder « l’étrange défaite » comme l’a nommée Marc Bloch, d’oublier. Et le desserrement du lien a progressé davantage encore au cours des Trente Glorieuses. Les années 1980 signent l’apothéose de l’ère individualiste. Il faut rappeler néanmoins que l’incorporation de la fraternité, son vécu au quotidien, c’est très lourd, étouffant, comme peut l’être un lien communautaire invasif. Il ne s’agit pas de revenir à cette vision des choses. Mais pour l’instant nous n’avons pas encore trouvé la médiane, entre une certaine façon de concevoir la fraternité qui peut aboutir à un sentiment d’aliénation et l’indifférence qui vire aussi à la réification [la réduction des personnes à des choses]. La solidarité est peut-être notre manière la plus sûre, même si elle est exclusivement profane, de vivre la fraternité.
En quoi la fraternité peut-elle être pesante ?
À cause de la logique de don et de contre-don mise en lumière par l’anthropologue Marcel Mauss. La dette envers l’autre ne s’arrête jamais. C’est à vie, c’est intrinsèque, c’est incorporé. Depuis, la culture démocratique individuelle a de plus été couplée au délire de l’argent, qui lui est plutôt une force de séparation : l’argent clôt l’échange, la dette symbolique cesse enfin.
L’argent clôt ?
Oui, il clôt : vous donnez de l’argent et vous n’avez plus rien à devoir. Or, la fraternité est un enfant de l’économie du don et du contre-don. La dette est infinie, réciproque, mais infinie.
Certains estiment qu’en payant des impôts, ils se défaussent du devoir de fraternité sur l’État et ses services. Qu’en pensez-vous ?
Notre société est marquée par l’avènement de la question sociale comme question politique. Comme l’a décrit Durkheim, on ne laisse plus la compassion, l’obligation de charité, à la société philanthropique civile ou religieuse. Cette obligation devient politique. Elle sort alors de la morale ou de la spiritualité. Elle se dé-moralise, se désindividualise pour devenir administrative, voire bureaucratique, avec le risque de déshumanisation que cela implique, et qui est ressenti par beaucoup de ceux qui bénéficient des aides allouées. Celles-ci devraient être automatisées. Au lieu de cela, les individus doivent prouver, via des indicateurs, qu’ils sont des « victimes » pour pouvoir les toucher. Nous avons inventé, après la tarification à l’activité, la fraternité à l’activité.
Quelle est la différence entre ce qu’on appelle le care et la fraternité ?
Dans le care (que l’on peut traduire par le « soin », la sollicitude, le souci de l’autre), comme dans la fraternité, le pilier qui structure le jugement moral n’est pas l’intérêt du moi. Dans les deux cas, le sujet se décentre pour prendre en considération le point de vue des parties en présence, notamment celui des plus fragiles dans leur vulnérabilité. En revanche, le care se positionne d’emblée hors d’une sacralité qui reste la vérité de la fraternité. Dans les années 1950, le psychanalyste anglais Donald Winnicott a établi les premières différenciations entre le cure (« guérir », en objectivant la maladie, au risque de chosifier le malade) et le care (« soigner », en prenant en considération la personne). Il va démontrer que le care est ce geste fondamental en amont de tout, un geste comme matriciel. C’est la préoccupation primordiale de la mère – archétype du geste thérapeutique. Winnicott parle d’« élaboration imaginative » : par son soutien, le parent – en l’occurrence, la mère à cette époque de la vie – donne à l’enfant un sentiment de confiance dans le monde. Elle lui donne le sentiment qu’il peut espérer, qu’il peut attendre quelque chose de ce monde.
Propos recueillis par ÉRIC FOTTORINO
« Ce sont les inégalités qui menacent la fraternité »
Cynthia Fleury
La philosophe Cynthia Fleury évoque les origines sacrées de la fraternité, la façon dont les révolutions de 1789 et 1848 s’en sont emparées, ainsi que la place qu’elle occupe dans notre société au voisinage de la solidarité et du care.
[Rouge]
Robert Solé
En supposant que le bleu exprime la liberté et le blanc l’égalité, la fraternité ne peut être que rouge. C’est la couleur par excellence, celle qu’on utilise à tout propos, pour alerter, freiner, encourager, exciter… Peu discrète, très courtisée, elle est consciente de son …
L’ubuntu en Afrique du Sud, un mot fierté devenu suranné
Chloé Buire
Comment expliquer l’ubuntu, ce concept difficile à traduire en langue occidentale ?
Le mot ubuntu est devenu un slogan en Afrique du Sud – on le retrouve sur les bâtiments et dans les discours. Il signifie en…