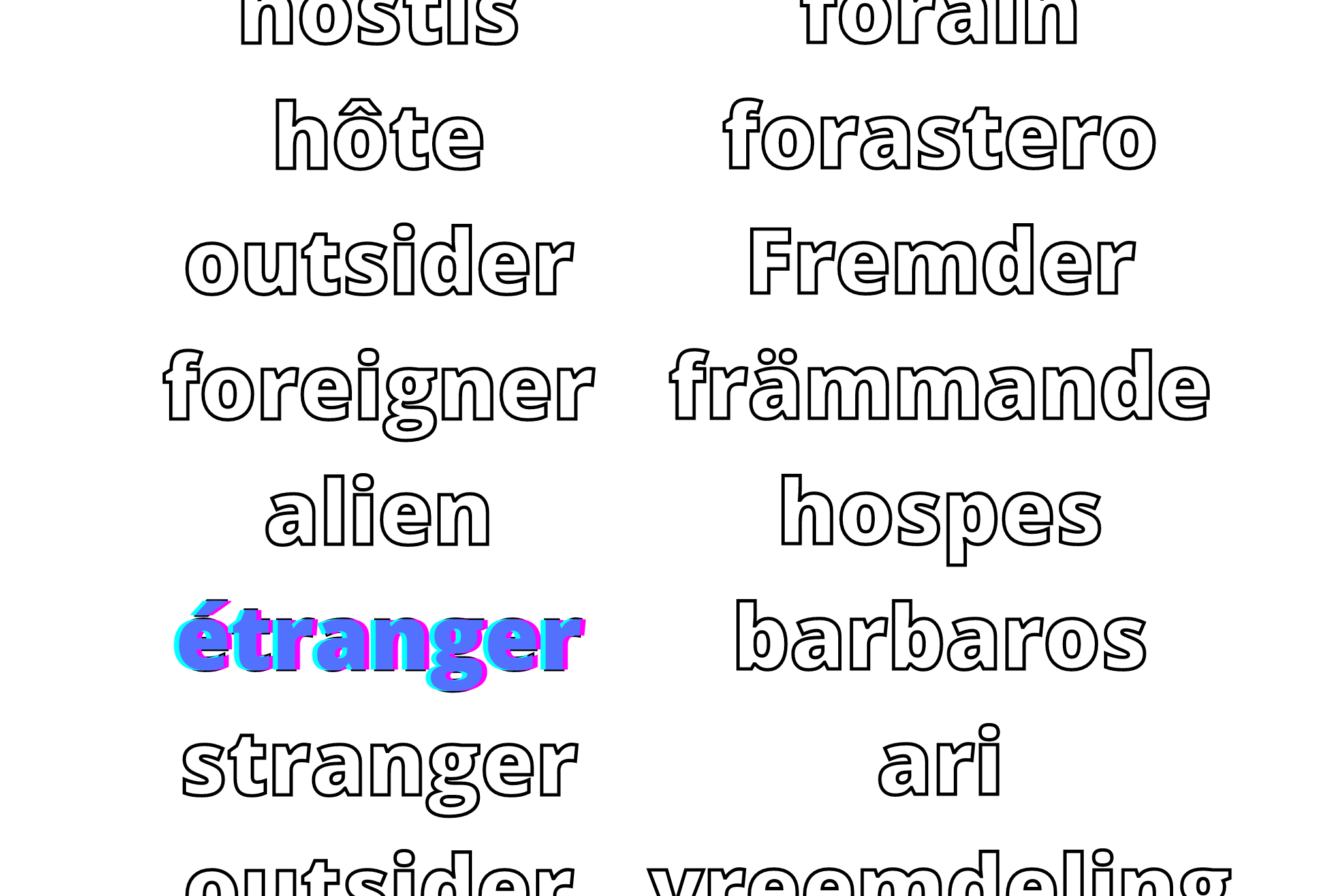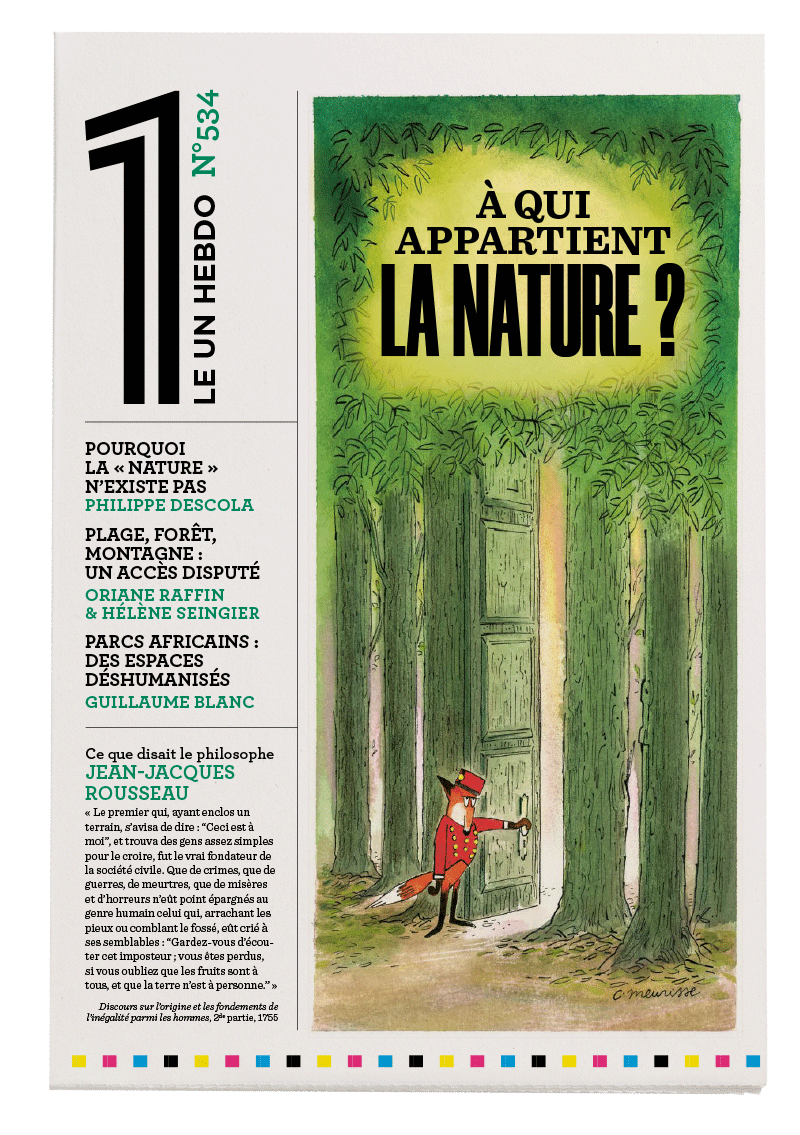Les noms de l’étranger
Temps de lecture : 5 minutes
On l’appelle The Stranger aux États-Unis, mais The Outsider en Grande-Bretagne : depuis 1946, l’œuvre d’Albert Camus est connue sous deux titres différents de part et d’autre de l’Atlantique. Faut-il y voir une subtile distinction culturelle ? Ou une de ces bizarreries éditoriales que prisent les universitaires ? Dans En quête de « L’Étranger » (Gallimard, 2016), Alice Kaplan fait la biographie de ce roman désormais traduit en plus de soixante langues. Et raconte comment, à la sortie de la guerre, les éditeurs anglo-saxons Knopf (aux États-Unis) et Hamilton (en Angleterre) achètent séparément les droits de publication du livre, puis décident de se partager les coûts de la traduction. Cette tâche est confiée à Stuart Gilbert, qui inscrit The Stranger sur son manuscrit… Mais ce choix reste une prérogative de l’éditeur. Et, parce qu’un roman polonais vient de paraître en Angleterre sous ce titre, Hamilton choisit finalement The Outsider, qu’il trouve « plus frappant et approprié ». Il informe tardivement les Knopf de sa décision : les couvertures américaines sont déjà imprimées. Aux États-Unis, le livre paraîtra donc sous le titre prévu par le traducteur.
L’histoire pourrait paraître anecdotique. Mais elle illustre bien la difficulté de traduire le mot français étranger. Car il ne désigne pas seulement le ressortissant d’un autre pays, comme alien ou foreigner en anglais, mais plus largement celui qui ne fait pas partie d’une communauté. Utilisé comme adjectif, il peut qualifier qui est extérieur à un groupe ou ne prend pas part à ses projets. « Étranger, qui peut savoir ce que ce mot veut dire, écrit Camus dans ses Carnets en mars 1940. Étranger, avouer que tout m’est étranger. » Son héros, Meursault, est un colon de l’Algérie française. Il a le statut de citoyen. S’il est étranger, c’est moins sous le regard des autres, que parce qu’il est étranger à sa propre vie. Un être en dehors, un outsider, mais aussi « un homme libre », « un homme comme les autres », pour reprendre deux sous-titres figurant sur une version manuscrite.
« À chaque mot ses nuances, l’accent est mis sur une exclusion tantôt juridique, tantôt sociale »
Quel paradoxe : réfléchir aux différentes appellations de l’étranger dans les langues indo-européennes, c’est se rendre compte combien nous sommes proches – nos mots ont été brassés dans un même creuset, un même melting pot linguistique. Ainsi foreigner vient de l’ancien français forain ; tout comme forastero (« étranger » en espagnol), ce sont de lointains descendants du latin foris, « dehors »… Alien était un mot français, attesté dès le XIe siècle, et que nous a emprunté l’anglais, avant que le film de Ridley Scott ne le remette au goût du jour dans notre langue pour désigner les extraterrestres… Quant à Fremder (« l’inconnu », « l’étranger » en allemand), il est de la même famille que le néerlandais vreemdeling et que le suédois främmande, et un lointain cousin de l’adverbe anglais from… À chaque mot ses nuances, l’accent est mis sur une exclusion tantôt juridique, tantôt sociale. L’étranger ne vient pas seulement d’ailleurs, il peut aussi être « étrange ». Il concentre dans sa personne l’ambiguïté de nos rapports à l’autre, à la fois familier et distant, attirant et effrayant… « J’ai peur, j’ai peur du grand méchant vous. Ah ! la vilaine bête que ce vous », chantait Serge Gainsbourg.
L’histoire de l’hospitalité grecque nous apprend que tous les voyageurs ne sont pas des étrangers comme les autres. Au sixième chant de l’Odyssée, Nausicaa fait apporter nourriture et vêtements à Ulysse. S’il est un migrant et ne fait pas partie de la famille, du clan ou de la tribu, il parle grec, il prie les mêmes dieux et, pour cela, il appartient au même peuple. C’est un xenos, un étranger avec qui la xenia (« l’alliance ») est possible. Loin de tout sentiment xénophobe, lui aussi, si l’occasion se présente, il prêtera secours, il ouvrira son foyer durant quelques jours. À un don, il pourra répondre par un contre-don. Il se distingue donc du citoyen autant que du barbaros, commerçant ou pirate, avec lequel aucune réciprocité n’est possible.
« J’ai peur, j’ai peur du grand méchant vous », chantait Gainsbourg
Le français hôte conserve cette idée de réciprocité : le mot désigne à la fois l’accueilli et l’accueillant. Il vient du latin hospes, celui qui reçoit, mais est aussi le parent lointain d’un autre mot latin, hostis. L’affaire a passionné les linguistes. Car le mot hostis a évolué durant l’histoire de Rome et cette évolution a été commentée par les auteurs classiques, comme Cicéron… Résumons : au Ve siècle avant Jésus-Christ, on appelle hostis l’étranger privilégié auquel Rome reconnaît des droits – de divine et privée, l’hospitalité grecque est devenue une affaire juridique. Mais le mot conserve l’idée d’alliance ; il n’est pas péjoratif. À mesure que Rome accroît sa domination sur l’Europe, elle inaugure une politique de naturalisation, très différente de celle de la Grèce antique, car elle ne lie pas la nationalité au territoire. Et, à mesure que les étrangers deviennent des citoyens romains, la signification de hostis se déplace pour désigner ces irréductibles voisins qui résistent encore et toujours à l’envahisseur : de véritables « ennemis ». Et voilà comment de ce même mot, hostis, ont pu dériver guest (« l’invité » en anglais), mais aussi hostile.
Faut-il y voir une fatalité s’acharnant sur les étrangers ? La peur de la différence doit-elle toujours l’emporter ? À la fin du roman de Camus, Meursault souhaite qu’il y ait beaucoup de spectateurs le jour de son exécution, et qu’ils l’accueillent avec des cris de haine, comme si la détestation lui était un ultime secours contre la solitude. C’est ignorer qu’en sanskrit le mot ari a connu une évolution inverse à celle du hostis latin. Alors que dans les Veda il désigne un ennemi, il en est venu à signifier « ami » ; et arya signifie « noble », « pur » dans les textes bouddhistes. C’est en 1938, en pleine aryanisation de l’Allemagne nazie, que le linguiste Paul Thieme établit son sens originel : « hôte », « étranger »… Quelle belle réponse de la science au délire xénophobe que ce lien tissé entre les Aryens et une tradition généreuse de l’accueil !
« Cette difficulté de se sentir dans le monde est très actuelle »
Michel Agier
Michel Agier, spécialiste de la question des migrations et des réfugiés, développe à partir de l’œuvre de Camus une réflexion sur le sentiment de mal-être et d’inadéquation.
[100 %]
Robert Solé
Le journaliste et écrivain Robert Solé raconte ici son parcours personnel : né au Caire, il a choisi, demandé et obtenu par naturalisation d'être français.
Felix Nussbaum, le grand Autre
Thomas Schlesser
Un décryptage par l'historien de l'art Thomas Schlesser d’un tableau de Felix Nussbaum, peintre assassiné par les nazis.