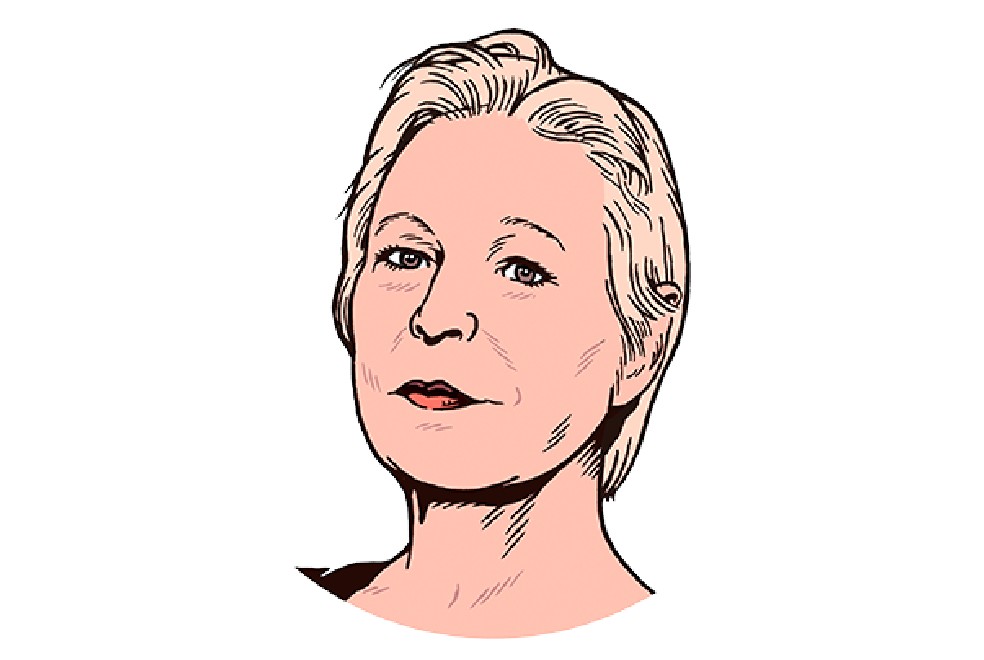Grains de sable
Temps de lecture : 4 minutes
Ma mère était espagnole, je l’ai souvent dit.
Née dans un village de la Haute-Catalogne, elle échoua, après une longue marche, dans un village du sud-ouest de la France en février 1939, où elle vécut jusqu’à sa mort.
Ma mère, que j’aimais, est toujours vivante en ma mémoire. Mais jamais je ne pense à elle comme à une étrangère.
Jamais.
Bien sûr elle malmenait le français, bien sûr elle disait n’avoir pas les manières idoines, bien sûr elle se sentait regardée comme venant d’ailleurs, bien sûr elle continuait à cuisiner en espagnol, à chanter en espagnol, à rire en espagnol, à s’encolérer en espagnol, à jurer en espagnol et à rêver en espagnol.
Mais alors pourquoi ma mère échappe-t-elle à mes yeux à ce qualificatif d’étrangère dont elle avait pourtant le statut administratif ?
Et pourquoi les migrants syriens, ukrainiens, afghans, kurdes, maghrébins…, dont la nationalité n’est pas la mienne, ne me semblent pas, non plus, relever de cette qualification ?
Je pense à ces femmes et ces hommes hospitalisés dans la clinique psychiatrique où j’exerçais comme médecin résident
Pourquoi ?
Est-ce parce que j’ai rencontré des étrangers dont l’étrangeté me semblait incomparable avec celle de ma mère et des migrants que je viens de citer ?
Je pense à ces femmes et ces hommes hospitalisés dans la clinique psychiatrique où j’exerçais comme médecin résident dans les années 1980, et où je passais mes jours et mes nuits pendant plus de quatre ans.
Je pense à eux, qu’on appelle fous.
Des estropiés de l’âme, des effondrés du dedans, des meurtris, des cabossés, des maltraités de la vie.
Des êtres souffrant atrocement de leur étrangeté, souffrant comme il est inconcevable de souffrir.
Des exclus mis au rebut par leur famille et les institutions.
Des inaptes au travail, des inaptes au système.
Des incompris suscitant la peur et le rejet, bien que parlant la même langue et nés dans le même pays que ceux qui les pointaient du doigt.
C’est vers eux, immédiatement, que va ma pensée lorsqu’on prononce devant moi ce terme d’étranger.
Vers Gérard B., un mathématicien qui vivait sur Vénus et ne parvenait pas, disait-il, à atterrir.
Vers Monique P., qui ne reconnaissait pas son père, lequel n’avait pour elle aucune sorte d’affection.
Vers Lucile D., habitée à son insu par un être malfaisant qui la gouvernait et décidait entièrement de sa vie et de ses gestes.
Vers Jacques L., qui avait tenté d’assassiner son géniteur, un homme hideux, et qui, après la tentative, fut secoué d’un rire qui dura un jour entier et dont je n’ai jamais oublié la démence.
Vers Aurélien, qui entendait en direct la voix de Dieu.
Et vers tant et tant d’autres.
Je pense, en somme, à tous ceux qui, en tout pays, ne se plient que difficilement aux règles d’un système
Je pense aussi à ces indifférents dont Camus a si bien tracé le portrait. À ces indifférents plus nombreux qu’on ne croit. Qui sont si étrangers à l’humaine condition, si peu concernés par elle, si imperméables à ses douleurs et à ses peines, si seuls en fin de compte, que l’existence des autres ne les concerne en rien.
Je pense à Van Gogh, à l’encontre duquel une pétition fut signée par une trentaine d’Arlésiens afin qu’il dégageât. Van Gogh dont le génie, les manières, la rousseur, le port d’un chapeau surmonté de chandelles pour mieux y voir la nuit, faisaient de lui un être qui déroutait, dans leur confort mental, ceux qui vivaient une autre existence que la sienne et obéissaient à d’autres lois, d’autres habitudes et d’autres exigences que les siennes.
Je pense à Camille Claudel, si étrangère en sa famille que celle-ci la fit interner à vie. Camille Claudel, l’audacieuse, qui défia la morale sexiste de l’époque en sculptant des nus avec la même liberté que les hommes, et qui, après dix ans de passion amoureuse avec Rodin, fut abandonnée de celui-ci.
Camille Claudel que son frère fit enfermer à vie, après la mort du père, seul à la protéger, et qui vécut dans un asile pendant trente ans, privée de tout ce qui fait le bonheur de vivre, ainsi qu’elle l’écrivit à son cousin.
Je pense à Hölderlin, lui aussi enfermé de force comme le pire des malfrats dans la clinique du Dr Johann Heinrich Ferdinand Autenrieth à Tübingen, où il subit un traitement si violent qu’il en fut brisé, mais dont il parvint à s’échapper après neuf mois d’enfer.
Je pense, en somme, à tous ceux qui, en tout pays, ne se plient que difficilement aux règles d’un système que philosophiquement, moralement, intellectuellement, affectivement, ils questionnent, contestent ou désapprouvent par leur comportement, leurs actes ou leurs paroles.
Des étrangers au système, qui sont comme des grains de sable dans la machine, et qu’il s’agit de mettre au pas, de manière plus ou moins brutale.
« Cette difficulté de se sentir dans le monde est très actuelle »
Michel Agier
Michel Agier, spécialiste de la question des migrations et des réfugiés, développe à partir de l’œuvre de Camus une réflexion sur le sentiment de mal-être et d’inadéquation.
[100 %]
Robert Solé
Le journaliste et écrivain Robert Solé raconte ici son parcours personnel : né au Caire, il a choisi, demandé et obtenu par naturalisation d'être français.
Felix Nussbaum, le grand Autre
Thomas Schlesser
Un décryptage par l'historien de l'art Thomas Schlesser d’un tableau de Felix Nussbaum, peintre assassiné par les nazis.