« Le seul Christ que nous méritons »
Temps de lecture : 9 minutes
Qui est l’Étranger ? Depuis sa parution en 1942, le roman de Camus, traduit en quarante langues et, aujourd’hui encore, le plus gros succès commercial de la maison Gallimard, n’a cessé de raviver cette question dans l’esprit de ses millions de lecteurs à travers le monde. De Sarraute à Blanchot, de Robbe-Grillet à Barthes, sans oublier Sartre, dont l’« Explication de L’Étranger » proposée dans Les Cahiers du Sud est restée la plus célèbre, les commentateurs se sont attelés à déchiffrer le mystère Meursault, personnage central du roman de Camus. Tant d’encre a coulé au sujet d’une énigme que ce dernier semble pourtant avoir résolue d’une seule phrase, dans ses Carnets : « L’Étranger décrit la nudité de l’homme face à l’absurde. » Derrière son apparente simplicité, cette description condense toute l’ambivalence d’une figure littéraire et philosophique souvent en partie incomprise.
Cette « nudité » de l’homme désigne d’abord un dénuement face à la prise de conscience brutale de l’absurdité de notre condition. L’étrange comportement de Meursault, qui laisse les phénomènes le frapper continuellement tel le ressac de la vague sur le rocher, traduit le fait que, ayant renoncé à trouver un sens à un monde et à une existence en son sein qui n’en ont aucun, il n’a plus les moyens d’ordonner ses perceptions de manière signifiante, mais seulement de les recevoir passivement. Le cérémonial social dont nous revêtons nos expériences (les funérailles qui suivent le décès de la mère, ou le fait de nommer son désir de l’autre « amour » et de le consacrer par les liens sacrés du mariage) n’est, aux yeux décillés de Meursault, qu’une vaine tentative de recouvrir d’un sens et d’une valeur prétendument objectifs des situations qui, dans l’absolu, n’ont d’autre signification que celle qu’on veut bien leur inventer. Tel le travailleur frappé par l’absurde dans Le Mythe de Sisyphe, le protagoniste de L’Étranger est celui devant qui « les décors s’écroulent ». Celui chez qui la mécanique bien huilée du quotidien métro-boulot-dodo s’est enrayée au contact corrosif du pourquoi, de la recherche de sens condamnée à toujours rentrer bredouille. « Dans un univers soudain privé d’illusions et de lumières, l’homme se sent un étranger », parce que son besoin viscéral de trouver une raison à tout ce qui est, une signification à tout ce qui lui arrive, bute systématiquement sur le silence têtu du monde. « Ça m’est égal », répond Meursault à quiconque s’enquiert de son jugement sur les événements, car à quoi bon s’en soucier, si l’univers lui-même s’en fout ?
La condamnation à mort de Meursault est ainsi le prix à payer pour pouvoir continuer à se bercer d’illusions
« Ce divorce entre l’homme et sa vie, l’acteur et son décor, c’est proprement le sentiment de l’absurdité », explique Camus dans son essai. Meursault est cet acteur qui rend son tablier. Celui qui, ayant vu les conventions sociales pour ce qu’elles sont – des significations arbitraires artificiellement imprimées à nos comportements et à nos rituels, les faisant passer pour des vérités objectives et définitives comme on tire fébrilement sur la corde en appelant « danse » les gesticulations du pantin convulsant sous nos doigts –, ne sait plus comment jouer le jeu sans vendre la mèche. Tel le prisonnier qui s’est libéré de la caverne dans l’allégorie de Platon, il a compris que les ombres sur la paroi n’étaient que des mirages. Il ne voit rien de plus, dans la multitude de règles dont nous tapissons la vie en commun, qu’une tentative désespérée pour dissimuler sous un vernis signifiant l’absurdité de notre condition. Et c’est pour témoigner, face à une société encore viscéralement attachée aux consolations qu’apporte la comédie sociale, de cette seule évidence, vérité ultime de notre présence au monde, qu’il est prêt à mourir en martyr.
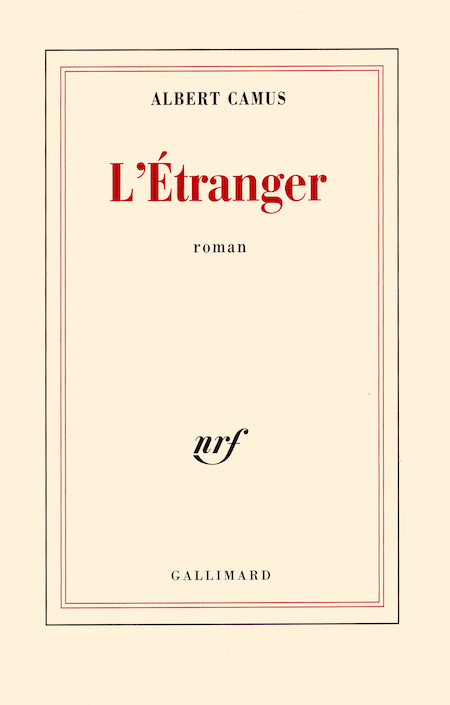
La condamnation à mort de Meursault (« le seul Christ que nous méritions », dira Camus dans sa préface à l’édition américaine de son roman en 1958) est ainsi le prix à payer pour pouvoir continuer à se bercer d’illusions qui nous consolent de la finitude et de l’absurdité de notre existence en nous épargnant la peine d’y penser. Tels les prisonniers du mythe platonicien susmentionné, qui réservent un accueil froid à leur ancien codétenu revenu en homme libre mettre fin à la supercherie et s’en débarrassent pour ne pas avoir à supporter sa révélation, la réponse prévisible de la société à l’attitude dissonante de Meursault est de le détruire, comme on supprime une anomalie pour sauver les apparences de la normalité. La célèbre scène du procès, où il devient vite apparent que Meursault est jugé moins pour avoir tué quelqu’un que pour « avoir enterré une mère avec un cœur de criminel » (dixit le procureur) file la métaphore de l’étrangeté jusqu’au bout, en montrant que le train de l’aliénation siffle toujours trois fois : étranger vis-à-vis d’un univers sourd à ses questionnements, étranger vis-à-vis de lui-même, l’homme absurde ne peut qu’être officiellement déclaré étranger à la communauté des hommes. Si le procureur veut faire tomber la tête de Meursault, c’est, dit-il, parce qu’il tremble d’horreur « devant un visage d’homme où [il] ne li[t] rien que de monstrueux ». Parce que ce visage qui n’a pas versé une larme à l’enterrement de sa mère, ce visage qui ne s’exprime pas dans la langue émotionnelle du pays, a l’audace de ressembler néanmoins à celui de monsieur tout le monde. Trop étranger pour s’intégrer pleinement à la société en épousant ses codes, il ne l’est cependant pas assez pour pouvoir y demeurer sans menacer de contaminer les autres de sa lucidité. On assassine Meursault comme on briserait un miroir : pour conjurer le risque vertigineux de finir par s’y reconnaître.
On assassine Meursault comme on briserait un miroir : pour conjurer le risque vertigineux de finir par s’y reconnaître
Une même angoisse fait qu’on sature notre quotidien de décisions, règles, gestes et discours porteurs de significations conventionnelles, et qu’on ne peut s’empêcher de meubler le silence gêné qui s’empare de nos conversations : l’horreur du vide. La peur que le trou béant laissé par la prise de conscience absurde ne finisse, si on le laisse excessivement transparaître sous les masques, par regarder en nous, selon le mot de Nietzsche, et par nous engloutir. De ce point de vue, l’exclusion de Meursault n’est que la partition originale dont toutes les idéologies discriminatoires sont autant de variations mortifères. Figer l’identité du groupe, l’indexer sur un modèle unique, contraignant et immuable, ne suffit pas à en garantir la pérennité et, avec elle, à se protéger des tremblements qui accompagnent nécessairement l’incertitude de soi, qu’elle soit individuelle ou collective. Rien ne vaut, pour ce faire, la fabrication d’une altérité effrayante, barbare aux portes de la ville ou infiltré jusque dans nos rangs (archétype au fondement du fantasme raciste et complotiste du « grand remplacement »), dont la seule présence justifie que le groupe se recroqueville sur lui-même comme on se retranche derrière les fortifications quand la ville est assiégée. La figure de « l’Arabe » abattu sur la plage n’en est-elle pas la démonstration implicite ? « Plus étranger que l’Étranger lui-même », cet homme qui meurt sans nom, sans histoire et sans autre substance que la menace qu’il incarne par son couteau, a pu apparaître, aux yeux d’Edward Saïd (L’Orientalisme, 1978), comme le symptôme d’un impensé colonial dont Camus se serait fait l’émissaire à son insu. Ou peut-être cette présence-absence vise-t-elle, justement, à laisser deviner le spectre refoulé de la colonisation, relégué à l’arrière-plan comme Meursault est rejeté en marge de l’humanité, et dont Camus a montré dès 1939, dans une série de onze articles rassemblés sous le titre Misère de la Kabylie, qu’il hantait la France. À ceux qui s’agrippaient (et dont on reconnaîtra aisément aujourd’hui les héritiers à l’extrême droite) à l’identité française en prévenant : « Prenez garde, l’étranger va s’en saisir », Camus rétorquait dans son reportage : « Mais ceux qui, en effet, pourraient s’en saisir se sont déjà jugés à la face du monde par leur cynisme et leur cruauté. »
Le barbare est bien, décidément, comme le pensait Lévi-Strauss, d’abord l’homme qui croit à la barbarie
La figure du prisonnier arabe dans « L’Hôte », nouvelle tirée du recueil de 1957 L’Exil et le royaume, écrite dans le contexte de la guerre d’Algérie, donne à voir, au travers de son trio de personnages, la manière dont la déshumanisation du peuple colonisé (« l’Arabe ») par le pouvoir colonisateur (le gendarme Balducci, qui considère son prisonnier comme un animal) génère une relation d’étrangeté, mélange de peur, d’incompréhension et de rancœur, qui obscurcit jusqu’aux cœurs les plus soucieux de s’en garder (l’instituteur Daru, révolté par le traitement réservé au prisonnier et refusant de le livrer aux autorités françaises, sachant le sort qui l’attend, peine néanmoins à communiquer avec lui et, bien que lui ayant laissé la possibilité de s’évader, se retrouve menacé de mort par ses frères). Le barbare est bien, décidément, comme le pensait Lévi-Strauss, d’abord l’homme qui croit à la barbarie. Celui qui, en tissant l’épouvantail de l’étranger de ses propres incertitudes et insécurités, objectivées et extériorisées pour s’en préserver, finit par devenir étranger aux idéaux d’humanité dont il se prétend pourtant le gardien, et par donner vie aux démons qu’il redoute. Le procès de Meursault est, en cela, tout comme les réquisitoires contre l’étranger soupçonné de venir chez nous pour nous dépouiller, l’auto-accusation d’une société qui, malade de ne pouvoir se donner un visage lisse et éternel, agonise à la vue du reflet méconnaissable qu’elle se renvoie à elle-même.
Comment imaginer qu’il puisse, à l’image de Sisyphe, être heureux de son sort ?
On aurait tort, cependant, de voir dans l’étranger une figure purement négative, la carcasse désincarnée de l’homme moderne recrachée par la Bête absurde. Car, chez Camus, « la révolte ne peut se passer d’un étrange amour » (L’Homme révolté), le « non » ne résonne qu’en se répercutant sur un « oui », et le vide lui-même annonce une plénitude. C’est paradoxalement au seuil de la mort que Meursault, jusqu’alors apathique, semble revivre, enfin. S’abandonnant à la « tendre indifférence du monde », les mains dans les chaînes, il se sent plus libre qu’il ne l’avait jamais été les pieds dans l’eau. Comment imaginer qu’il puisse, à l’image de Sisyphe, être heureux de son sort ? C’est qu’en faisant le deuil des illusions dont on enrobe l’existence, on s’autorise à percevoir en elle la même beauté, écrasante et grisante à la fois, que celle de la page blanche. Il faut « se sentir […] assez étranger à sa propre vie », à ses routines comme à autant de prétextes dispensables, pour saisir que le monde, par son indifférence même, nous offre la possibilité d’un véritable recommencement, celle « d’accepter de vivre dans un tel univers et d’en tirer ses forces, son refus d’espérer et le témoignage d’une vie sans consolation » (Le Mythe de Sisyphe). La tension qu’incarne Meursault entre passivité et exaltation dessine ici un pont entre le cycle de l’absurde et l’éthique du soleil qu’exposait Noces : « L’espoir, au contraire de ce qu’on croit, équivaut à la résignation. Et vivre, c’est ne pas se résigner. » Renoncer à errer sur Terre en quête d’un au-delà, cesser de perdre la seule vie qui nous soit donnée à en espérer une autre, biffer les fioritures conventionnelles pour dévorer l’existence à même le fruit, comme on fait l’économie de la glose pour retrouver le plaisir inaltéré du texte, c’est la voie qu’esquisse Meursault, en prenant congé du lecteur. Au crépuscule des idoles, délesté du joug destinal dont nous chargent les religions et les idéologies du Grand Soir, point la promesse de l’aube.
« Et tout commence dans cette lassitude teintée d’étonnement. »
« Cette difficulté de se sentir dans le monde est très actuelle »
Michel Agier
Michel Agier, spécialiste de la question des migrations et des réfugiés, développe à partir de l’œuvre de Camus une réflexion sur le sentiment de mal-être et d’inadéquation.
[100 %]
Robert Solé
Le journaliste et écrivain Robert Solé raconte ici son parcours personnel : né au Caire, il a choisi, demandé et obtenu par naturalisation d'être français.
Felix Nussbaum, le grand Autre
Thomas Schlesser
Un décryptage par l'historien de l'art Thomas Schlesser d’un tableau de Felix Nussbaum, peintre assassiné par les nazis.








