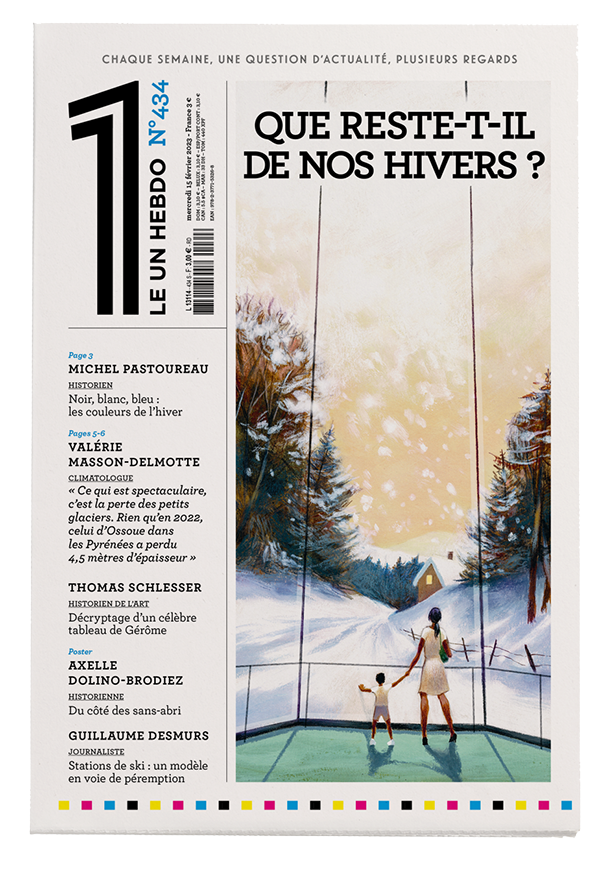Sans-abris : la saison des souffrances et de la solidarité
Temps de lecture : 8 minutes
Sur le long terme, la sociologie des personnes sans-abri durant l’hiver a beaucoup changé. Au XIXe siècle se trouvaient à la rue nombre de personnes âgées qui n’arrivaient pas à survivre et mendiaient, voire allaient jusqu’à demander leur incarcération au dépôt de mendicité. Tout un prolétariat agricole était privé de travail durant l’hiver et refluait dans les villes, sans ressources financières et sans logement. Mais les mendiants et vagabonds pouvaient également être, comme aujourd’hui, des jeunes ou des ouvriers en quête d’ouvrage, des femmes abandonnées par leur conjoint…
C’est dans ce contexte particulier de « paupérisme » qu’ont été inventées de nouvelles solidarités pour contrer la grande misère née de l’industrialisation et de l’urbanisation. La dépression économique des années 1873-1896 a en particulier joué un rôle décisif dans la prise de conscience de la nécessité d’agir : le chômeur, auparavant catalogué comme paresseux, devient dans la perception d’un nombre croissant de Français quelqu’un qui ne trouve pas de travail en raison de la conjoncture économique. À la répression du vagabondage et de la mendicité se substitue peu à peu une volonté assistancielle.
L’une des grandes organisations de l’époque, l’Armée du salut, née en Grande-Bretagne en 1865, s’implante en France en 1881
C’est dans ce contexte que naissent de nouvelles mobilisations charitables et hivernales. Des soupes populaires sont développées par les bureaux de bienfaisance. L’une des grandes organisations de l’époque, l’Armée du salut, née en Grande-Bretagne en 1865, s’implante en France en 1881. Sa devise illustre sa mission : « Soupe, savon, salut. » Elle distribue aux « indigents », selon le vocabulaire en vigueur, des soupes et des rations l’hiver. Son fondateur, William Booth, et Paulin Enfert, qui a créé La Mie de pain à Paris en 1891, incarnent assez bien cette première période d’assistance moderne. Les nouvelles municipalités républicaines vont rejoindre ce mouvement, avec les « fourneaux économiques ».
Il s’agit toujours, durant les périodes de grand froid, de proposer un plat chaud, mais aussi un toit. Le premier asile de nuit est créé à Marseille par un commerçant, François Massabo, le 24 décembre 1872. Il s’agit d’une structure pérenne, sous forme de dortoirs, qui diffère des paroisses ou des couvents qui hébergeaient pour quelques nuits des pèlerins ou des migrants. À partir de l’exemple marseillais, un nombre croissant d’asiles de nuit proposent, dans les grandes villes, un lit aux populations sans-abri. Ils sont créés par des philanthropes, et pour certains regroupés sous le nom d’Œuvre de l’hospitalité de nuit. Très vite les municipalités républicaines, en concurrence avec les institutions catholiques, vont créer leurs propres structures.
C’est l’hiver, moment catalyseur, que l’on observe toujours un élan de générosité annuel
Ces centres, pour hommes ou pour femmes, sont accessibles à partir de la fin de journée, pour trois nuits. On peut y faire une toilette sommaire ; les vêtements sont passés à l’étuve pour éliminer les poux et autres parasites ; un repas chaud est servi et on peut y dormir, avant d’être remis à la rue tôt le lendemain matin. Ils sont généralement ouverts la moitié de l’année, durant la saison froide. C’est l’hiver, moment catalyseur, que l’on observe toujours un élan de générosité annuel.
La crise de 1929 et les années 1930, avec leurs cortèges de chômeurs, vont faire écho aux années 1873-1896. Devant les soupes populaires défilent des foules imposantes. L’Armée du salut et La Mie de pain reprennent l’initiative. Ces deux associations créent alors des asiles de nuit. L’Armée du salut, protestante, est l’une des plus importantes organisations de solidarité nationales de l’entre-deux-guerres. Côté catholique, on retrouve les Conférences de Saint-Vincent-de-Paul, très actives, qui déclineront après la Seconde Guerre mondiale.
Les années de la Libération et de la Reconstruction ouvrent en effet une nouvelle période. Plusieurs associations caritatives voient le jour : le Secours populaire en 1945, le Secours catholique et les Petits Frères des pauvres en 1946, Emmaüs en 1949, ATD Quart Monde en 1957. Cette nouvelle génération d’associations a une conception beaucoup moins confessionnelle et prosélyte qu’avant-guerre. Le paternalisme s’estompe, les actions se spécialisent. Les Petits Frères des pauvres se concentrent sur les personnes âgées, Emmaüs sur la question du logement, etc. Grâce aux médias, ces institutions d’entraide parviennent à s’imposer.
L’abbé Pierre ne prétend pas régler le problème de la pauvreté, qui frappe alors surtout les personnes âgées, mais la question du logement
Le fameux hiver 1954 en est l’illustration parfaite. Alors que la France connaît une pénurie de logements qui frappe toutes les couches de la société, et que le thermomètre indique - 30 °C en Alsace et - 15 à Paris, l’abbé Pierre, fondateur de l’association Emmaüs, surgit sur la scène publique et fait demander à l’Assemblée nationale la construction de logements d’urgence. Ce n’est pas un inconnu : ce moine devenu prêtre, auréolé de prestige par son passage dans la Résistance, a été élu député MRP en 1945. Les pouvoirs publics font néanmoins la sourde oreille. Mais l’abbé Pierre veut faire bouger les lignes. Avec son éternel béret, sa cape de bure, sa longue barbe et sa canne, il se construit une image forte. Il a ses entrées à l’ORTF et à Radio-Luxembourg : son fameux appel au secours en faveur des pauvres sans toit en plein hiver est lancé simultanément sur les deux radios à une heure de grande écoute, durant le journal de la mi-journée. Son coup de gueule provoque un sursaut.
En quelques minutes, les standards sont saturés. Tout le monde veut donner à ce prêtre. Un milliard d’anciens francs de dons est récolté, chiffre symbolique qui donne la mesure du retentissement de l’appel. L’équivalent de 25 millions d’euros. Une première. C’est le début de sa célébrité nationale et internationale. L’abbé Pierre ne prétend pas régler le problème de la pauvreté, qui frappe alors surtout les personnes âgées, mais la question du logement. Alors que la France commence à se couvrir de bidonvilles en lisière des grandes villes, il plaide la cause de ses concitoyens brûlés par le froid, ceux qui dorment dehors ou dans des caves, dans des tentes, de vieilles roulottes, d’anciens wagons.
Une troisième génération d’associations va naître dans les années 1980, après les deux chocs pétroliers et la montée d’un chômage de masse. Face à ceux que les médias appelleront les « nouveaux pauvres », des associations humanitaires vont se développer pour agir. Initialement lancée pour aider les populations des pays du Sud, l’ONG Médecins du monde va ainsi créer une misson France en 1986. Médecins sans frontières emboîte le pas l’année suivante, pour soigner les sans-abri. Les premiers centres d’hébergement d’urgence remplacent durant l’hiver les asiles de nuit.

C’est lors de cette période que les premières Banques alimentaires ouvrent en 1984, en s’inspirant d’un système qui existe aux États-Unis. L’année suivante, Coluche lance à l’approche de l’hiver l’idée des Restos du cœur, une opération destinée dans son esprit à ne servir qu’une saison pour marquer les esprits. Il n’a pas l’idée d’une organisation pérenne mais parvient à fédérer autour de son projet l’opinion, le showbiz et les médias. Ces derniers sont à la recherche de grandes figures pour incarner la lutte contre la précarité, et l’attention au sort des SDF. Coluche portera cet étendard jusqu’à sa disparition en 1986. Tout comme l’abbé Pierre qui, rappelé sur le devant de la scène au début des années 1980, devient alors le personnage préféré des Français, désigné 17 fois en tête du Top 50 des personnalités. Autant Coluche incarne une figure jeune, laïque et apolitique, autant l’abbé symbolise la sagesse du grand âge, le religieux et la volonté politique.
La dépénalisation du vagabondage et de la mendicité change complètement la manière d'appréhender les sans-abri
Ce type de personnalités et le travail des associations ont fait évoluer le regard porté sur ceux qu’on appelait jadis les misérables. Le vagabondage et la mendicité sont pourtant toujours mentionnés dans le Code pénal et susceptibles d’être sanctionnés ; et certains de ceux qui s’y livrent sont régulièrement envoyés au poste de police et enfermés de force. La dépénalisation de ces délits, actée en 1992, change complètement la manière d’appréhender les sans-abri. Avant la dépénalisation, ils se cachaient ; après, ils se rendent visibles pour solliciter l’assistance des passants et des associations. Cette visibilité et la massification du phénomène conduisent à une nouvelle étape : la naissance du Samu social en 1993, l’essor des maraudes, la création des accueils de jour, de lits infirmiers, du 115…
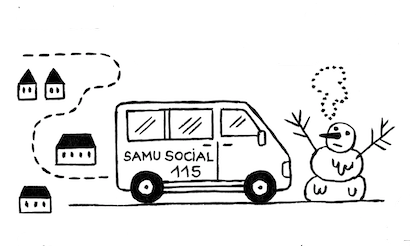
Cette batterie de dispositifs publics et associatifs rend aussi plus concret le rôle de l’État. Avec les « plans froid », les pouvoirs publics libèrent des lits dans des gymnases, des stations de métro, des salles polyvalentes, etc. C’est une forme d’action plus visible que celle, habituelle, qui consiste à déléguer la gestion des sans-abri aux associations en les subventionnant.
Depuis deux siècles au moins, l’hiver est bien la saison la plus tendue et la plus propice à la solidarité. Le froid en est naturellement l’une des principales raisons. On peut aussi citer une culpabilité spécifique à cette période, où l’on dépense parfois sans compter pour des cadeaux superflus. Enfin, il y a Noël. Quand bien même le Père Noël est laïque, la Nativité garde sa puissance symbolique. Les paroles de Jésus ne sont pas oubliées : « J’ai eu faim, et vous m’avez donné à manger ; j’ai eu soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais étranger, et vous m’avez recueilli… » (Matthieu, 25, 35). Ces mots sonnent comme un rappel à cette obligation morale universelle qui veut qu’on ne laisse pas à l’abandon quelqu’un qui souffre dans la rue. En cela, l’hiver reste une période de mobilisation solidaire et charitable tout à fait particulière.
Conversation avec LAURENT GREILSAMER
« Nous éprouvons la nostalgie des hivers perdus »
Valérie Masson-Delmotte
La paléoclimatologue et coprésidente du Giec Valérie Masson-Delmotte revient sur le rôle que joue l’hiver sous nos latitudes et sur les problématiques environnementales et politiques que pose le radoucissement de cette saison consécutif au réchauffement climatique.
[Pluviôse]
Robert Solé
Pourquoi décembre ? Pourquoi janvier et février ? Robert Solé revient sur la signification des noms des mois d'hiver et le calendrier républicain adopté suite à la Révolution française.
Duel tragicomique
Thomas Schlesser
L’historien de l’art Thomas Schlesser décrypte le tableau Sortie du bal masqué de Jean-Léon Gérôme.