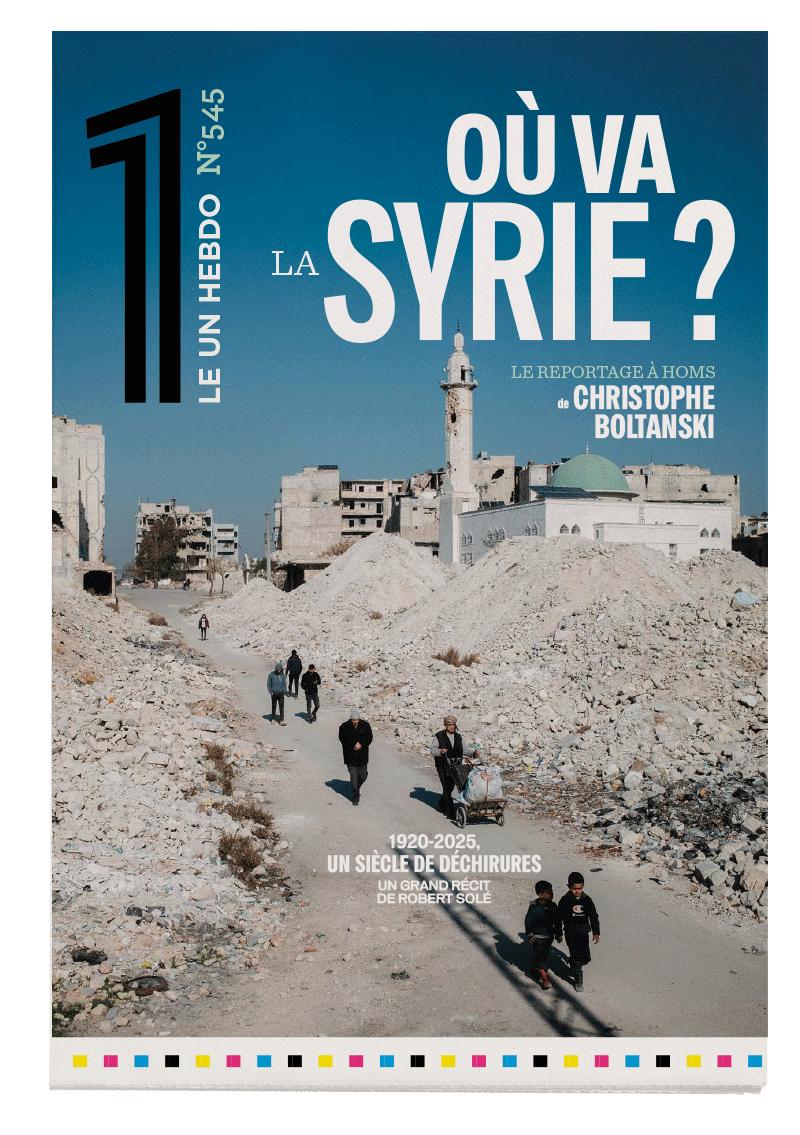« Un mot troublé et troublant »
Temps de lecture : 9 minutes
D’où vient la notion de consentement, devenue centrale aujourd’hui dans les questions de sexualité ?
Je l’ai abordée à partir de sa « provenance », au sens où Michel Foucault emploie ce concept. Il faut renvoyer au sujet moderne, juste avant les Lumières ; sans oublier que le consentement existait déjà à Rome. Le consentement pose la question du sujet. J’aime citer Pascal qui parle du consentement « de vous à vous-même », montrant que la délibération est d’abord intérieure. Le consentement est aussi lié à la question du contrat social et, en ce sens, il revêt une dimension politique. Je rappelle qu’on doit consentir à l’impôt ! L’organisation sociale suppose des individus qui consentent à des règles qui relèvent de la démocratie et de la république. À travers ce consentement, on adhère à la société à laquelle on appartient. Je me souviens d’une élue verte française à la fin des années 1990 qui, dans l’hémicycle, à propos du foulard des jeunes musulmanes, disait : « Mais puisqu’elles consentent, où est le problème ? » Je réponds que le problème commence là, dans cet espace qui fait du consentement un argument politique. J’ai alors lié, analogiquement, la question de la prostitution et celle du foulard, soit : dénuder son corps ou le couvrir.
Pourquoi le mot même de « consentement » est-il, à vos yeux, problématique ?
Une première difficulté de définition apparaît tout de suite – d’ailleurs, beaucoup de dictionnaires de philosophie ne mentionnent pas ce mot. Dès le départ, la confusion entre deux sens est visible : « choisir » ou « accepter », les deux sont là. Au premier sens, si la femme consent, elle choisit, et il y a égalité ; au deuxième sens, si elle ne fait qu’accepter, il y a dissymétrie en faveur de l’homme. Au mot « consentement », je préfère donc celui d’« accord ». Un dictionnaire du xviie siècle propose d’ailleurs pour « consentement » : « tomber d’accord ». Il n’y a pas d’ambiguïté, cela suppose une forme de mutualité. Con-sentir signifie « sentir avec » : ce n’est pas seulement une relation de soi à soi ou au tout social, mais une relation entre deux êtres. Ce mot est ainsi troublé et troublant dès le départ.
« Faire de ce problème une affaire uniquement judiciaire est une impasse »
À quel moment apparaît-il ?
La notion de consentement mutuel se lit chez John Milton au XVIIe siècle, puis dans la loi de 1792. Or elle s’applique au divorce, donc à du négatif : le couple consent mutuellement, dit Milton, à reconnaître un défaut de conversation. C’est la fin de la seule séparation pour faute (mot qui pouvait qualifier, entre autres, l’adultère). C’est magnifique. Puis les révolutionnaires voient que le consentement mutuel privilégie les femmes, alors le Code civil de 1804 va reculer. En 1816, le penseur de la contre-révolution Louis de Bonald fait interdire le divorce, car il ne faut pas, selon lui, fabriquer de « démocratie domestique »… Des femmes et des hommes se battront alors pour le rétablir. Ce sera chose faite en 1884, mais sans la possibilité du consentement mutuel. Le sociologue Émile Durkheim, par exemple, s’y opposera car, pour préserver la structure sociale, la famille ne doit pas imiter la cité.
Une asymétrie perdure : par le passé, quand le père donnait son consentement au mariage de sa fille, on acceptait cette unilatéralité ; et maintenant, on fait comme si la question ne concernait que les femmes. À l’adjectif « consentant », dans l’édition de 2005 du Dictionnaire culturel, il est précisé : « Ne se dit guère que des femmes. » On est au début du XXIe siècle ! La femme a-t-elle consenti au rapport sexuel ? se demande-t-on. Mais comment le démontrer ?
Ce mot est-il un faux ami ?
En tout cas, il pose trop de problèmes. Il est d’une richesse folle, mais il ne peut être utile dans un moment politique. Quand on s’est mis à parler des « zones grises » du consentement, cela ne voulait rien dire d’autre que privilégier celui qui prétend n’avoir pas bien compris l’autre. Je me souviens d’un article du Monde où le prévenu disait : « Elle n’a pas dit oui, elle n’a pas dit non, elle a fait, c’est tout. » Dans un autre cas, il était souligné que si elle avait enlevé son jean, c’est qu’elle était d’accord. Mais qu’en est-il si elle a fait cela sous les coups ou sous la menace ? L’existence de flous amène une autre interrogation : peut-on s’en tenir au judiciaire ? L’histoire en cours montre que non. J’appartiens à la génération qui s’est mobilisée politiquement à la fin des années 1970 pour que le viol ne soit plus jugé par les tribunaux comme un délit mais comme un crime. Un combat qui a abouti à faire entrer dans la loi, en 1980, une véritable définition du viol : « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte ou surprise ».
Comment s’est imposé ce débat sur le consentement ?
Le combat des années 1980 mène à #MeToo. On parle de libération de la parole, mais non, personne n’a libéré la parole : les femmes l’ont prise. Ce fut ainsi d’emblée une action collective, manifestant ce que je nomme le « corps collectif » des femmes : quand l’une se met à parler, tout à coup, d’autres suivent. C’est le sens du « moi aussi » de #MeToo. Et si elles parlent, c’est parce qu’elles ont une autonomie sociale et économique. Il y a en effet deux supports incontournables dans l’émancipation des femmes. D’un côté, l’habeas corpus, c’est-à-dire la reconnaissance que l’on a la propriété de son propre corps – par la contraception ou l’avortement (« j’aurai des enfants si je veux et quand je veux »). De l’autre, l’autonomie économique, qui permet plus généralement l’indépendance – pouvoir par exemple parler sans risquer de perdre son job. La prise de parole tient donc à l’évolution sociale et à l’histoire du féminisme. La question du consentement devient pleinement politique. Qu’elle ne concerne encore aujourd’hui que les femmes montre qu’on accepte l’inégalité entre les sexes, une dissymétrie, donc une hiérarchie.
C’est ce qui se passe aujourd’hui ?
Oui, car en privilégiant les affaires de mœurs, on réduit à nouveau #MeToo à une question judiciaire sans vouloir entendre qu’il s’agit d’une question politique : celle de l’égalité des sexes et de la liberté des femmes. Égalité et liberté se croisent, de là vient la complexité du débat, qui est bien politique et non pas moral. Faire confiance à la justice ? Cela ne suffit pas. Moins de 1 % des plaintes pour agressions sexuelles font l’objet de condamnations. Que faire ? Le judiciaire oppose à la discussion publique la présomption d’innocence. Mais il est absurde de répéter : « Laissons la justice faire son travail », puisque le problème vient de ce qu’elle n’a pas su entendre. Je suis catégorique : faire de ce problème une affaire uniquement judiciaire est une impasse. On a posé sur la table une question politique : l’inégalité des sexes dans leurs rapports d’altérité, de sexualité. Si, pour les femmes, la raison a gagné – puisqu’elles peuvent aller à l’école ou entrer au Parlement –, le corps, lui, pas encore. La présomption d’innocence permet aux hommes d’être tranquilles, dans la ligne de leur impunité traditionnelle : « Moi, faire du mal à une femme ? Jamais ! » pouvait dire Patrick Poivre d’Arvor à la télévision.
Pourquoi les hommes ont-ils du mal à comprendre et à se mobiliser ?
Que savent-ils de leur propre sexualité ? Ce qui m’intéresse n’est pas qu’ils se déconstruisent. La question du viol, c’est celle de la jouissance du pouvoir, pas de la jouissance sexuelle. Et l’existence du féminicide – qui n’est plus, enfin, un « crime passionnel » – montre qu’un homme peut tuer sa femme parce qu’elle le quitte dans un geste d’indépendance, sans partir pour un autre. C’est un crime de lèse-majesté, contraire à ce que l’anthropologie a souligné sur l’échange des femmes. Il faut alors distinguer deux termes : la propriété et la possession. Nous, les femmes, nous avons obtenu la propriété de notre corps. Seulement, on peut être propriétaire de son corps et cependant être possédée. La violence des hommes vient de la nécessité de posséder. Si un homme perd la possession, il peut tuer.
Quel est le rôle des parents dans le cas du consentement discutable des adolescents, qui sont d’abord des adolescentes ?
Dans les cas de Vanessa Springora et de Judith Godrèche, les parents sont objectivement – si ce n’est subjectivement – complices. Je ne dirais pas qu’ils sont responsables, ce qui induirait une dimension judiciaire, mais qu’ont-ils pu ou su entendre ? Il faut élargir le champ de réflexion au moment historique de la fin du xxe siècle, mais certainement pas en le rapportant à ce qu’on appelle libération sexuelle. En restant dans le seul champ judiciaire, on limite le problème à une plainte et à un présumé innocent, comme s’il n’y avait rien autour. Cela signifie, une fois encore, qu’on en fait non une affaire politique mais une affaire morale. Je reviens aux deux concepts clés de la démocratie, la liberté et l’égalité, car, ici, ils sont entremêlés, d’où notre difficulté. On a pourtant avancé en passant du drame conjugal au féminicide, de la question morale à celle de la structure d’anthropologie politique, à un système.
La France et d’autres pays membres ont refusé récemment d’introduire la notion de consentement dans la directive européenne sur les violences faites aux femmes. Quelles en sont les conséquences ?
La définition française du viol repose sur une qualification de violence. Si on ne veut pas y inclure le consentement – ce que souhaitaient pourtant plusieurs autres pays européens –, c’est parce que l’on sous-entend que l’on charge les femmes du poids de la dénonciation pendant que les hommes se réfugient entre impunité et présomption d’innocence. Refuser de discuter du consentement, au motif que cette notion n’est pas claire, c’est réduire les femmes au silence – et, de fait, on leur demande de ne pas parler. Je ne suis pas d’accord. Le sujet moderne doit exercer sa liberté de parler. Selon moi, la meilleure solution aurait été d’introduire le mot de consentement, tout en insistant sur la violence de l’agresseur. Façon, là encore difficile, de mettre face à face l’émancipation des unes et la domination des autres. Alors où est la « libération de l’écoute » ? Proposons l’inversion de la charge de la preuve. En 1997, une directive européenne sur les inégalités économiques a obtenu ce principe. Ce n’est plus à la personne discriminée car mal payée de démontrer qu’elle subit une injustice, mais à son employeur de montrer qu’il ne la discrimine pas. Ce fut pour moi un choc intellectuel. On pourrait faire de même concernant les violences sexuelles. La prise de parole des femmes, ces dernières années, est essentielle. Comme dit la politiste britannique Carole Pateman : « Sous le contrat social, il y a un contrat sexuel qui n’a pas été explicité. » Je veux l’émancipation avec le consentement, et la critique de la domination masculine avec l’inversion de la charge de la preuve.
Comment sortir de ces affaires ?
Au niveau judiciaire, nous faisons face à deux limites : l’insistance sur la présomption d’innocence et la proportion dérisoire de condamnations… Pour avancer, il faut accepter le débat public ; on n’a pas le choix. N’oubliez pas comment #MeToo est né aux États-Unis. C’est la grande manifestation de femmes après l’arrivée de Trump au pouvoir fin janvier 2017 qui est en amont, qui dénonce les propos inadmissibles du milliardaire : « Moi, les femmes, je les attrape par la chatte. » #MeToo est politique. Et Weinstein fut une image de Trump, faute d’avoir pu poursuivre Trump lui-même. Il faut se montrer vigilant afin d’empêcher que les droits des femmes ne deviennent réversibles.
Propos recueillis par ÉRIC FOTTORINO
« Un mot troublé et troublant »
Geneviève Fraisse
Spécialiste de la pensée féministe, la philosophe Geneviève Fraisse revient sur la façon dont la notion de consentement est devenue centrale dans le combat pour l’émancipation des femmes, tout en soulignant ses limites et son caractère problématique, ou du moins insuffisant.
[Lit conjugal]
Robert Solé
– Avec toutes ces histoires de consentement et de rapports sexuels forcés, la justice s’invite dans les chambres à coucher ! C’est le monde à l’envers : on est passé du devoir conjugal au viol conjugal…
L’adolescence et le piège de la culpabilité
La pédopsychiatre Priscille Gerardin nous explique pourquoi la question du consentement se pose de manière beaucoup plus complexe chez les adolescents, bien plus vulnérables aux phénomènes d’emprise.