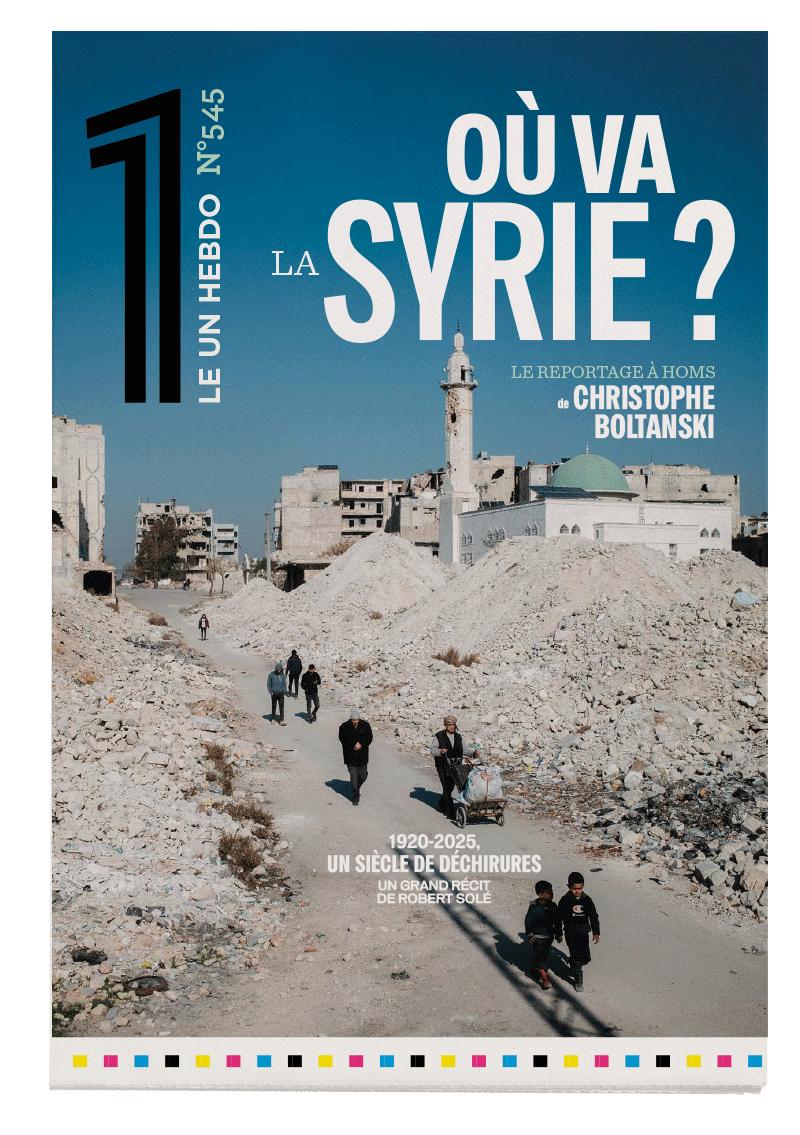Pourquoi céder n’est pas consentir
Temps de lecture : 3 minutes
Il n’y a pas de consentement éclairé. Si l’on prend au sérieux l’expérience du consentement, en matière amoureuse et sexuelle, on ne peut réduire le consentement à un contrat entre deux parties. Il n’y a pas de consentement éclairé, car le consentement n’est pas seulement une affaire rationnelle. Le consentement, l’étymologie le dit, engage toujours le corps. C’est un cum-sentire, soit un « se sentir » en accord avec ce qui se produit, non seulement avec l’autre, mais en notre corps. Consentir, c’est ne pas savoir à l’avance à quoi l’on consent. C’est un « oui », sans savoir préalable, un élan vers l’autre mettant en jeu le désir et la jouissance. Cette dimension de non-savoir fait la beauté et l’éclat du consentement. Il y a toujours un risque que je cours lorsque je consens sans savoir, et pourtant, ce risque, je le prends, je désire le prendre, car ce qui m’arrive dans la rencontre avec l’autre, me fait éprouver en mon corps un désir et une jouissance avec lesquels je suis d’accord. Le consentement a toujours une dimension de saut – j’y vais, je ne sais pas pourquoi, mais je le désire.
L’ambiguïté du consentement, sa dimension toujours opaque et mystérieuse, ce non-savoir qui est en son cœur, ne doit pourtant pas être confondue avec l’expérience du forçage et du traumatisme. Il y a là un enjeu à la fois éthique et clinique.
Le traumatisme suppose une effraction psychique et sexuelle qui est un forçage
Si, au nom de l’ambiguïté du consentement, on ne fait plus de distinction entre ces deux expériences, on nie la dimension traumatique du forçage. On ne reconnaît plus les effets du traumatisme psychique et sexuel. Il est donc nécessaire de ne pas confondre l’opacité du consentement avec la mauvaise rencontre qui conduit au traumatisme.
Où se situe la frontière ? Car il y a bien une frontière. C’est même son franchissement qui fait trauma. La frontière se situe dans le corps. Le traumatisme suppose une effraction psychique et sexuelle qui est un forçage. Le sujet n’est pas d’accord avec ce qui se produit en son corps, mais cela lui arrive contre son gré, et avant même qu’il ait le temps d’en être angoissé. Ce forçage définit le traumatisme comme une expérience où le sujet « cède à la situation ». Le sujet, dans la confrontation traumatique, ne peut répondre – c’est ce que montre Jacques Lacan dans son séminaire sur l’angoisse (1962-1963), qui a fait l’objet d’une publication posthume au Seuil en 2010. Il cède au sens juridique du terme, au sens où céder un bien, céder une terre, c’est laisser l’autre en jouir. Il cède son corps et, en tant que sujet, il chute. Cette conception du traumatisme psychique et sexuel, comme un « céder à la situation », invite donc à remettre en cause l’aphorisme « qui ne dit mot consent ». Celui-ci méconnaît le statut du silence dans le traumatisme. Le « ne pouvoir dire mot » n’est pas le signe du consentement, mais c’est la signature du trauma. C’est là ce que montre Freud dès l’origine de la psychanalyse. Le trauma confronte le sujet à une impossibilité de répondre, aussi bien à l’autre que de ce qui a lieu. Le sujet cède à la situation, c’est-à-dire que le rapport à la parole est court-circuité par le forçage dans le corps. Le silence, la langue coupée, la parole confisquée ne signifient pas consentement, mais effraction dans le corps. De la même façon, le consentement politique peut aussi être forcé et brutalisé. Albert Camus l’a très bien montré en son époque dans L’Homme révolté (1951) en considérant que les idéologies totalitaires reposaient sur l’anéantissement du consentement. Le consentement à dire à nouveau a alors aussi une portée politique en ce qu’il fait résonner dans la civilisation la valeur de la parole, l’énonciation d’un sujet et la possible transmission d’une éthique.
« Un mot troublé et troublant »
Geneviève Fraisse
Spécialiste de la pensée féministe, la philosophe Geneviève Fraisse revient sur la façon dont la notion de consentement est devenue centrale dans le combat pour l’émancipation des femmes, tout en soulignant ses limites et son caractère problématique, ou du moins insuffisant.
[Lit conjugal]
Robert Solé
– Avec toutes ces histoires de consentement et de rapports sexuels forcés, la justice s’invite dans les chambres à coucher ! C’est le monde à l’envers : on est passé du devoir conjugal au viol conjugal…
L’adolescence et le piège de la culpabilité
La pédopsychiatre Priscille Gerardin nous explique pourquoi la question du consentement se pose de manière beaucoup plus complexe chez les adolescents, bien plus vulnérables aux phénomènes d’emprise.