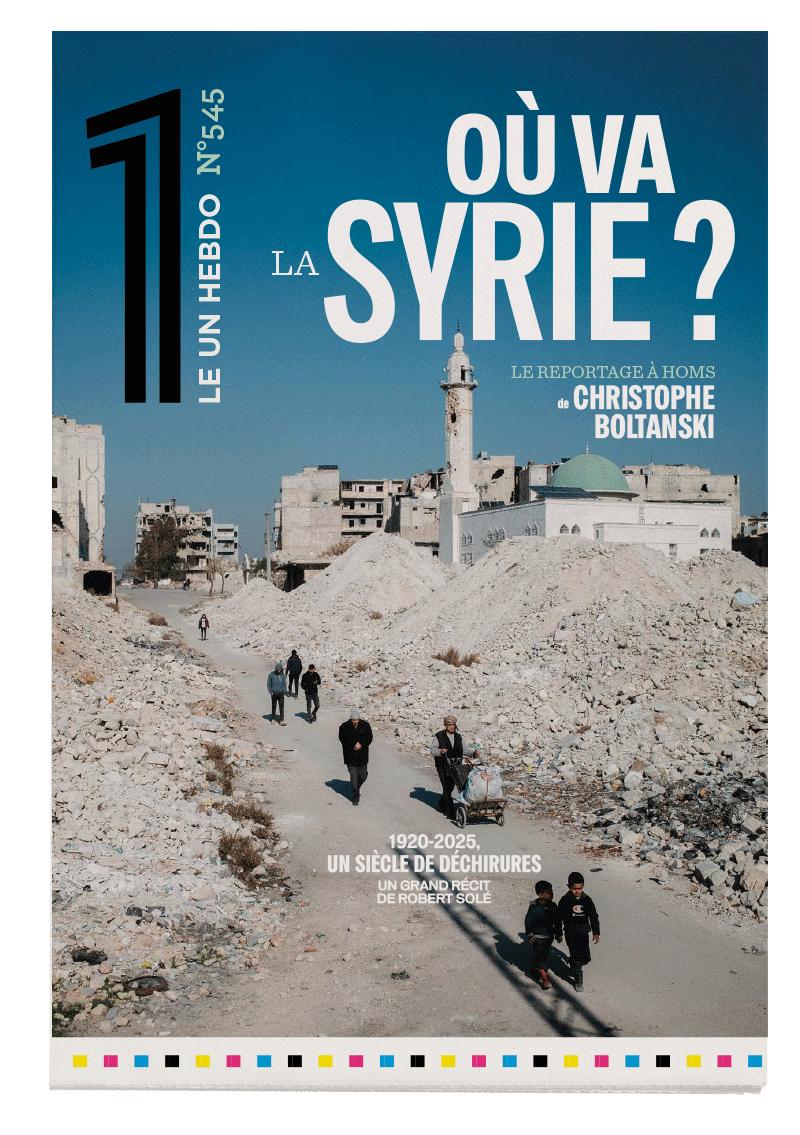Un corps violé est un corps volé
Temps de lecture : 4 minutes
L’onde de choc du mouvement #MeToo en France, la déflagration produite par la publication des livres de Vanessa Springora et de Camille Kouchner, les révélations récentes de Judith Godrèche, les plaintes déposées contre Patrick Poivre d’Arvor et Gérard Depardieu, parmi tant d’autres, moins visibles, ont opéré un triple déplacement dans notre façon de considérer le « consentement » qui aura largement contribué à faire reculer notre seuil de tolérance, individuel et collectif, aux violences sexuelles et sexistes, dont la société se refusait à mesurer tant l’ampleur que la destructivité.
Renverser l’ordre du soupçon
Longtemps, un supposé « consentement » fut l’alibi que se donnaient les violeurs et autres agresseurs, tous milieux confondus, pour nier qu’ils aient fait violence à ceux et celles qu’ils avaient agressés et, à ce titre, commis un crime qui demandait à être puni et réparé. Pour peu qu’ils soient mis en cause, leur stratégie était systématiquement de nier que les rapports incriminés aient été forcés. Rien n’étant plus difficile à prouver que l’absence de consentement, il leur était aisé d’opposer leur parole à celle de leurs victimes pour soutenir que rien ne leur avait laissé supposer un refus de leur « partenaire », que leur opposition était « rétrospective », « intéressée », tandis qu’au moment des faits le « consentement » était mutuel. Sans doute est-ce toujours ainsi que les responsables d’agressions sexuelles plaident, aujourd’hui encore, leur innocence. Est-ce à dire que rien n’a changé ? Non, assurément, car le poids des plaintes, l’écoute, l’audience et la considération qui leur sont accordées ne sont plus les mêmes. C’est le sens essentiel qu’il faut donner à cette libération. Son effet salutaire aura été de renverser l’ordre du soupçon en brisant les murs du silence dans lesquels l’ironie ou l’incrédulité des uns, la complaisance des autres, la honte, enfin, tenait enfermées les victimes. Il aura été aussi de rendre au refus la radicalité et le caractère inconditionnel que tant de représentations culturelles (littéraires ou cinématographiques) avaient contribué à lui ôter. Un « non » est un « non », contrairement à ce que tant d’hommes se plaisent à imaginer encore. Le seuil de tolérance de la société recule dès lors que se refuser à l’admettre, y compris dans son propre foyer, n’apparaît pas seulement comme l’une des manifestations et l’un des héritages les plus durables de la domination masculine, mais au moins autant comme l’un des piliers les plus solides de sa « culture du viol ».
Le consentement d’enfants ou de jeunes adolescents fut aussi l’argument avancé par des adultes pour justifier et excuser les rapports sexuels qu’ils avaient ou pouvaient avoir eus avec ceux ou celles dont ils refusaient d’admettre que la soumission était le résultat de leur emprise, à la mesure des histoires qu’ils se racontaient et de l’image qu’ils voulaient donner de leur relation. Sur le plan strictement légal, la loi considère désormais qu’en deçà de 15 ans, aucun « consentement » ne saurait être invoqué par un adulte pour se justifier d’avoir abusé d’un mineur et qu’en conséquence tout rapport sexuel qu’il aurait eu avec un enfant ou un adolescent de cet âge relève de la pédocriminalité. Cette évolution apporte un changement de perspective considérable. Elle reconnaît que le « consentement » invoqué par l’agresseur – à supposer qu’il ait pu imaginer quoi que ce soit de cet ordre – n’en est jamais un, qu’il est toujours l’effet d’une force, celle de son autorité ou de sa brutalité. Il n’appartient pas aux adultes d’initier les enfants à la sexualité en les prétendant « consentants ». Toute initiation de cet ordre court-circuite le temps qu’il faut à l’enfant pour s’approprier sa propre sexualité, de lui-même, par lui-même et avec celui ou celle qu’il se choisit. Un corps violé est un corps volé. Quiconque se rêve en Pygmalion se berce d’illusions, dans l’ignorance du traumatisme qu’il lègue en héritage à celui ou celle dont il aura fait sa créature.
Le consentement meurtrier renvoie à chacune de ces fois où nous transigeons avec cette responsabilité
Il convient, pour finir, d’évoquer un troisième déplacement dans notre façon de considérer le consentement. Il ne s’agit plus alors de celui que tant de forces – celles des milieux familiaux, sociaux et professionnels – et d’institutions auront prêté aux victimes d’agressions sexuelles pour en neutraliser la plainte, mais de celui qui résultait de leur propre passivité. Les notions de complaisance et d’indifférence ne suffisent pas à décrire cette attitude-là, qui est rien de moins qu’un consentement meurtrier. S’il est vrai que la relation à autrui est fondée sur la responsabilité de faire l’attention, de prendre soin et de porter secours qu’appelle pour tous et de partout la vulnérabilité des êtres, le consentement meurtrier renvoie à chacune de ces fois où nous transigeons avec cette responsabilité. C’est ce qui arrive quand, confrontés à une violence qui nous dérange parce qu’elle bouscule l’ordre de nos certitudes ou menace les rapports de domination qui nous arrangent, nous préférons détourner le regard ou faire la sourde oreille. Ce que nous devons reconnaître alors, c’est que l’aveuglement et la surdité dont la société aura fait preuve durant tant d’années devant les souffrances des victimes d’agression sexuelle, minimisant ou négligeant la perdurance de leur traumatisme, auront relevé (et relèvent encore) d’un tel consentement meurtrier.
« Un mot troublé et troublant »
Geneviève Fraisse
Spécialiste de la pensée féministe, la philosophe Geneviève Fraisse revient sur la façon dont la notion de consentement est devenue centrale dans le combat pour l’émancipation des femmes, tout en soulignant ses limites et son caractère problématique, ou du moins insuffisant.
[Lit conjugal]
Robert Solé
– Avec toutes ces histoires de consentement et de rapports sexuels forcés, la justice s’invite dans les chambres à coucher ! C’est le monde à l’envers : on est passé du devoir conjugal au viol conjugal…
L’adolescence et le piège de la culpabilité
La pédopsychiatre Priscille Gerardin nous explique pourquoi la question du consentement se pose de manière beaucoup plus complexe chez les adolescents, bien plus vulnérables aux phénomènes d’emprise.