« Le monde agricole se sent incompris par les français »
EntretienTemps de lecture : 6 minutes
D’où vient ce mal-être qu’ont exprimé cet été les agriculteurs ?
Longtemps, le monde agricole a bénéficié d’une bonne cote d’estime. Chacun était conscient qu’il jouait un rôle important dans l’équilibre des territoires. Mais les agriculteurs sont aujourd’hui sous la contrainte de plus en plus forte de politiques environnementales dictées par des organisations vertes ayant à leur égard un a priori très négatif. Ces organisations ont réussi à modifier la vision des Français vis-à-vis du monde agricole. Les agriculteurs seraient des pollueurs, des éleveurs insensibles au bien-être animal, uniquement préoccupés de l’intensification et n’hésitant pas à massacrer l’environnement. De là naît le sentiment de ras-le-bol et le plus profond du malaise. Le monde agricole se sent incompris par le reste de la population française.
La crise n’est-elle pas d’abord économique ?
Pendant plus d’un demi-siècle, les agriculteurs ont bénéficié de la protection de la PAC (politique agricole commune), avec des prix largement rémunérateurs. Les voilà confrontés à une nouvelle donne : des marchés qui ne sont plus protégés, des prix instables, des aides conditionnées à cette nouvelle approche « verte ». La PAC que nous avons connue est morte. Il reste une politique ruralo-environnementale qui soutient l’agriculture mais avec des contraintes parfois discutables, et une mise en œuvre pas très fine… Si on ajoute Bruxelles et notre génie bureaucratique propre, cela donne une situation souvent kafkaïenne pour les exploitants qui ploient sous la paperasserie et un empilement de réglementations appliquées sans discernement.
Le prix du porc est le même partout. Voulez-vous dire que la crise est d’abord française ?
Si les prix bas du porc n’ont pas provoqué les mêmes réactions en Allemagne, c’est que les éleveurs outre-Rhin ont su entrer dans des logiques contractuelles. En France, nous constatons l’incapacité de négocier des acteurs (éleveurs, industriels). L’absence de concertation et de confiance est flagrante. Et puis la France a une tendance naturelle à aggraver les choses. Pour créer une unité de méthanisation [pour le recyclage des déchets (NDLR)], il faut six mois en Allemagne quand il faut trois ans chez nous. Les préfets ont peur des réactions, comme avec la fameuse ferme des mille vaches.
L’agriculture française n’a-t-elle pas manqué le tournant d’une modernisation qu’ont su mieux prendre nos voisins comme l’Allemagne, les Pays-Bas ou l’Espagne ?
Je ne dis pas que le gigantisme soit une solution. Je ne suis pas sûr de la rationalité économique de ces très grandes exploitations. Du point de vue environnemental cependant, cette ferme des mille vaches était parfaite. De quel droit refusons-nous ce genre de structures ? Dès lors qu’elles appliquent la réglementation sanitaire et environnementale, pourquoi les limiter à cinq ou sept cents animaux au lieu de mille ? Mais cela ne signifie pas que le modèle soit reproductible. Le modèle qui a bien fonctionné dans la longue durée en France est celui de l’exploitation familiale. Du fait de nos contraintes sociales, le passage au salariat est assez difficile. Un exploitant peut à lui seul gérer une exploitation de grande culture de 150 hectares. S’il prend un salarié, il doit passer à 250 hectares ! On change de dimension en raison de cette spécificité française du coût du travail.
L’Allemagne n’est-elle pas devenue une puissance agricole grâce à ses grandes exploitations ?
Son modèle agricole n’est pas unique. Les Allemands ont eu l’intelligence de conserver cet héritage de la RDA constitué de grandes unités, ces sortes de kolkhozes qui existaient déjà. En Bavière, l’agriculture repose sur de petites exploitations. Il est vrai qu’il n’y a pas eu en Allemagne le même rejet qu’en France vis-à-vis des très grandes structures.
On en revient à cette interrogation : pourquoi la crise est-elle si profonde chez nous ?
Le paradoxe est que jamais nous n’avons mieux mangé en termes de sécurité alimentaire. Et jamais nous n’avons observé autant de peurs alimentaires ainsi que de détournements vers des alimentations alternatives, le bio, le « sans gluten »… Certains cultivent la nostalgie d’une agriculture naturelle mythique. C’est irréaliste et irresponsable. Ils oublient qu’au début du xxe siècle, l’espérance de vie était de 50 ans, et la malnutrition sévissait. La salmonellose existait mais on ne la connaissait pas !
Les agriculteurs ont-ils perdu la bataille de la communication ?
L’incompréhension s’est creusée entre le monde agricole et tous les verts qui ont un accès privilégié aux médias et lancent des campagnes choc. Souvenez-vous des affiches placardées dans le métro par l’association France Nature Environnement en 2011 [ces affiches fustigeaient l’élevage intensif des porcs, les OGM et les pesticides (NDLR)]. Le monde agricole a fait des efforts pour regagner l’affection des citadins. Cela marche encore avec les 690 000 visiteurs du Salon de l’agriculture, mais ça ne va pas plus loin. Ce divorce est le fruit d’un discours progressif. Je pense que le Grenelle de l’environnement (2007) marque un moment clé. Le « deal » était assez simple. On a dit aux écologistes : vous ne touchez pas au nucléaire, à l’incinération des déchets ; mais les OGM et la nourriture au sens large, on vous les laisse.
Comment se traduit cette incompréhension ?
Voyez l’affaire de Sivens dans le bassin de la Garonne. Ce projet de retenue d’eau pour irriguer les terres agricoles remonte à plus de quinze ans, mais on a laissé pourrir la situation. Face à la sécheresse qui sévit dans le Tarn cette année, on voit que l’idée avait du sens. Mais des gens comme José Bové n’ont pu s’empêcher de dire que le projet de Sivens était un soutien à quelques gros agriculteurs… J’ajoute que l’agriculture a perdu son poids politique. Dans les villages, de moins en moins de maires sont agriculteurs. L’intérêt agricole passe au second plan.
Pourquoi l’élevage est-il si touché ?
C’est là que les contraintes environnementales se sont concentrées, que les peurs alimentaires ont été les plus importantes. L’élevage ne s’est jamais totalement remis de la crise de la vache folle. Elle a causé une rupture dans la confiance que les consommateurs pouvaient avoir dans la viande. Ils ont pris conscience qu’à travers les farines animales, on pouvait changer les bovins en carnivores. Puis est venue d’Allemagne la notion du bien-être animal. Par ailleurs, en refusant l’intensification, notre élevage s’est affaibli, d’autant que ses structures étaient déjà plus petites que dans nombre de pays européens.
La France ne serait plus une grande puissance agricole ?
Si l’élevage peine à nourrir son homme, nos producteurs de blé et de betteraves comptent parmi les meilleurs au monde. Il y a une grande efficience de l’agriculture française, et aussi une capacité de résilience aux crises. Je ne situe pas le problème dans le champ économique, mais avant tout dans le champ moral et politique. Les agriculteurs ont l’impression d’être la dernière roue du carrosse.
Employez-vous indifféremment les mots d’agriculteur ou de paysan ?
Non ! Agriculteur correspond à un moment de la modernisation. Il vient du latin ager, le champ cultivé. Paysan vient de pagus. Cette notion recouvre à la fois les zones cultivées et le reste. Il faut employer ce mot d’agriculteur, tout en ayant conscience qu’ils œuvrent sur un territoire bien plus large que leurs champs. Quand l’agriculture disparaît, le terroir se meurt. On tourne la page ultime d’un livre qui a été ouvert il y a un bon millénaire par les premiers moines défricheurs. L’agriculture est le dernier maillon qui nous relie à tous ceux qui ont fait le terroir français. La disparition de tout agriculteur nous diminue car nous sommes solidaires de ce terroir qui nous a marqués. Pour parodier Hemingway qui s’inspirait du prédicateur John Donne : n’envoie jamais demander pour qui sonne le glas ; quand disparaît une exploitation, il sonne aussi pour toi.
Propos recueillis par ÉRIC FOTTORINO


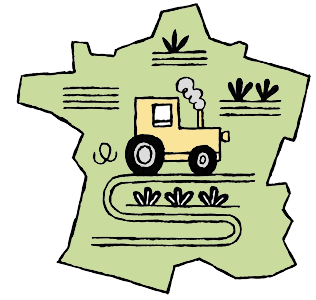
« Le monde agricole se sent incompris par les français »
Philippe Chalmin
D’où vient ce mal-être qu’ont exprimé cet été les agriculteurs ?
Longtemps, le monde agricole a bénéficié d’une bonne cote d’estime. Chacun était conscient qu’il jouait un rôle important dans l’équilibre des territoires. Mais les agriculteurs sont aujourd’hui sous la cont…
[Ras-le-bol]
Robert Solé
Oui, nous sommes en colère, et beaucoup plus que vous ne l’imaginez. La crise porcine est une insupportable réalité. Toute la Bretagne se mobilise, dans un ras-le-bol croissant.
Jusqu’à quand subirons-nous le diktat de ceux qui décident …
Des néo-fermiers dans l’air du temps
Manon Paulic
HAUTE-SAVOIE. Allongée sur le transat d’un hôtel, une jeune femme au ventre arrondi profite du grand air. Devant elle, les Alpes se déploient majestueusement dans la lumière d’un après-midi d’été. C’était il y a vingt …







